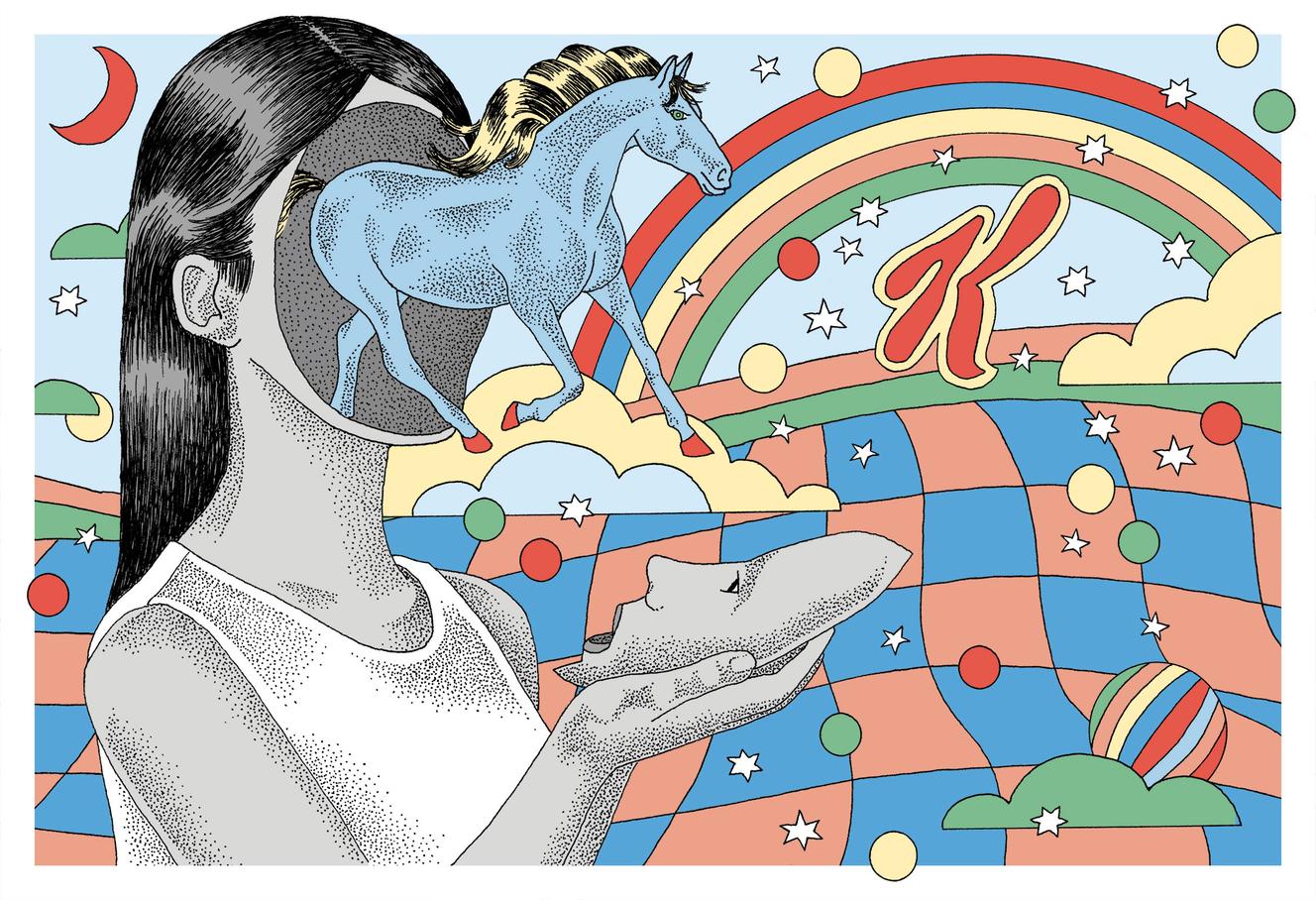Avec les Francs, l’« invention » d’une identité nationale
La fin de l’ère romaine a longtemps été attribuée à des « grandes invasions », non sans arrière-pensées politiques. Les historiens actuels préfèrent invoquer un long processus scandé par la violence qui a abouti à une fusion des peuples.

L’histoire commence quelque part en Angleterre, en un temps mal défini. Un vieil homme et sa compagne vivent reclus dans un village perdu, pris au piège d’une brume épaisse qui leur fait perdre la mémoire du passé. C’est à peine s’ils se souviennent de leur nom. Un jour, ils se mettent en route pour essayer de retrouver leur fils dont ils n’ont plus qu’une vague image. Peu à peu, au fil des rencontres, apparaissent par petites touches le souvenir du roi Arthur et les traces d’un passé héroïque. Un voyageur qu’ils rencontrent ose formuler une idée presque sacrilège : « [C’est] peut-être Dieu lui-même qui [a] oublié une grande partie de nos passés, des événements lointains ou du jour même. Et si une chose ne se trouve plus dans l’esprit de Dieu, quelle chance a-t-elle de demeurer dans celui des mortels ? »
Tel est le décor sur lequel se déploie Le Géant enfoui, du Prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro (Ed. des Deux Terres, 2010, rééd. « Folio », 2015). L’écrivain britannique plante son étrange roman onirique dans ce que les Britanniques appellent les dark ages (« âges sombres »), ce moment où, après le départ de l’administration romaine, les structures sociales se disloquent au point que les habitants des îles Britanniques connaissent une « deuxième préhistoire », perdant la conscience même de ce qu’ils n’avaient plus. Une période aussi effroyable que fascinante, en tout cas stimulante pour les imaginaires – c’est à cette époque qu’est censée se dérouler la geste arthurienne.
La Gaule a-t-elle connu, au sortir de la période romaine, ses âges sombres ? C’est ce que pensaient, unanimes, les premiers historiens s’intéressant aux Ve et VIe siècles de notre ère, dans la lignée de Récits des temps mérovingiens (1833), d’Augustin Thierry, qui figèrent, sur un mode agréablement romancé, l’opposition entre l’« esprit de discipline civique » des Romains et les « instincts violents de la barbarie » des Francs. Selon cette historiographie, la victoire de ces derniers fut la cause d’un brutal retour en arrière, en même temps que la première pierre d’un édifice national qu’un jour on appellerait la France.
Cette perception semble soutenue par la baisse spectaculaire, à partir du Ve siècle, du nombre de sources écrites. C’est l’idée qu’en avaient les humanistes de la Renaissance, ce dont témoigne le Pantagruel (1532), de Rabelais. Le père, Gargantua, évoque dans une lettre à son fils « l’infélicité et calamité des Goths, qui avaient mis à destruction toute bonne littérature ». Alors, la civilisation s’est-elle effondrée en Gaule à la fin de l’Empire romain d’Occident ?
Pour l’historien Bruno Dumézil, il se pourrait bien que cette impression ne soit que l’effet d’une illusion d’optique. En introduction de son récent Charlemagne (PUF, 2024), il l’explique par une analogie très frappante : « Imaginons que nous perdions aujourd’hui tous les supports informatiques et numériques. Qu’est-ce que les historiens du futur penseraient de la France du XXIe siècle ? Sans doute estimeraient-ils que son administration était très limitée et que sa culture était essentiellement orale, alors que les IIIe et IVe Républiques seraient érigées en âge d’or puisqu’elles ont laissé des masses de textes écrits sur du papier, un support qui a plus de chance de survivre que les disques durs… »
Révolution du parchemin
Or, c’est exactement ce qu’il s’est passé. Au IVe siècle, les inscriptions officielles gravées disparaissent au profit de caractères peints, naturellement plus périssables. Jusqu’au début du VIIIe siècle, le support dominant pour l’écrit reste le papyrus, qui ne supporte pas l’humidité, et se conserve donc bien mieux sur les bords du Nil que dans l’embouchure de la Seine… Si l’on ne trouve presque pas de production écrite contemporaine des premiers rois francs, rien ne prouve qu’il n’y a rien eu.
A partir du VIIe siècle, une révolution se produit. On commence à utiliser le parchemin, qui vieillit mieux, et soudain les manuscrits redeviennent plus abondants. Mais un autre problème se fait jour : ce support en peau d’animal coûte cher (il nécessite l’entretien de troupeaux de moutons). Ainsi, le soin d’écrire sera-t-il confié à des copistes de métier, membres d’ordres monastiques. Et lorsque ceux-ci auront à recopier les œuvres des penseurs du passé, ils auront tendance à être sélectifs.
Les curiosités d’un moine du VIIIe siècle sont rarement les mêmes que celles d’un historien contemporain. Aussi les spécialistes de la période qu’on l’appelle « haut Moyen Age » ou « Antiquité tardive » sont-ils habitués à se mouvoir dans des territoires incertains, essayant de faire « parler » des textes incomplets ou même fautifs. Bien sûr, il y a parfois des découvertes archéologiques, mais elles ne comblent qu’une petite partie des manques qui sont le quotidien de ces chercheurs.
Ces particularités expliquent que l’histoire de la période soit si sensible à l’air du temps. Au sortir de la déroute de 1870-1871, en France, l’heure était à la stigmatisation des « invasions barbares », avec en tête le souvenir des Prussiens. De leur côté, les historiens allemands qualifiaient ce phénomène de « grandes migrations ». Pour eux, il s’agissait d’un processus certes violent, mais nécessaire, par lequel les tribus germaniques avaient, en déferlant sur l’Europe occidentale, régénéré un monde vieillissant.
A l’issue de la seconde guerre mondiale, l’heure est à l’apaisement et à la construction européenne, donc à la mise en avant d’une histoire moins conflictuelle. Aujourd’hui, la tendance serait d’insister plus sur le caractère très progressif des évolutions, et de mettre en avant les ambiguïtés des notions mêmes de Romains et de Barbares. Pour appréhender les origines de ce royaume qui deviendra la France, il faut donc accepter de naviguer avec une visibilité réduite. Il est également nécessaire de commencer par un retour en arrière, pour voir dans quel contexte les Francs furent « inventés ».
A l’époque de l’empereur Auguste (63 av. J.-C.-14 ap. J.-C.), les frontières occidentales de l’Empire romain se consolident le long du Rhin et du Danube. Elles achèveront de se transformer en un dispositif continu, le limes, au siècle suivant. Ce phénomène a, de l’autre côté de la frontière, une conséquence inattendue : celui de pousser les groupes germaniques à se structurer. « Rien ne prouve la présence des rois avant leurs négociations avec les chefs romains », résume l’historienne Magali Coumert dans l’article « Ethnogenèse » du dictionnaire Les Barbares (PUF, 2016).
A partir du début du IIIe siècle, l’Etat impérial connaît une profonde crise monétaire, qui se double de terribles vagues d’épidémie, tandis que la pression des groupes germaniques sur le limes devient plus forte. Dans le même temps, en Orient, l’essor de l’Empire sassanide en Perse fait peser sur Rome un péril bien plus grand que celui des Barbares germaniques. En l’an 235, avec l’assassinat de Sévère Alexandre et l’extinction de sa dynastie, l’empire entre dans une crise profonde et multiforme. En un demi-siècle, 28 empereurs meurent assassinés ou exécutés.
Auxiliaires zélés
Comment, dès lors, s’étonner que les légions aient du mal à trouver le temps de faire respecter l’ordre aux frontières ? L’anarchie est telle que, de 260 à 274, un éphémère « empire des Gaules » se forme. Les villes jadis ouvertes se recroquevillent derrière des murs d’enceinte pour échapper aux razzias des Barbares et des brigands : la « paix romaine » est bien finie.
C’est dans ce contexte qu’apparaissent pour la première fois, sur les frontières, des guerriers se faisant appeler « francs ». « L’ethnonyme “franc” fut sans doute inventé pour signifier quelque chose comme “hardi” ou “vaillant”. Ce nom étendard s’imposa progressivement pour une confédération extrêmement lâche d’une douzaine de tribus », explique Bruno Dumézil. Le futur empereur Aurélien, alors tribun de la VIe Légion, les aurait défaits à Mayence (Allemagne actuelle). « Il en tua 700 et fit vendre aux enchères 300 des leurs faits prisonniers. » L’épopée glorieuse du peuple franc commence bien…
A partir du règne d’Aurélien (270-275) et surtout de Dioclétien (284-305), la situation se redresse. L’administration de l’empire, réorganisée autour de vastes diocèses, est régénérée. L’armée aussi change de visage. Les 300 000 hommes dont elle disposait au début du IIIe siècle ne peuvent suffire à maintenir l’ordre et à surveiller les frontières. Rome n’a donc pas le choix : pour répondre au défi, il s’appuiera sur un nombre sans cesse plus élevé de guerriers barbares. On voit ainsi apparaître des camps de Germains travaillant pour l’Empire romain à contenir les incursions barbares.
En 340, donc, des Francs saliens sont installés en Toxandrie, la région sablonneuse comprise entre l’Escaut et la Meuse (à cheval sur la Belgique et les Pays-Bas actuels). Sans doute ces hommes de la frontière bénéficiaient-ils d’un foedus, un accord leur octroyant terres et tribut en échange d’une incorporation à l’armée romaine. Devenus les maîtres d’une armée « fédérée », les chefs barbares y disposent d’un grade officiel, ce qui n’empêche pas qu’ils soient toujours considérés comme les rois de leur peuple.
Si, au IIIe siècle, Rome cherchait à combattre les Barbares pour les réduire en esclavage ou les repousser hors de l’empire, au siècle suivant, elle les embauche par groupes entiers. Le changement de physionomie de l’armée est rapide : au début du Ve siècle, on estime que les soldats d’origine romaine ne représentaient plus que le quart des armées impériales.
Dès lors, les Francs se montreront des auxiliaires zélés. Certains d’entre eux, comme Arbogast ou Ricimer, vont diriger des armées et même être élevés à la charge de consul, le poste le plus haut dans le cursus honorum, la hiérarchie des honneurs à Rome. Le tout sans perdre pour autant leur appartenance nationale. Il ne faut y voir aucune contradiction : l’un et l’autre ne s’excluent pas, on peut être à la fois Barbare et citoyen romain. Des familles aristocratiques marient leur progéniture à des enfants de princes germaniques, des esclaves romains fuient leurs maîtres pour se réfugier chez les Barbares, et ceux-ci leur font bon accueil…
Insensiblement, au contact de l’empire, les Barbares se romanisent, tandis que les Romains, eux, deviennent un peu barbares. Les Francs, d’ailleurs, ne restent pas tous cantonnés en Toxandrie. Bientôt, on en trouve dans toute la Gaule du Nord. Ce phénomène n’a rien de nouveau, l’identité romaine n’a jamais été figée : l’empire doit même sa longévité à sa force d’assimilation.
Ces circulations et ces ambiguïtés ont vu leur importance minorée par les historiens du XIXe siècle, qui, ayant placé les « Romains » et les « Barbares » dans des camps opposés, ne pouvaient pas voir le problème sous cet angle. Pour Geneviève Bührer-Thierry et Charles Mériaux (481-888. La France avant la France, Belin, 2010, rééd. Folio, 2019), leur « conception immuable des peuples barbares épousait celle que l’on se faisait au XIXe siècle de la nation, Romains et Barbares étant considérés à l’aune du choc des nationalismes que connaissait alors l’Europe ». Autrement dit : les historiens français et allemands, en évoquant la chute de Rome, avaient tendance à rejouer, à quinze siècles de distance, la guerre de 1870.
Incursions et razzias
Revenons au IVe siècle. L’Empire romain, désormais divisé en deux, Orient et Occident, semble durablement refondé et consolidé autour de la foi chrétienne. Mais la défaite et la mort de l’empereur Valens (328-378) face aux Goths, à Andrinople (actuelle Edirne, en Turquie), le 9 août 378, constitue un rude coup de semonce. Les vainqueurs ne sauront pas quoi faire de leur victoire. Si bien que Théodose (347-395), le successeur de Valens, réussit à rétablir la situation, accordant aux mêmes Goths, en 382, un foedus qui les installe en Mésie (Bulgarie et Serbie actuelles). Mais même s’ils deviennent donc, sur le papier, une des composantes de l’empire, ils savent désormais que Rome n’est pas invincible. D’ailleurs, ils ne cessent pas les incursions et les razzias.
Au début du Ve siècle, les mouvements de population sur le limes occidental se font de plus en plus intenses, et, le 31 décembre 406, tandis que le Rhin est pris par les glaces, plusieurs dizaines de milliers de Vandales, d’Alains et de Suèves traversent le fleuve et déferlent sur les Gaules. Les auxiliaires francs qui essaient de s’interposer sont balayés. A ce moment-là du récit, la situation devient confuse, d’autant que la principale source dont les historiens disposent, saint Jérôme, évoque les événements dans sa correspondance, de sa lointaine retraite de Bethléem, en Galilée.
En Italie, les dissensions entre l’empereur Honorius (384-423) et son général, le Goth Alaric, dégénèrent au point de provoquer le siège, puis la mise à sac de Rome, en 410, qui aura un retentissement immense. Ensuite, après la mort de leur roi, les Barbares, désormais dirigés par un certain Athaulf (372-415), se dirigent vers l’Aquitaine, d’où ils chassent (ou absorbent) les Barbares concurrents. Le royaume wisigoth ainsi formé, consacré par un foedus en 418, deviendra en Occident, pour trois siècles, un pilier de la romanité.
Plus à l’est, Rome installera autour des vallées du Rhône et de la Saône un autre peuple, celui des Burgondes, qui constituera un royaume et deviendra vite un acteur incontournable des intrigues politiques de la péninsule italienne. Dans le nord de la Gaule, en revanche, la situation est moins claire. Les Francs ne disposent pas d’un royaume à proprement parler, ils semblent pour la plupart rester loyalistes, et leurs roitelets cohabitent de façon relativement apaisée avec les autorités répondant encore directement à l’administration impériale.
Au cours du Ve siècle, les vieilles élites gallo-romaines se trouvent donc confrontées à l’arrivée de nouveaux acteurs, qui occupent vite une grande partie du pouvoir. Sidoine Apollinaire (430-486) est l’un des plus illustres représentants de cette élite menacée. Grand propriétaire terrien et fin lettré, issu de la plus haute noblesse de Gaule, il exercera lui-même de hautes charges à Rome, dont celle de préfet de la ville, en 467, et finira sa vie comme évêque de Clermont.
Mais, dans les années 460, il se lamente auprès d’un sénateur romain du nom de Catullinus : « Pourquoi me demandes-tu de composer – en serais-je même capable ? – un poème en l’honneur de Vénus (…) quand je vis au milieu de hordes chevelues, que j’ai à supporter leur langage germanique et à louer incontinent, malgré mon humeur noire, les chansons du Burgonde gavé, qui s’enduit les cheveux de beurre rance ? (…) Heureux tes yeux et tes oreilles, heureux aussi ton nez, toi qui n’as pas à subir l’odeur de l’ail ou de l’oignon infect que renvoient dès le petit matin dix préparations culinaires. »
Dans ces lignes, l’aristocrate a la dent dure. Mais il lui est également arrivé, avant et après cette diatribe, de se montrer extrêmement obséquieux, voire flagorneur, envers les rois wisigoths, quand ses propriétés – ou sa survie politique – étaient en jeu…
L’irruption de ces tribus germaniques en Gaule ne s’est pas faite sans violence, loin de là, mais les propriétaires terriens n’eurent d’autre choix que de s’entendre avec les nouveaux arrivants, et ces derniers cherchèrent à donner à leur domination le visage de la continuité. Par le lien du foedus, les royaumes barbares qui se mettent en place ne sont-ils pas partie intégrante de l’empire ?
S’il fallait illustrer par un portrait individuel cette lente fusion des peuples et des identités, on brosserait sans doute celui du roi franc Childéric, mort en 481 ou en 482, soit cinq ans environ après la fin de l’Empire romain d’Occident. Au printemps 1653, un ouvrier travaillant sur un chantier de rénovation, près de l’église Saint-Blaise, à Tournai, aujourd’hui en Belgique, découvre par le plus grand des hasards la tombe de ce roi oublié, renfermant un trésor. Un chanoine de la cathédrale, alerté, parvient à en récupérer la plus grande partie et l’expédie à son père, Jean-Jacques Chifflet, médecin personnel de l’archiduc des Pays-Bas espagnols. L’homme de science comprend tout de suite l’intérêt exceptionnel de cette trouvaille et entreprend d’en publier l’inventaire sous le titre de « Résurrection du roi des Francs Childéric Ier ».
Qu’a-t-on trouvé à côté des restes de ce chef franc, père de Clovis et fondateur de la dynastie mérovingienne ? D’abord, une multitude de pièces d’orfèvrerie cloisonnée de grenats et un grand nombre d’objets zoomorphes, figurant des insectes – peut-être des abeilles – dont on pense qu’ils étaient cousus sur un manteau. La tombe renfermait également des armes : une lance, une hache de guerre et une épée longue. On trouve également un sceau le représentant, glabre mais les cheveux longs – les élites romaines traditionnelles portaient les cheveux courts –, portant la légende Childerici regis, « du roi Childéric ». Tout l’attirail, donc, d’un roi barbare, mais une inscription en latin.
Volonté d’intégration
D’autres éléments de l’inventaire sont incontestablement romains : ainsi, sur le portrait qui orne le sceau, le guerrier franc revêt le manteau large des généraux de l’armée romaine, fermé par la classique fibule d’or en forme de croix. Enfin, Childéric a été enterré avec une centaine de pièces d’or, dont la plupart avaient été frappées à Byzance, au nom de l’empereur Zénon (425-491), sans doute pour rappeler le foedus, régulièrement renouvelé, qui lie les Francs à Constantinople. Pour Geneviève Bührer-Thierry et Charles Mériaux, « il ne fait aucun doute que le défunt et ceux qui présidèrent ses funérailles, au premier rang desquels devait figurer son fils Clovis, entendaient donner de lui l’image d’un chef romain ».
Les chefs de guerre barbares en train d’imposer leur domination sur les Gaules voulaient faire partie de l’empire, pas le mettre à bas. Cette volonté d’intégration ira, au siècle suivant, jusqu’à susciter l’écriture de curieux récits des origines. Celui des Francs, que la tradition attribue à un certain Frédégaire, a sans doute été composé au milieu du VIIe siècle, et il mérite que l’on s’y arrête. Selon ce texte, les Francs auraient une origine troyenne – ce qui ferait d’eux de lointains cousins des Romains, qui, eux, ont pour ancêtre le héros troyen Enée. Bref, tout sauf des Barbares.
Frédégaire mentionne la présence d’un héros nommé Francion, puis explique qu’après la fin de la guerre de Troie les Francs se seraient rendus sur les bords du Rhin sans jamais, au cours de cette longue migration (ni après), se mêler aux Barbares. « La source de ces récits réside assurément dans l’historiographie classique, notamment L’Enéide [de Virgile], et le matériau ne découle en aucun cas de traditions orales franques », assure Bruno Dumézil. Cette théorie, à laquelle aucun esprit sensé ne peut accorder le moindre crédit, sera pourtant acceptée comme l’origine officielle de la monarchie française pendant plus d’un millénaire.
Vestige d’un temps révolu dont nul ne comprenait plus les codes, le trésor de Childéric avait tout pour enflammer les imaginaires. En 1665, l’empereur Léopold Ier le fit envoyer au roi Louis XIV comme un cadeau du plus haut prix, afin de remercier la France pour l’aide qu’elle lui avait offerte contre les Turcs, un an plus tôt. Et lorsque, en mai 1804, un grand conquérant nommé Napoléon Bonaparte décide de se faire couronner empereur des Français, il entreprend d’y chercher un symbole permettant de faire oublier la fleur de lys, qui évoquait trop le règne des Capétiens. Sur les conseils de son ami Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, il jette son dévolu sur l’abeille, inspiré par les insectes d’or retrouvés en nombre dans le trésor de Childéric. Le directeur du Louvre, Dominique Vivant Denon, est chargé d’en faire un dessin qui sera brodé au fil d’or sur le manteau de velours rouge porté lors du sacre en la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804.
Ce que les érudits de l’époque ne pouvaient pas savoir, c’est que ce motif, qui n’avait rien de romain, n’était pas franc non plus. Plusieurs découvertes archéologiques postérieures dans les régions danubiennes ont permis d’en faire ce que l’historien Michel Rouche appelait un « marqueur de la civilisation alano-hunnico-germanique de la première moitié du Ve siècle ». Ainsi donc, le trésor de Childéric renfermait-il encore plus d’influences qu’on ne pouvait le croire au début du XIXe siècle. Et Napoléon, qui croyait faire un clin d’œil à Clovis en exhumant cette abeille, avait en fait récupéré un symbole associé au plus terrible des Barbares : Attila.
En novembre 1831, le Cabinet des médailles, où était entreposé le trésor, est cambriolé. Les malfaiteurs emportent la plupart de ces précieuses reliques, qui ne seront jamais retrouvées. L’enquête démontrera que les malfaiteurs ont fondu les pièces d’or, pour en faire des lingots.
[Source: Le Monde]