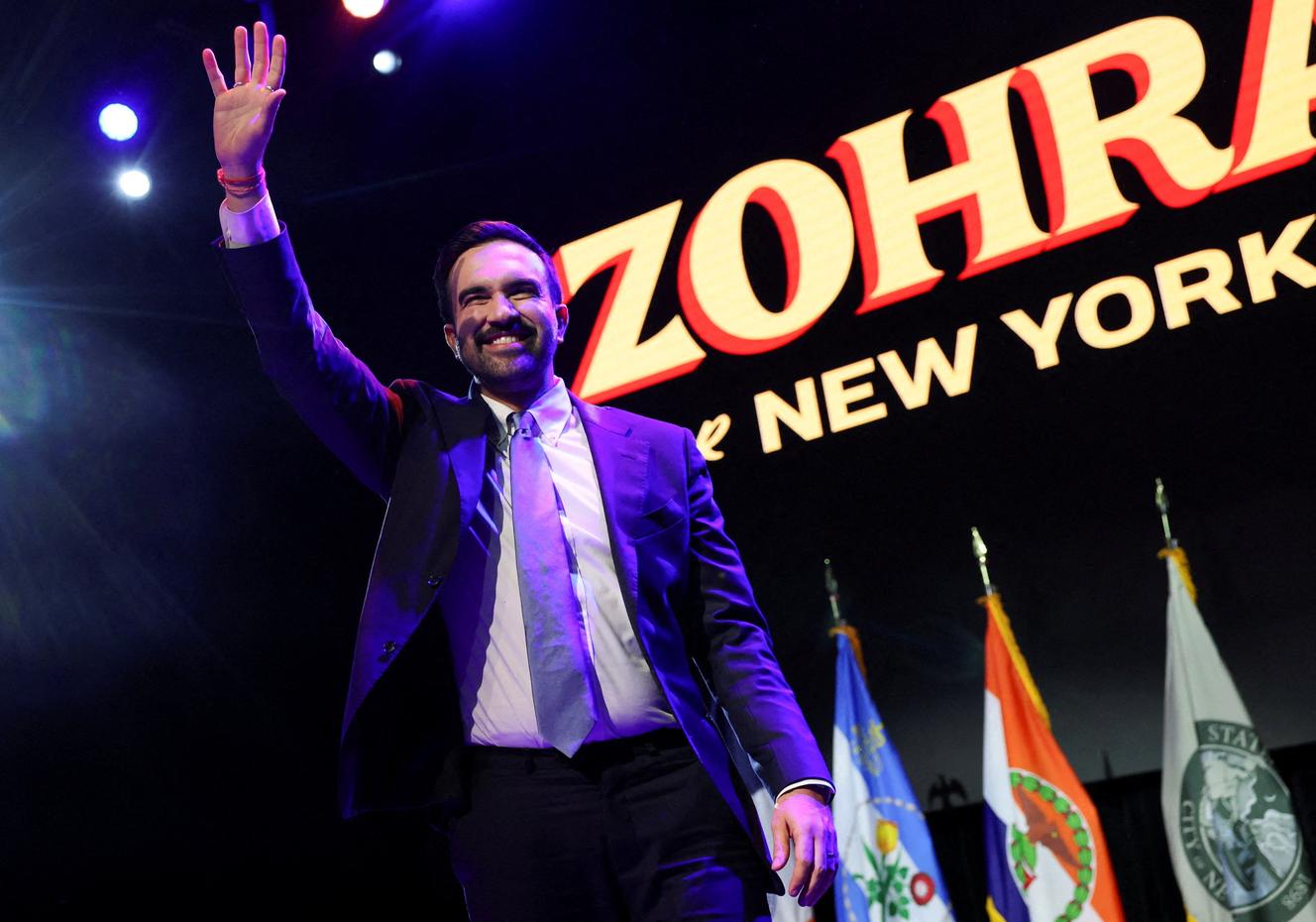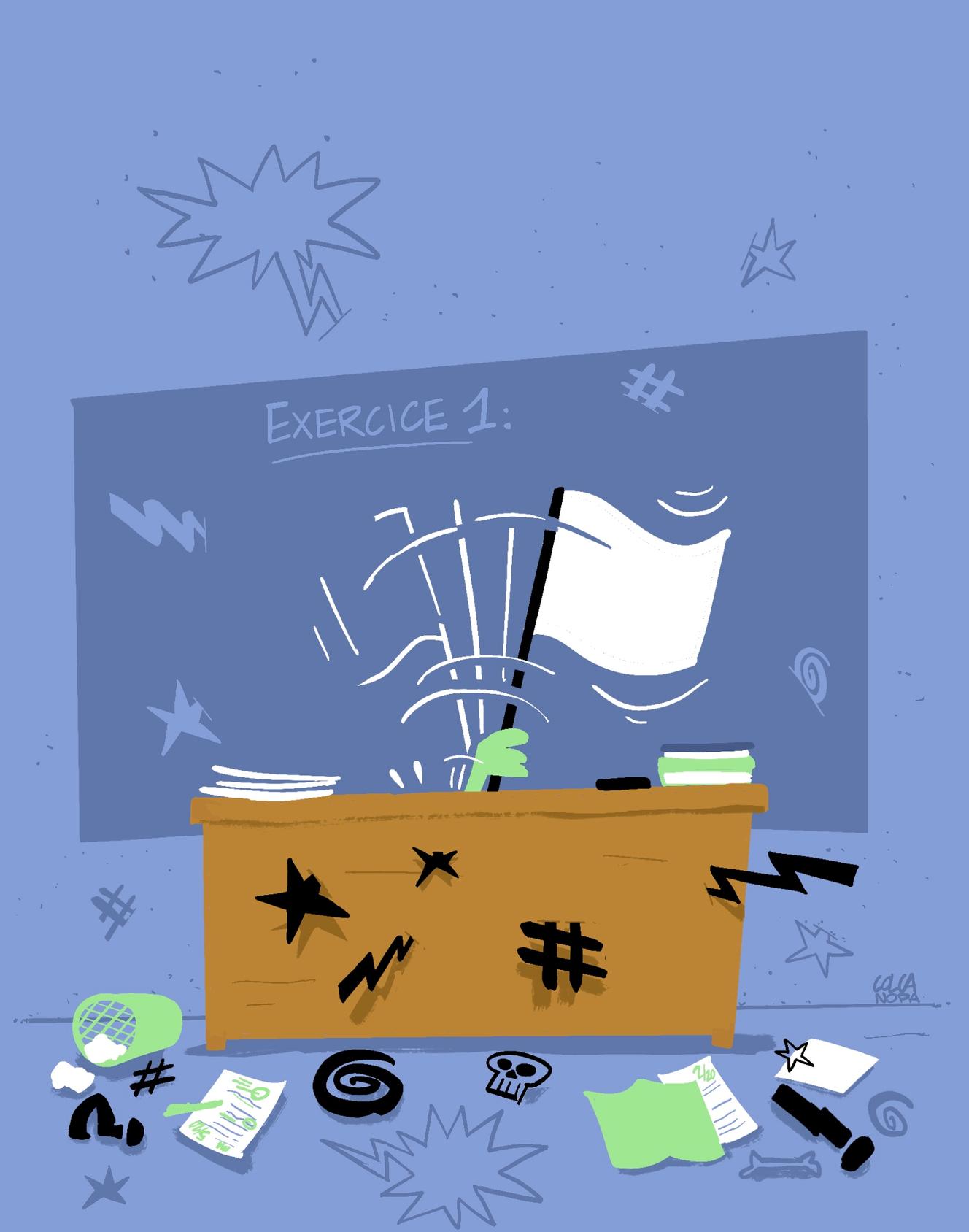De Katmandou au Caire : les manifestations du génération Z et l'appel mondial à la transparence
Dr Sirwan Abdulkarim Ali / Analyste politique et chercheur - traduit par EDGEnews.

Au cœur de Katmandou, le soulèvement incessant de la jeunesse népalaise a déclenché une vague de manifestations qui résonnent bien au-delà des frontières du pays. Ce qui a commencé début 2022 comme des manifestations pour la liberté d'expression et contre la frustration économique s'est depuis transformé en un mouvement qui symbolise le pouvoir de la jeunesse d'aujourd'hui, cette génération mondiale née dans un monde connecté, éduquée dans l'incertitude et déterminée à lutter contre la corruption. Ces jeunes Népalais, qui réclament la transparence, des opportunités d'emploi et des libertés démocratiques, reflètent les luttes familières aux citoyens du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Tout comme le Printemps arabe il y a dix ans a ébranlé des régimes bien établis, de la Tunisie à l'Égypte, le soulèvement au Népal met en évidence une vérité commune : à l'ère numérique, les jeunes n'acceptent plus le silence ou la répression. La brutalité des autorités népalaises, qui a entraîné la mort de plusieurs manifestants et blessé des centaines d'autres, n'a fait que renforcer la détermination de ces jeunes militants. Leur combat n'est pas isolé ; il s'inscrit dans un réveil générationnel plus large où la technologie, l'éducation et la frustration pure et simple convergent pour alimenter les revendications en faveur de la dignité.
Le monde a déjà été témoin de ce scénario. Lorsque les jeunes Arabes se sont soulevés contre les dictatures en 2011, ils étaient animés par la colère face à la censure, au chômage et à la corruption étouffante qui les privait de leur avenir. Aujourd'hui, au Népal, les échos sont indéniables : réseaux sociaux bloqués, diplômés sans emploi, coût de la vie en hausse et gouvernement peu disposé (ou incapable) de s'adapter aux nouvelles réalités. Ces éléments créent le même mélange explosif qui a alimenté les manifestations de la place Tahrir au Caire à l'avenue Bourguiba à Tunis. Le Népal peut sembler très éloigné du Moyen-Orient, mais les problèmes structurels tels que la corruption, les libertés restreintes et le manque de réactivité des dirigeants sont étonnamment familiers. Les jeunes d'aujourd'hui sont même encore plus connectés que leurs prédécesseurs de 2011. Grâce à TikTok, Twitter et Instagram, les mouvements peuvent se propager au-delà des frontières en quelques heures, rendant presque impossible pour les régimes autoritaires de contrôler le discours. La leçon est claire : lorsque les gouvernements privilégient le secret à la transparence, ils sèment les graines d'un soulèvement qu'aucun déploiement militaire ni aucun couvre-feu ne peut contenir.
Ce qui se passe au Népal n'est pas unique, mais s'inscrit dans une tendance mondiale de résistance menée par les jeunes. En Amérique latine, les étudiants chiliens ont déclenché des réformes radicales en se mobilisant contre les inégalités. Au Soudan et en Algérie, de jeunes manifestants ont défié les régimes militaires, faisant écho aux revendications en faveur de la justice. Partout en Afrique, du mouvement #EndSARS au Nigeria aux soulèvements étudiants en Afrique du Sud, la jeune génération a remis en cause les structures oppressives. En Asie, de Hong Kong au Sri Lanka, les mouvements menés par les jeunes ont ébranlé les gouvernements et redéfini les limites de l'action civique. Toutes ces luttes convergent vers des thèmes communs : la corruption, le chômage, la censure et la demande de transparence. Les manifestations au Népal constituent donc à la fois une lutte locale et un signal mondial, nous rappelant que l'ère de la jeunesse passive est révolue. Lorsque près de la moitié de la population de nombreux pays a moins de 25 ans, les gouvernements ne peuvent pas s'attendre à ce qu'elle reste silencieuse. Au contraire, ils sont confrontés à une génération qui transformera les réseaux sociaux en mégaphone, transformant des griefs isolés en solidarité internationale.
Au cœur de ces soulèvements se trouve un seul mot : transparence. Pendant des décennies, les gouvernements du Moyen-Orient, d'Afrique et de certaines régions d'Asie ont fonctionné dans l'opacité, ce qui signifie censure, accords secrets et structures de pouvoir opaques. Mais la décennie à venir ne laisse aucune place à de telles pratiques. La technologie permet de dénoncer la corruption plus rapidement que jamais, que ce soit par le biais de fuites de documents, de vidéos virales montrant des brutalités policières ou de reportages d'investigation partagés instantanément en ligne. L'activisme des jeunes d'aujourd'hui démontre que la transparence n'est pas un luxe. C'est la seule alternative au chaos. Au Népal, la tentative du gouvernement de faire taire les manifestants en interdisant les réseaux sociaux s'est retournée contre lui, amplifiant la colère et augmentant la participation. Au Moyen-Orient, les gouvernements qui résistent à la transparence sont confrontés à des risques croissants de nouvelles révoltes de type « printemps arabe ». Le message est clair : au cours des dix prochaines années, les régimes qui ne s'ouvrent pas à la surveillance, à la responsabilité et à la participation des jeunes se retrouveront balayés par les mêmes forces qui secouent actuellement Katmandou.
Les manifestations au Népal, menées par de jeunes personnalités courageuses comme Sushila, ne concernent pas seulement un pays, mais reflètent une demande générationnelle de changement. Des vallées du Népal aux rues de Bagdad, Khartoum et Bogotá, les jeunes réécrivent le scénario politique du XXIe siècle. Leur soulèvement prouve que l'éducation, la connectivité et le courage peuvent bouleverser même les systèmes de corruption les plus enracinés. Tout comme le Printemps arabe a rappelé au monde que l'autoritarisme a ses limites, le mouvement de jeunesse népalais souligne le caractère inévitable de la transparence comme fondement de la gouvernance au cours de la prochaine décennie. Les gouvernements ne peuvent plus compter sur la censure, l'intimidation ou les promesses vaines. Les manifestations nous montrent que l'avenir appartient à ceux qui prônent la responsabilité et donnent du pouvoir à leurs jeunes, et non à ceux qui les réduisent au silence. Ce qui a commencé à Katmandou pourrait bientôt trouver un écho à travers les continents, comme un avertissement et une promesse : la prochaine révolution mondiale sera transparente, ou elle sera imparable.
[Traduit de l'anglais par EDGEnews]