« Enseigner en paix », un « graal » pour les enseignants confrontés aux tensions croissantes avec les élèves et leurs familles
Quelle attitude avoir face aux insultes, aux incivilités, au chahut ? De nombreux enseignants se disent démunis. A Paris, 80 personnes ont échangé, lors d’ateliers mis en place par le centre ReSIS.
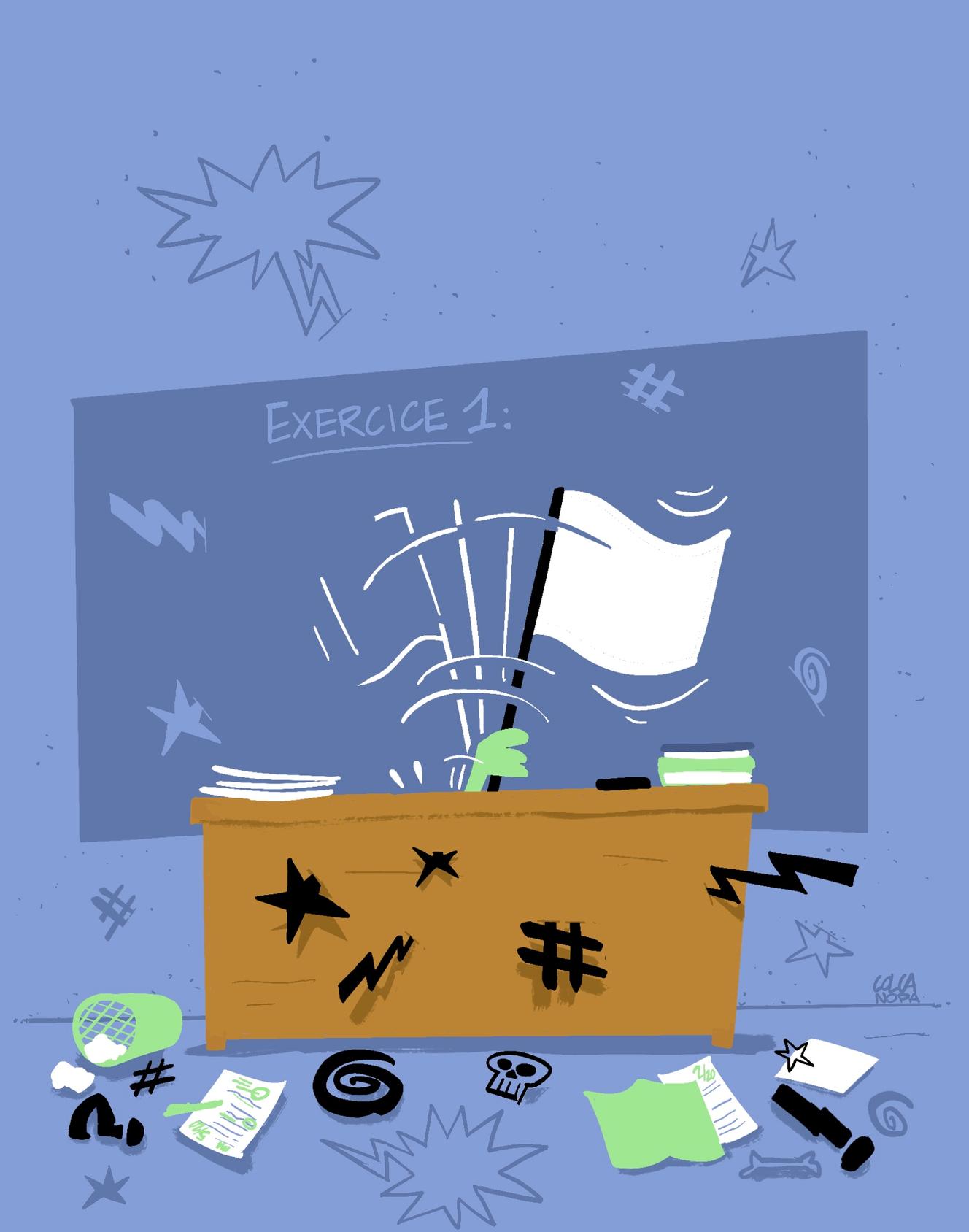
Cécile Aubertin l’avoue sans ambages : « Je me suis trompée dans les grandes largeurs. » La principale d’un collège de l’académie de Nancy-Metz a été confrontée, il y a un an, à une classe dite difficile. Plusieurs élèves perturbaient sans cesse les cours et rivalisaient d’insultes et d’insolence sans qu’aucun enseignant ne parvienne à les mettre au travail. La cheffe d’établissement décide alors d’une visite surprise dans la classe pour impressionner les collégiens. Elle convoque solennellement devant toute la classe les élèves incriminés dans son bureau. Mais cette démonstration autoritaire « n’a pas eu l’effet escompté », raconte-t-elle aujourd’hui avec le sourire : « Les élèves l’ont vécu comme une humiliation, comme un défi, et le désordre a redoublé. »
La principale a alors changé de braquet et appelé le centre ReSIS, une association financée par du mécénat qui travaille sur les souffrances scolaires, afin d’expérimenter des protocoles sur les classes difficiles. Leur dispositif en cinq étapes vise à construire avec les élèves, y compris les plus perturbateurs, des propositions pour sortir des conflits. « Cela n’a pas été miraculeux mais a apaisé le climat de la classe », juge Cécile Aubertin.
Jeudi 30 octobre, la cheffe d’établissement partage son expérience avec 80 autres personnels de l’éducation. Ces enseignants, administratifs, personnels de direction de l’enseignement public comme privé participent à deux journées de formation proposées par le centre ReSIS à Paris. Baptisés « Enseigner en paix », les ateliers balaient toutes les problématiques liées aux incivilités : « faire face à l’insolence et au chahut », « faciliter les relations avec les parents d’élèves », « oser punir-savoir punir » ou encore « travailler avec les classes difficiles ».
« Seuls » et « mal formés »
Les enquêtes récentes, qu’elles émanent du ministère ou d’acteurs de l’éducation, montrent une dégradation du climat scolaire et une montée des violences. Les participants à ces deux journées le ressentent, certains parlent même désormais de la « violence du métier ».
« Enseigner en paix, c’est un peu le graal », glisse une professeure des écoles qui a pris place dans une des salles de classe du collège Valmy, déserté par les élèves en ces vacances de la Toussaint. Selon la dernière enquête Talis (« Teaching and Learning International Survey ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), publiée en octobre, les enseignants français, qui sont parmi ceux qui font le plus face aux élèves perturbateurs, sont aussi les moins bien formés à la gestion de classe.
Chacun des participants est venu en quête d’outils pour pallier les difficultés liées aux élèves et à la gestion des classes. Les professionnels se sentent souvent désarçonnés face à des situations conflictuelles qui peuvent s’enkyster. Ils se disent « perdus », « seuls » et « mal formés » pour traiter ces difficultés.
Devenu professeur de mathématiques, il y a sept ans, après une première carrière d’ingénieur, Jean-Marie (les personnes citées par leur prénom souhaitent rester anonymes) a « appris sur le tas » la gestion des classes « à son détriment et à celui des élèves », assure-t-il, plus affirmé désormais. Néanmoins, reconnaît-il, « parfois on obtient le calme, mais au prix d’une vigilance et d’une attention de tous les instants qui nous empêche de pouvoir expliquer en détail à un élève un point qu’il n’a pas compris ».
Ces difficultés traversent tous les milieux. Cendrine Cros en a fait l’expérience. Après quinze années passées en éducation prioritaire, l’enseignante a rejoint une école privée sous contrat dans le centre de Paris. « Les élèves de milieux populaires peuvent connaître la violence en dehors de l’école et la transposent dans la classe. Mais la violence existe aussi dans les classes privilégiées par une compétition et une concurrence exacerbées. »
Conflits croissants avec les parents
Près de 15 % du personnel de l’éducation se dit aujourd’hui victime de moqueries ou d’insultes, selon une enquête de l’éducation nationale parue en juillet. « Mais le sujet reste largement tabou. Beaucoup d’enseignants n’osent pas faire état de leurs difficultés, de peur d’être jugés incompétents », souligne François Poisson, formateur au centre ReSIS. Il préconise la mise en place de protocoles pour savoir réagir en cas d’invectives, « comme cela existe dans les autres administrations ».
« Quand je suis entrée dans le métier, je ne faisais pas face à autant d’insultes qu’aujourd’hui », témoigne Noria, après vingt ans dans l’éducation nationale. Cette directrice adjointe chargée de la classe Segpa (Section d’enseignement général et professionnel adapté) a vu le climat scolaire de son établissement se dégrader pendant deux ans. Cris, bagarres, retards rythmaient le quotidien du collège. L’équipe éducative a alors décidé d’agir. Depuis la rentrée, « cinq règles d’or » ont été mises en place, dont « s’adresser à un adulte avec respect » ou encore « laisser sa place propre ». Chaque infraction coûte un point sur une note comptée dans la moyenne (excepté pour les 3e qui passent le brevet). « On en voit les premiers effets », se réjouit-elle.
Les conflits croissants avec les familles, qui ressortent de toutes les discussions, compliquent la donne. Il y a ce parent qui vient exprimer sa colère en s’approchant à quelques centimètres du visage de la cheffe d’établissement ou cette famille qui, mécontente d’une remarque de la professeure des écoles, se répand sur le groupe WhatsApp de la classe et ligue les parents contre l’enseignante. « Tout peut être mal interprété et sujet à rumeurs. Les parents croient sur parole leurs enfants, s’appellent entre eux. Quand ils arrivent dans l’établissement pour nous voir, ils ont une idée précise de ce qu’il s’est passé et ne veulent pas écouter d’autres points de vue », relate Sarah. Cette proviseure adjointe d’un lycée français en Afrique éprouve la « perte de légitimité » du personnel de l’éducation face aux élèves et à leurs parents. « Si quelque chose se passe mal, c’est forcément de notre faute », s’agace-t-elle.
Les réseaux sociaux peuvent alors encore tendre les situations. « Nous sommes amenés à gérer des cas qui commencent en dehors du cadre scolaire », remarque Emilie, coordinatrice Ulis (Unités localisées d’inclusion scolaire) dans l’académie d’Amiens. Cette enseignante a dû intervenir auprès d’une mère de famille qui avait menacé un élève par le biais des réseaux sociaux de sa fille. « Elle avait donné rendez-vous à l’adolescent devant le collège pour en découdre. J’ai dû lui faire reprendre raison. »
« Sur la défensive »
« Les enseignants sont tellement accusés de tout qu’ils sont sur la défensive. Plus personne ne fait confiance à personne », résume Cécile Aubertin. Le personnel de l’éducation réuni au collège Valmy s’interroge : comment restaurer ce lien de confiance avec les élèves, avec les familles et comment, par ce lien, asseoir leur autorité ? Cette autorité repose sur « la courtoisie » et « la fermeté », leur rappellent les formateurs, qui s’inspirent des méthodes de lutte contre le harcèlement face à tous ces « désordres scolaires ».
Jean-Pierre Bellon, directeur général du centre ReSIS et aussi inspirateur de Phare, le programme de lutte contre le harcèlement à l’école aujourd’hui déployé massivement par l’éducation nationale, fait aisément le parallèle : « Les souffrances des élèves et celles des professeurs se ressemblent et interagissent les unes avec les autres. » Pour le philosophe, il faut « ouvrir la boîte noire que représente la classe » car « là où l’élève victime de harcèlement est le plus mal, c’est dans une classe où l’enseignant est chahuté ».
La place et la nature de la sanction font toutefois débat, alors que chaque enseignant applique le plus souvent des critères qui lui sont propres. « Il faut un cadre clair, des sanctions explicites, graduelles et partagées à l’échelle d’un établissement », prône Jean-Pierre Bellon.
[Source: Le Monde]


















































