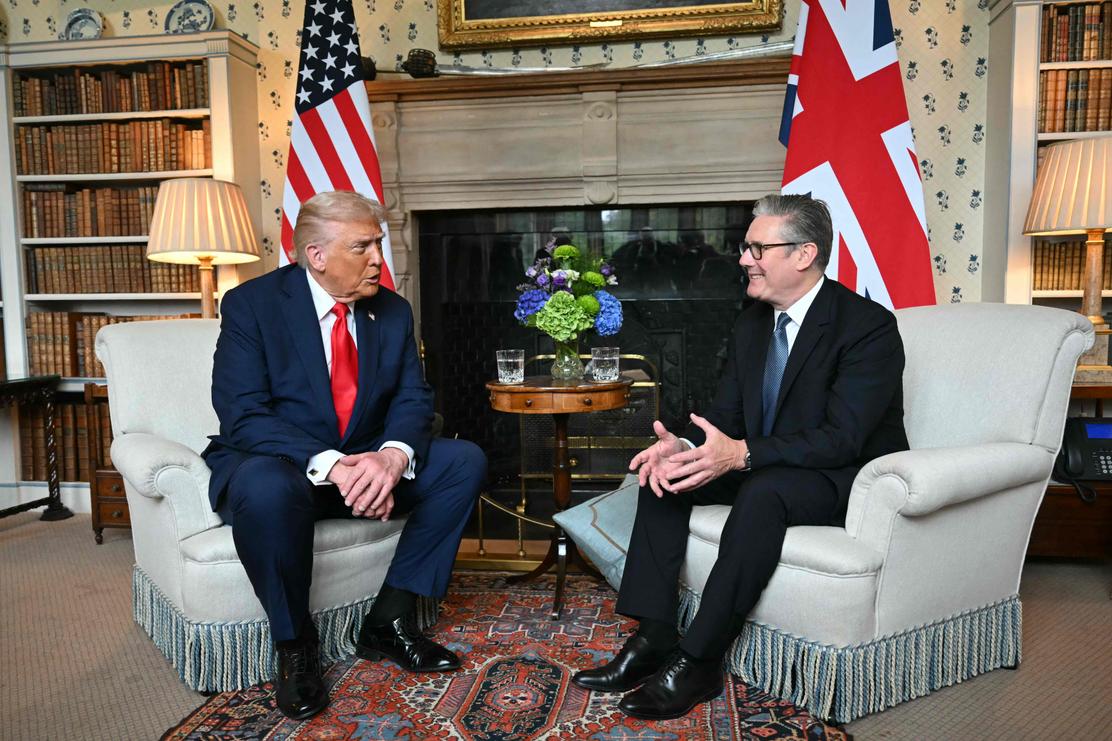A Trinité-et-Tobago, « on se demande si on va être pris pour cible quand on part pêcher »
Les frappes américaines sur des bateaux circulant dans la mer des Caraïbes accusés de convoyer de la drogue inquiètent certains pêcheurs du pays insulaire, proche du Venezuela, quand d’autres les justifient. Un Trinitéen a été tué.

Sous le préau de la centrale de pêche de Las Cuevas, sur la côte nord de l’île de Trinidad, Rosales (qui n’a pas souhaité donner son nom), 30 ans, a les doigts tailladés par le Nylon des filets de pêche. Jeudi matin 30 octobre, comme chaque jour, il a sorti son bateau. « Mais j’ai changé mes habitudes. Je ne vais plus pêcher à l’est, vers le Venezuela, et je ne m’éloigne pas au large », dit-il en contemplant la mer. Depuis que l’armée américaine a commencé à bombarder des embarcations dans la mer des Caraïbes, les pêcheurs de la petite nation insulaire sont à cran.
Samedi, le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, a annoncé qu’un nouveau bateau suspecté de convoyer de la drogue avait été détruit au large du Venezuela et de Trinité-et-Tobago. Ses trois occupants sont morts, portant à 64 le nombre de victimes de la campagne de frappes engagée depuis début septembre. Le président américain, Donald Trump, présente ces attaques comme nécessaires pour endiguer le flux de drogue vers les Etats-Unis.
Ces frappes divisent les pêcheurs. Les uns s’écartent des zones sensibles, redoutant d’être pris pour des trafiquants. Les autres soutiennent ces tirs et assurent que la technologie employée rend impossible la confusion entre pêcheurs et narcotrafiquants. Lynette Burnley, 53 ans, est en colère. « Dès que Trump voit un bateau, il dit qu’il transporte de la drogue. Comment peut-il le savoir ? S’il le fait exploser, il n’y a plus de preuves, il n’y a plus rien ! », s’emporte-t-elle, les yeux humides. Son neveu, Chad Joseph, est la première victime trinitéenne présumée des bombardements américains dans la région. Parti travailler quelques mois plus tôt au Venezuela, le jeune homme avait annoncé son retour par mer. Son corps n’a pas été retrouvé.
« Prêts à rembourser »
L’île de Trinité se trouve à une douzaine de kilomètres des côtes vénézuéliennes. Les allers et retours entre les deux nations caribéennes sont monnaie courante. « Les Américains peuvent arrêter les bateaux et enquêter. Mais ils ne peuvent pas accuser sans preuve les gens, ils ne peuvent pas les tuer comme des chiens », continue Lynette Burnley, qui oscille entre le faible espoir de revoir son neveu et la résignation face à son absence. L’opération américaine a eu lieu le 14 octobre. Le portable de Chad Joseph a cessé d’émettre au même moment.
A Cumana, sur la côte est de l’île, peu de temps après le premier bombardement américain, début septembre, la mer a rejeté sur le rivage un corps brûlé auquel il manquait un pied et une main. « On avait déjà récupéré des corps de noyés, mais jamais un corps dans un tel état, c’est effrayant », raconte Miguel Pavi, un pêcheur d’une quarantaine d’années. Plus éloignée du continent, Cumana est un peu à l’écart des routes habituelles du narcotrafic. Mais l’alerte y est aussi montée d’un cran. « Tous les pêcheurs sont inquiets, affirme-t-il, on se demande si on va être pris pour cible quand on part pêcher. Mais on n’a pas le choix : on doit sortir en mer, on a des prêts à rembourser, une famille à faire vivre. »
A Carenage, un petit village dans le golfe de Paria fait face à la côte vénézuélienne. A la centrale de pêche, beaucoup soutiennent Donald Trump et ses frappes. « Soyons sérieux !, s’emporte Christopher Calder, un sexagénaire à la retraite. Un bateau avec quatre, cinq ou même six moteurs qui fonce plein gaz, ce n’est pas un bateau de pêche ! Les Américains savent ce qu’ils font. » C’est également l’avis de la première ministre, Kamla Persad-Bissessar, qui a déclaré début septembre, après la première frappe américaine dans les Caraïbes : « Je n’ai pas de sympathie pour les trafiquants, les Etats-Unis devraient tous les tuer violemment. »
Signal politique
A Genève, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a déclaré, vendredi 31 octobre, que les frappes aériennes américaines dans les Caraïbes et le Pacifique « viol[ai]ent le droit international des droits de l’homme » et a demandé l’ouverture d’une enquête.
Le rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) constate que la route au large du Venezuela alimente surtout les flux vers l’Europe, tandis que vers les Etats-Unis l’acheminement passe davantage par le Pacifique et la voie terrestre d’Amérique centrale. D’où la question qui revient chez nombre d’experts et de pêcheurs : pourquoi concentrer autant de puissance de feu dans la mer des Caraïbes ?
A Port of Spain, la capitale de Trinité-et-Tobago, l’expert régional en sécurité et ancien officier de la défense trinitéenne, Garvin Heerah, considère qu’il faut distinguer lutte antidrogue et stratégie géopolitique. « Quand on voit des navires comme l’USS Gerald-Ford entrer dans la zone territoriale, des avions, des sous-marins, la redirection de satellites, on se pose la question : s’agit-il vraiment de lutte contre le trafic de drogue ou y a-t-il un enjeu plus large ? », interroge-t-il. Si les frappes se concentrent dans la région, c’est peut-être pour envoyer un signal politique à Caracas.
Assis près des coques de bateau remontées sur la plage de Carenage, Kevin Jack, un ouvrier, pêcheur occasionnel venu retrouver des amis, partage ces inquiétudes. « Je ne suis pas effrayé par les bombardements des bateaux, ce qui me fait peur, c’est que les Etats-Unis bombardent le Venezuela, dit-il. Trinité-et-Tobago est trop petit, il va devoir choisir son camp. » Dans le sud de l’île, sur la péninsule d’Icacos, les gardes-côtes ont demandé aux pêcheurs de ne pas dépasser la limite de 2 milles nautiques des côtes, compliquant encore un peu plus le quotidien des pêcheurs.
[Source: Le Monde]