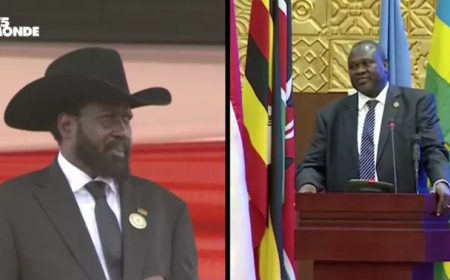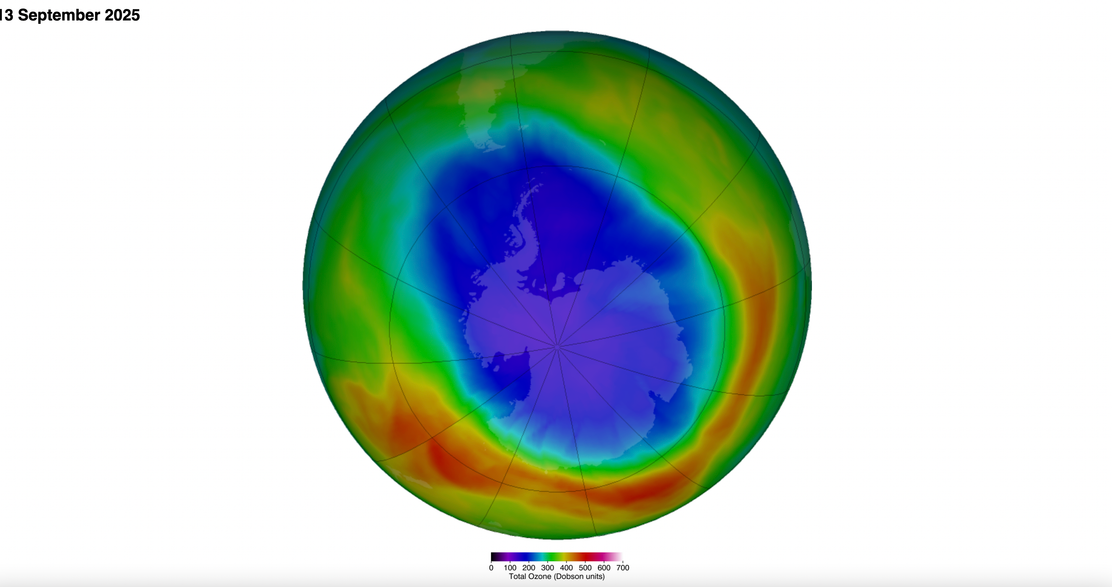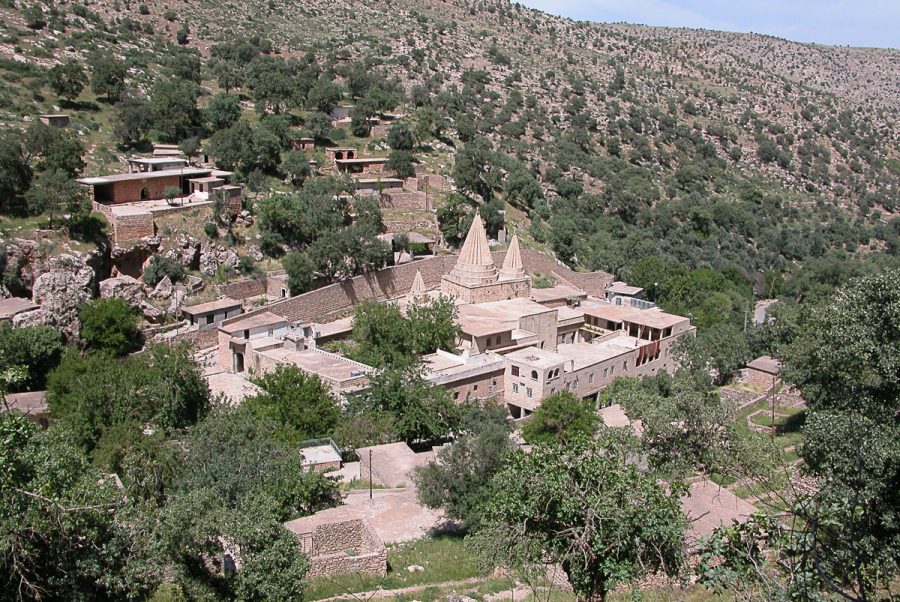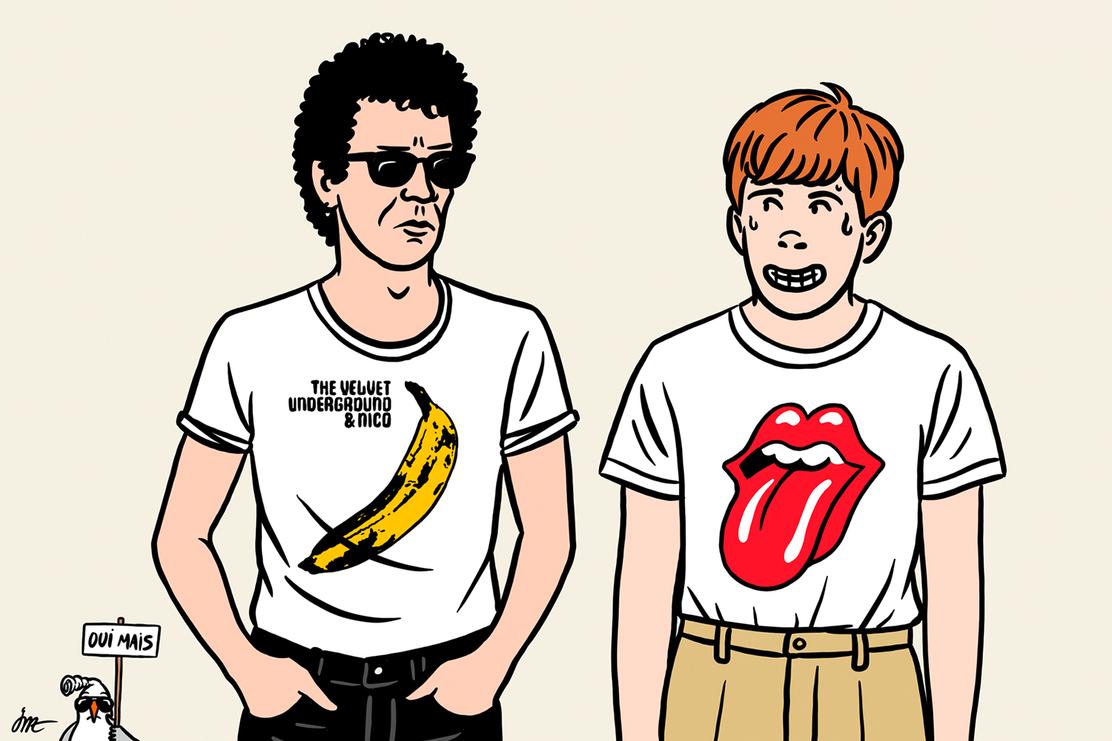Le net recul du désir d’enfant des Français, un constat aux répercussions multiples
Selon une étude de l’INED publiée mercredi, le nombre idéal d’enfants est passé de 2,7 à 2,3, en moyenne, en vingt-cinq ans. Une baisse importante et particulièrement marquée chez les jeunes.

Une étude de l’Institut national d’études démographiques (INED) consacrée à la fécondité, publiée mercredi 9 juillet, apporte un nouvel éclairage sur le désir d’enfant, en berne, des Français. Selon l’enquête, qui s’appuie sur les réponses de 12 800 hommes et femmes de 18 à 79 ans, le nombre idéal d’enfants est passé de 2,7 à 2,3, en moyenne, en vingt-cinq ans. Une baisse considérée comme « importante » par les auteurs, Laurent Toulemon et Milan Bouchet-Valat. Elle est particulièrement marquée chez les jeunes générations. Ce qui ne manquera pas de relancer les interrogations sur les décisions politiques pour tenter d’inverser la tendance.
Ainsi, chez les moins de 30 ans, le nombre d’enfants souhaités est passé de 2,5 à 1,9 pour les femmes, et de 2,3 à 1,8 pour les hommes, entre 1998 et 2024. Parmi les personnes de 25 à 39 ans – âge auquel la majorité des personnes procréent –, les intentions de fécondité sont en baisse dans toutes les catégories sociales, de genre ou d’origine, avec quelques variations.
L’étude, publiée dans la revue Population et sociétés, livre un aperçu de l’évolution des représentations familiales ces dernières décennies. Elle acte que le modèle de la famille à deux enfants gagne du terrain, aux différents âges. Ainsi, deux tiers des femmes et des hommes de 18 à 49 ans considèrent qu’il s’agit du nombre idéal d’enfants, contre moins de la moitié en 1998. Toutefois, cette norme « est maintenant considérée par les jeunes plutôt comme un maximum, et non plus comme un minimum », précisent les auteurs.
Incertitude face à l’avenir
A travers ce travail, l’INED apporte des éléments d’explication à une réalité démographique qui interpelle les décideurs politiques ces dernières années : celle de la chute de la natalité, en baisse tendancielle depuis 2011. Les réponses fournies par les jeunes générations, chez qui le désir d’enfant marque encore plus le pas, fournissent une assise scientifique à un phénomène déjà identifié. Parmi les raisons qu’elles invoquent figurent sans surprise l’incertitude face à l’avenir. Près de la moitié des 25-39 ans se disent « très inquiets » concernant le futur, et dans cet échantillon, 35 % envisagent d’avoir un enfant, contre 46 % des personnes moins inquiètes. Signe de l’époque, par rapport à 2005, date de la dernière enquête similaire, une nouveauté apparaît dans les réponses : celle d’une moindre intention de fécondité chez ceux défendant une conception égalitaire des rôles de genre.
Peut-on tout de même imaginer que les déclarations des jeunes ne se traduisent pas, à terme, dans leurs comportements ? Les auteurs n’y croient pas. Pour eux, la baisse de fécondité observée ces dernières années « semble destinée à se poursuivre ». A titre d’exemple, en 2005, les femmes âgées de 25 à 34 ans exprimaient un nombre idéal supérieur de 0,5 enfant en moyenne au nombre d’enfants qu’elles ont réellement eus. Aujourd’hui, la descendance finale des femmes nées en 1980 est de 2,1 enfants, soit tout juste le seuil de renouvellement des générations. Quelles que soient les projections, « même si l’écart entre intentions et réalisation se réduit », les femmes nées après 1985 auront moins d’enfants, « entre 1,8 et 2 enfants pour la génération 1990, et entre 1,6 et 1,9 pour la génération 1995 », détaille l’étude.
Ces hypothèses ne manqueront pas d’alimenter le débat sur les enjeux liés à ce virage démographique, dont les répercussions interrogent notamment le financement de notre système de retraite, posant des questions de fond qui ont trait tant au recours à l’immigration qu’à des choix de politique familiale. Plusieurs institutions ont déjà formulé des recommandations en la matière. Dernière en date, l’Académie nationale de médecine s’est à son tour penchée sur le recul des naissances. Dans son rapport, rendu public le 30 juin, elle préconise une stratégie en plusieurs volets, allant de la création de 100 000 places en crèche à la réforme du congé parental en passant par le versement d’une prestation universelle dès le premier enfant.
En janvier 2024, après la publication du bilan annuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques et la confirmation d’une nouvelle baisse de la natalité, le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis un vaste plan de lutte contre l’infertilité et la refonte du congé de naissance, pour soulager les jeunes parents. Plusieurs fois annoncée sans aboutir, l’idée d’une telle réforme est une nouvelle fois brandie par la ministre du travail et des solidarités, Catherine Vautrin, dans un entretien à L’Express publié en ligne mardi soir, sans garantie d’arbitrage budgétaire favorable.
[Source: Le Monde]