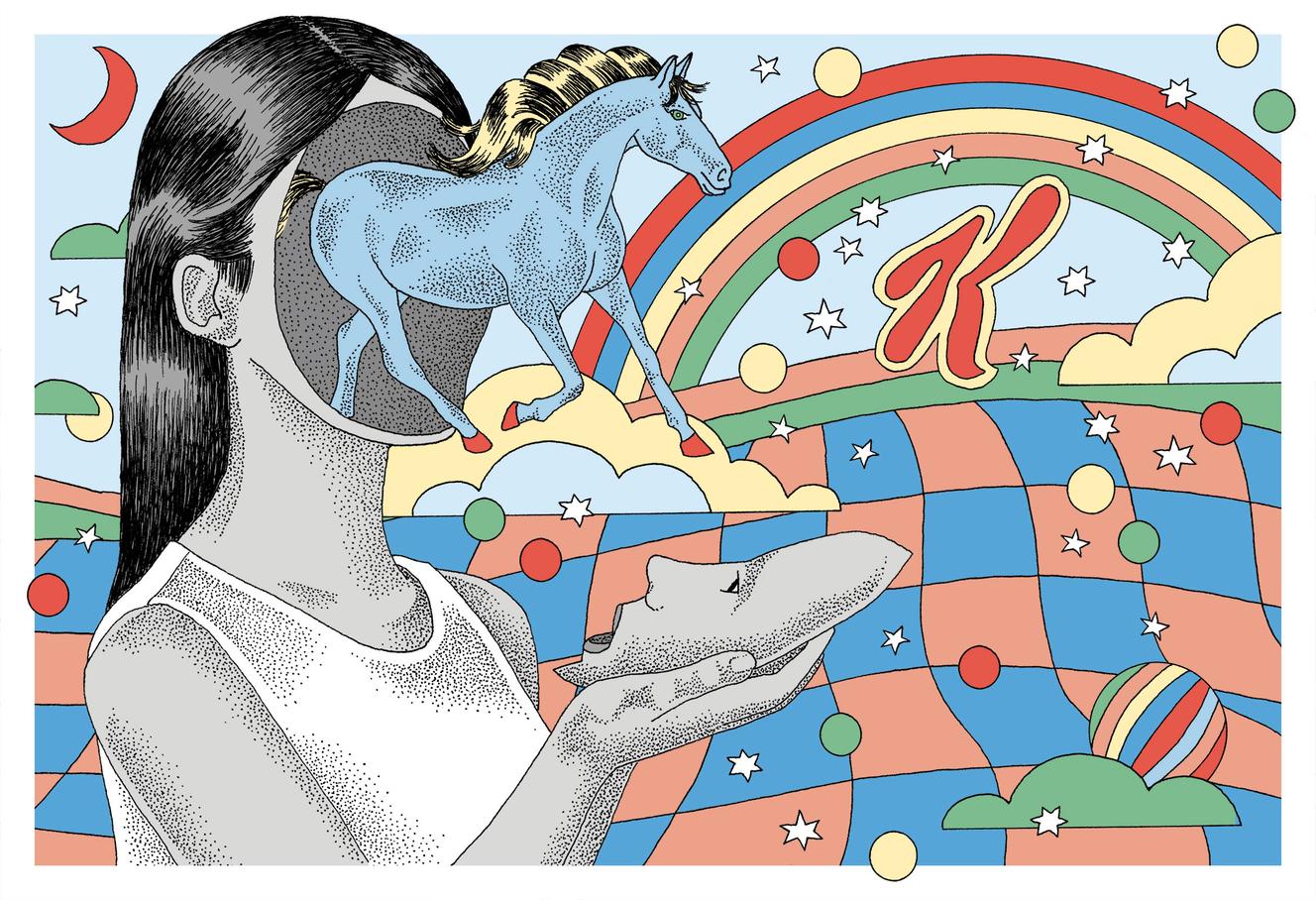Le succès controversé des écoles privées de science politique, « avec des stratégies qui vont de la confusion organisée à la publicité mensongère »
Les instituts d’études politiques attirent de plus en plus de bacheliers alors des écoles privées profitent elles aussi de cette demande en forte hausse. Mais la plupart délivrent des diplômes non contrôlés par les pouvoirs publics.

L’heure est à la confusion. « Moi, je n’ai pas tout compris, je dois l’avouer », murmure Clothilde Fouque, 17 ans, à peine sortie de la conférence de présentation de l’école Hautes Etudes internationales et politiques (HEIP). Ce soir de juin, la cour du campus parisien de cette école privée de sciences politiques résonne des questions d’une vingtaine d’étudiants, de lycéens et de parents. Bachelor ou licence ? Master, mastère, master of science ? « Il y a des écoles reconnues, pas reconnues, avec le label machin, le label truc… là, ça manquait de transparence », déplore Laurent Fouque, le père de Clothilde, qui accompagne la lycéenne en classe de 1re au lycée parisien Charles-Péguy à plusieurs portes ouvertes d’établissements, afin de « se renseigner » pour l’année 2025-2026.
« Plein d’étudiants préfèrent viser des titres RNCP, parce que ça atteste d’un niveau de compétence professionnelle », déclare une enseignante de HEIP dans la cour. Elle fait référence à l’inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), une certification délivrée par le ministère du travail, de leurs deux « masters of science » (MSc). Ces diplômes ne sont pas reconnus par le ministère de l’enseignement supérieur, à la différence des licences et masters du public. Plus loin, une étudiante « ambassadrice » de l’école soutient qu’« un bachelor, c’est comme une licence, mais dans le privé ». Or le bachelor de HEIP consiste en un « certificat d’établissement », sans contrôle par les pouvoirs publics.
Certains participants à cette journée portes ouvertes sont même venus incognito – l’un des parents stressés est en fait Sylvain Antichan, maître de conférences à l’université de Rouen-Normandie. « Inquiet », il l’est, explique-t-il au Monde, mais plutôt en tant qu’enseignant-chercheur et responsable pédagogique de la licence de science politique de son université, qui observe l’essor des écoles privées à but lucratif dans son domaine, la science politique.
Si elle revendique 125 ans d’histoire, HEIP appartient depuis 2016 à un grand groupe français de l’enseignement supérieur privé, OMNES Education. L’Institut libre des relations internationales et des sciences politiques (Ileri), autre école privée, fait partie du réseau Compétences et développement, autre grand groupe qui compte 14 établissements. A la suite de ces rachats, les écoles ont enclenché d’importants agrandissements. Née à Paris, HEIP a ouvert un campus à Lyon en 2019, à Bordeaux en 2022 et à Rennes en 2023. L’Ileri, aujourd’hui à la Défense, dans les Hauts-de-Seine, a ouvert à Lyon en 2020, à Bordeaux en 2023 et à Nice en 2024.
Des arguments de vente
En plus de ces deux écoles, très présentes lors des salons étudiants et en ligne, d’autres établissements privés ont investi ce qui est désormais un véritable marché : l’Ecole de guerre économique (EGE) ouvre un bachelor en sciences politiques et intelligence économique à la rentrée 2025, l’école Egora, en affaires publiques, propose des bachelors et mastères depuis 2024.
Les arguments de vente de HEIP, similaires à ceux d’autres écoles privées de sciences politiques, comportent certains mots-clés : des établissements « à taille humaine », une « pédagogie innovante », passant par la « professionnalisation », une vie associative active et de nombreuses conférences, parfois obligatoires, une dimension internationale, avec trois langues étrangères obligatoires pour l’Ileri et HEIP… Chaque année coûte entre 8 000 et 10 000 euros. « Aujourd’hui, le public ne peut pas répondre seul aux besoins de tous les étudiants », juge Céline Vandromme, directrice du développement de HEIP, mentionnant une « transformation profonde depuis dix ans ».
Le succès de ces écoles privées est aussi celui de la science politique dans son ensemble. En France, les effectifs des étudiants inscrits dans cette matière ont augmenté de plus de 30 % en dix ans dans l’enseignement supérieur public, passant de 26 000, en 2012-2013, à 34 000 en 2022-2023. La mise en place de la spécialité histoire-géographie, géopolitique et science politique au baccalauréat dans le cadre de la réforme Blanquer en 2019 a poussé les étudiants à s’intéresser au sujet. A la rentrée 2024, un tiers des lycéens de 1re générale avait choisi cette spécialité.
« Nous restons une petite discipline, il n’y a pas un très grand corps enseignant », ajoute Sylvain Antichan. Face à cette demande, l’offre des instituts d’études politiques (IEP) et de l’université est devenue plus sélective. Dix-neuf universités en France proposent des licences ou doubles licences de science politique, selon la cartographie de la discipline établie par l’Association française des sciences politiques. Dans sa licence, Sylvain Antichan ne dispose que de 120 places en première année, pour 2 446 demandes sur la plateforme Parcoursup en 2024. La même année, Sciences Po Paris a admis 993 étudiants pour 8 889 candidatures.
Des relances régulières
A HEIP, environ 65 % des étudiants dont le dossier est reçu sont pris – un taux bien plus élevé que pour les formations publiques en science politique. L’école fait environ une session de concours par mois à partir d’octobre : un examen écrit, à distance ou en présentiel, puis un oral avec des professeurs permettent de sélectionner des « profils motivés », explique Céline Vandromme. Car l’un des arguments de vente est de positionner leurs admissions en dehors des plateformes Parcoursup et Mon master. Un avantage, selon les élèves interrogés. « J’ai fait un refus d’obstacle devant les candidatures aux masters publics », déclare une ancienne élève de l’Ileri, entrée en master. « J’ai eu une réponse rapide, j’ai été soulagée de quitter Parcoursup », souligne une autre, entrée en bachelor.
« Ce sont des écoles marchandes, avec des stratégies semblables qui vont de la confusion organisée à la publicité mensongère », résume Mathis d’Aquino, doctorant en science politique à l’université de Bordeaux, auteur d’un mémoire sur le sujet. Pour HEIP, l’Ileri, Egora, l’EGE ou Imagine Campus, à Bordeaux, toute demande de brochure d’information en ligne est suivie d’appels et d’e-mails, en provenance soit des centres d’appels pour les grands groupes, soit de responsables de la formation, qui proposent des rendez-vous pour discuter, avec des relances régulières. « Tout est fait pour rendre les étudiants et leurs familles captifs », explique le chercheur.
Marc (qui souhaite rester anonyme) est entré à HEIP en février 2023, en « rentrée décalée », après un premier semestre de licence de droit. « Je n’avais aucune notion des différences entre privé et public », se souvient l’étudiant, actuellement en fin de troisième année de bachelor. S’il se plaît d’abord dans ses nouvelles études, notamment dans le rythme intense de ce premier semestre qui concentre en quelques mois une année d’enseignement, Marc se satisfait de moins en moins de leur qualité. « On a commencé à avoir de plus en plus de cours qui n’en étaient pas vraiment », explique-t-il. Avec des travaux dirigés uniquement meublés d’exposés d’élèves, des matières « pas assez approfondies », comme la « communication politique » ou « l’histoire politique ».
En deuxième année à HEIP, Marc commence un cursus de droit en parallèle. « Je me suis dit, ça me fera une porte de sortie, et Dieu merci, je l’ai fait ! », résume-t-il. A la fin de son bachelor, Marc décide de reprendre une deuxième année de licence de droit à l’université. « Je pense que j’aurai plus de débouchés qu’avec HEIP, parce que je me rends bien compte que leurs cursus sont moins reconnus. » Bon élève dans sa promotion, l’étudiant avait quand même obtenu deux masters sur Mon master, en politiques publiques à Sorbonne Université et Sorbonne Nouvelle – « mais ça a été compliqué pour beaucoup d’étudiants », ajoute-t-il.
Difficile d’évaluer la qualité
Pour entrer en master dans une université publique, venir d’une école privée avec un simple certificat d’établissement « n’est pas rédhibitoire, mais c’est un gros frein », explique Yves Sintomer, politiste et directeur du master de science politique de l’université Paris-VIII Vincennes-Saint-Denis. Sur l’algorithme de Mon master, l’université applique un malus aux candidats venant des écoles privées, les rétrogradant. « L’expérience montre que ces étudiants ont une formation de qualité inférieure », justifie-t-il. Pour autant, les expériences de stages ou l’engagement citoyen peuvent jouer en leur faveur. A l’université Lumière-Lyon-II, le discours est similaire. « Entre un étudiant qui a fait HEIP de Lyon et un autre qui a fait une licence de science politique à Nanterre, pour nous il n’y a pas photo. On se dit, tiens, ça, c’est un gage de sérieux », déclare Stéphane Cadiou, vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’établissement.
Dans les IEP, même avis. « A la lecture des relevés de notes de ces étudiants, on n’arrive pas à se faire une idée de leur niveau réel », déplore Jean-Philippe Heurtin. Le directeur de Sciences Po Strasbourg confirme qu’il est très rare que des jeunes issus d’écoles privées rejoignent leur IEP en quatrième année, du fait de « l’opacité de leur formation et du corps professoral ».
Difficile d’évaluer la qualité des enseignements de bachelor à partir des déclarations des élèves ou des administrations d’école. Victor Blanc, 21 ans, ancien étudiant du bachelor de HEIP Paris, aujourd’hui en master de politiques culturelles à l’université Paris Cité, se souvient par exemple d’un professeur « star » de première année de bachelor, Gilduin Davy, qui leur donnait un cours d’histoire de l’Etat et que sa classe a applaudi lors de leur dernière leçon.
Embauchée après son apprentissage
Pour le reste, l’école tait les noms de ses professeurs – « certains enseignants-chercheurs [de l’université] préfèrent que l’on ne sache pas qu’ils donnent cours chez nous », justifie Céline Vandromme. L’Ileri, qui n’a pas répondu à nos sollicitations, ne partage pas non plus d’organigramme. Ces écoles ne pouvant pas effectuer de recherche académique, la plupart de leurs intervenants sont donc des professionnels, anciens députés ou militaires, entrepreneurs, essayistes…
HEIP revendique une insertion professionnelle de ses étudiants en fin de M2 de 91 %, dont 56 % avant la fin de leurs études. Difficile, cependant, de savoir précisément vers quels métiers et entreprises ces derniers se dirigent. Le discours revient donc toujours à opposer des écoles « professionnalisantes », disposant d’une « marque » reconnue par des employeurs, aux universités.
Dans les facultés, le débat existe : « Il faut que nous fassions nos propres autocritiques, juge un responsable de master de science politique sous le couvert de l’anonymat. Pour cette dimension de la professionnalisation, nous ne sommes pas au top. Nous n’avons pas les moyens d’encadrer nos étudiants comme nous le voudrions. » D’autres, comme Stéphane Cadiou, réfutent l’argument. « C’est facile de dire qu’on a du réseau, qu’on professionnalise, comme si l’université ne savait pas déjà faire cela », remarque le politiste, ajoutant que les simulations, conférences, associations et stages existent aussi dans l’université publique.
Emma (dont le prénom a été modifié) est sortie fin 2024 de son MSc d’un an en défense, cybersécurité et gestion des risques à l’Ileri ; elle a été embauchée par l’entreprise de logiciels de cybersécurité dans laquelle elle travaillait en tant qu’apprentie. « Les RH de mon entreprise trouvaient que j’étais moins scolaire et plus adaptée à l’entreprise que ceux des IEP », soutient la jeune femme, qui a apprécié avoir des « intervenants avec de l’expérience », et des cours avec « plus de terrain que de théorie ». Pour autant, Emma est la seule de sa petite promotion à avoir trouvé un emploi directement à l’issue de sa formation.
[Source: Le Monde]