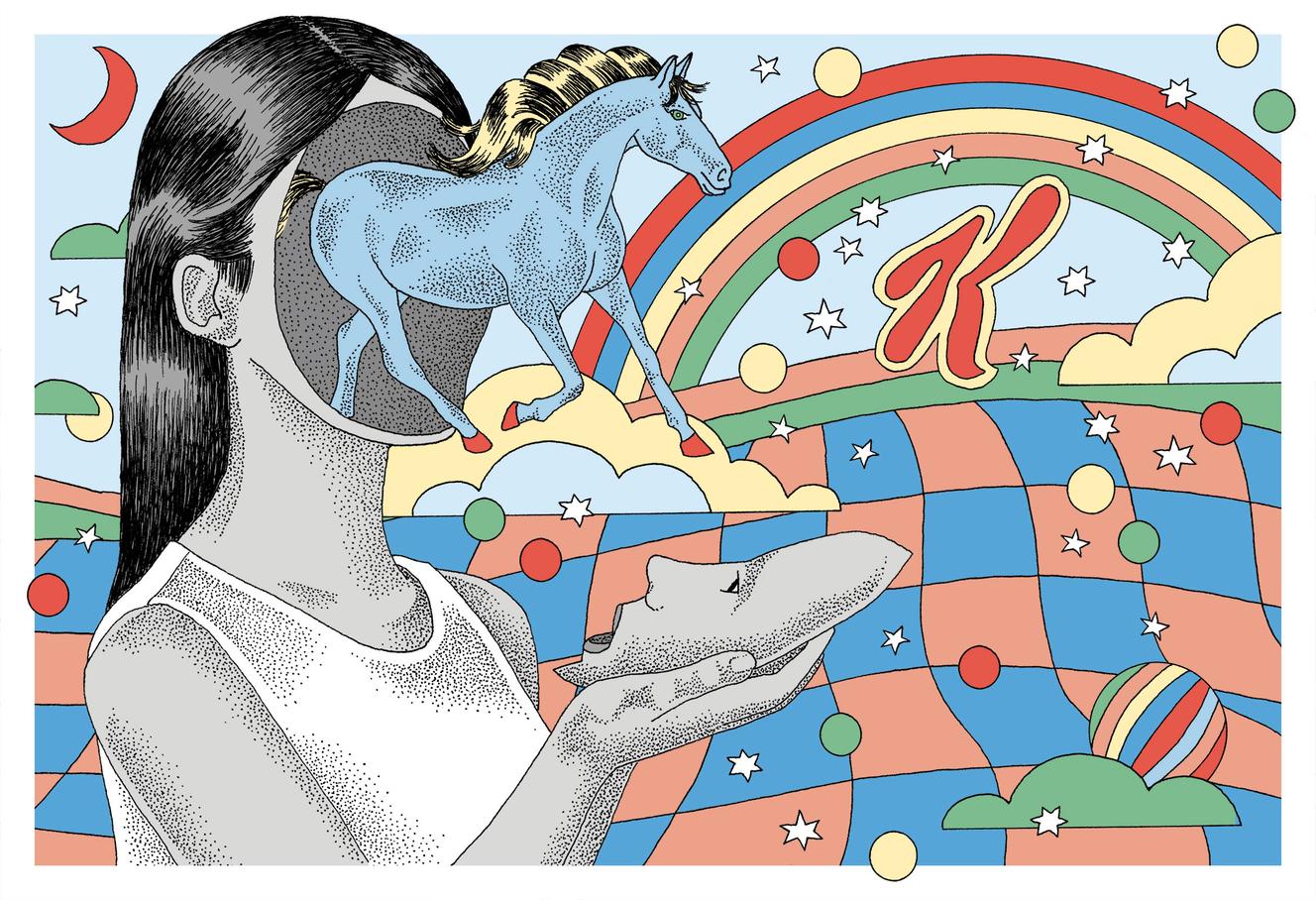La Chine, principal soutien économique de l’Iran, spectatrice de la guerre au Moyen-Orient
Alors que la diplomatie chinoise est de plus en plus active au Moyen-Orient, Pékin, qui achète 90 % du pétrole exporté par l’Iran, continue de laisser aux Etats-Unis le rôle de gendarme de la région.

La désapprobation est explicite. « L’action militaire d’Israël contre l’Iran a provoqué une escalade soudaine des tensions au Moyen-Orient, ce qui inquiète profondément la Chine. Nous nous opposons à toute action qui porte atteinte à la souveraineté (…) d’autres pays », a déclaré, mardi 17 juin, le président chinois, Xi Jinping, lors d’une rencontre au Kazakhstan avec cinq pays d’Asie centrale.
Dès samedi 14 juin, le ministre des affaires étrangères chinois, Wang Yi, avait décroché son téléphone pour faire part à son homologue israélien, Gideon Saar, de la colère de la deuxième puissance de la planète. « Cette action est d’autant plus inacceptable que la communauté internationale cherche toujours une solution politique à la question nucléaire iranienne », avait lancé M. Wang à M. Saar, après avoir appelé son homologue iranien, Abbas Araghtchi, pour lui faire part du soutien de la Chine. Les ambassades chinoises en Iran et en Israël ont appelé mardi leurs ressortissants à quitter les deux pays « dès que possible ».
Du point de vue chinois, l’offensive israélienne a toutes les marques de ce qui ne va pas dans un monde dominé par la puissance américaine : les doubles standards qui permettent une attaque en infraction au droit international parce qu’elle est lancée par un allié des Etats-Unis, désinhibé par la certitude que Washington continuera à lui fournir des armes et, en dernier recours, assurera sa protection. La cohérence du discours chinois est toutefois affaiblie par trois années de soutien diplomatique à la Russie après son invasion de l’Ukraine, fin février 2022.
La Chine est cette fois concernée au premier plan. Elle achète 90 % du pétrole exporté par l’Iran et est, à ce titre, sa ligne de sûreté économique. Ce pétrole est chargé de l’île de Kharg, située dans le golfe Persique, et transféré, parfois avec des opérations de transbordement d’un pétrolier à l’autre au large de la Malaisie, vers des acteurs mineurs du secteur pétrolier chinois qualifiés de « raffineries théières » pour leur petite taille, afin d’éviter d’exposer les géants étatiques tels que PetroChina et Sinopec, très présents à l’international, aux sanctions américaines.
« Activisme diplomatique en façade »
Pékin a renforcé ces dernières années ses liens commerciaux avec Téhéran, mais aussi avec l’Arabie saoudite, la Turquie ou les Emirats arabes unis. Cet équilibre empêche la Chine de trop s’engager auprès d’un seul acteur, laissant parfois l’Iran frustré par la relation. En 2021, Téhéran avait donné la plus grande importance à l’annonce d’un nouveau type de partenariat sur vingt-cinq ans avec la Chine, pour se sortir de l’isolement, mais l’Arabie saoudite, depuis près d’un quart de siècle première partenaire économique de la Chine dans la région, avait eu droit à un accord similaire en 2022, en plus d’une visite du président, Xi Jinping.
Signe du désir croissant de la Chine de s’afficher sur le devant de la scène diplomatique, c’est à Pékin qu’avait eu lieu l’annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre l’Iran et l’Arabie saoudite, en mars 2023. L’Iran y avait vu une nouvelle occasion de montrer qu’il a des ouvertures à l’est malgré les entraves de Washington, tandis que le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, tournait ainsi publiquement le dos à l’administration Biden.
Mais, venue l’heure des crises les plus graves, la Chine ne paraît plus que spectatrice. Elle a théorisé son refus des alliances militaires en opposition à ce qu’elle perçoit comme une logique de gang des Etats-Unis et de leurs alliés, surtout contre elle en Asie orientale. Sans engagement envers quiconque, elle reste en retrait. « La Chine ne veut pas prendre parti dans les conflits moyen-orientaux car elle n’a de problème fondamental avec aucun de ces pays qui sont aussi des partenaires commerciaux », constate Ma Xiaolin, un spécialiste du Moyen-Orient à l’université du Zhejiang.
Ce retrait revient à laisser aux Etats-Unis le rôle primordial que la Chine leur conteste pourtant. « Il y a une forme d’activisme diplomatique de la Chine en façade, mais derrière il n’y a pas grand-chose. L’interventionnisme ne fait pas pour l’instant partie de la conception de la puissance qu’ont les Chinois, parce qu’ils pensent qu’ils auraient beaucoup à perdre à s’engager dans une crise, qui plus est sur un sujet aussi complexe », explique Théo Nencini, chargé d’enseignement sur les relations sino-iraniennes à l’Institut catholique de Paris et à Sciences Po Grenoble.
Convergences dans le recours à la répression
Il existe bien des coopérations économiques au-delà du pétrole. Malgré l’apparente contradiction entre une théocratie islamique et un Etat communiste athée réprimant ses minorités musulmanes, le mouvement « Femme, vie, liberté » (le slogan phare du soulèvement), à la suite du décès de la jeune Mahsa Amini en 2022, a notamment souligné des convergences dans le recours à la répression et le besoin d’outils de surveillance, secteur dans lequel la Chine excelle. Mais du fait des restrictions occidentales et de l’échec du gouvernement iranien à porter le développement économique, les perspectives du marché iranien restent limitées.
La coopération militaire est un autre domaine dans lequel le partenariat avec la Chine a ses limites. L’Iran, la Chine et la Russie ont organisé, en mars, des exercices militaires conjoints dans le golfe d’Oman, à la sortie du détroit d’Ormuz. L’Iran était déjà demandeur d’aide chinoise pour bâtir un arsenal balistique. Au début de l’année 2025, le Financial Times a raconté comment deux cargos iraniens devaient quitter des ports proches de Shanghaï en janvier et février pour livrer 56 conteneurs chargés d’un peu plus d’un millier de tonnes de perchlorate d’ammonium, utilisé comme combustible pour la propulsion des missiles iraniens.
Les Etats-Unis accusent également des entreprises chinoises d’avoir fourni à des sociétés iraniennes des pièces pour la fabrication de drones. Pour la Chine, il y avait un intérêt à aider à rééquilibrer le rapport de force, face aux capacités militaires américaines et israéliennes, en faveur d’un pays engagé, comme l’est également le partenaire russe, dans la lutte contre la domination occidentale. Mais Pékin ne souhaite pas trop s’avancer, tant pour préserver la qualité des relations avec le reste de la région et le respect des normes de non-prolifération que pour éviter d’ajouter aux contentieux avec les Etats-Unis, ce qui différencie grandement l’aide apportée à l’Iran de l’équipement complet – avions de chasse, missiles, radars – fourni par la Chine au Pakistan.
Restant ainsi en retrait tout en dénonçant les travers d’un monde américano-centré, la Chine ne peut que constater les limites de son propre modèle de puissance. « L’Iran est isolé sans l’aide de partenaires qui sont tournés vers leur propre intérêt. Dans le même temps, Israël avec un soutien tacite des Etats-Unis est plus fort militairement au Moyen-Orient, relève Shi Yinhong, professeur de relations internationales à l’université du Peuple, à Pékin. C’est une situation contraire aux intérêts et à la philosophie de la Chine, mais il n’y a rien que la Chine puisse faire en substance. »