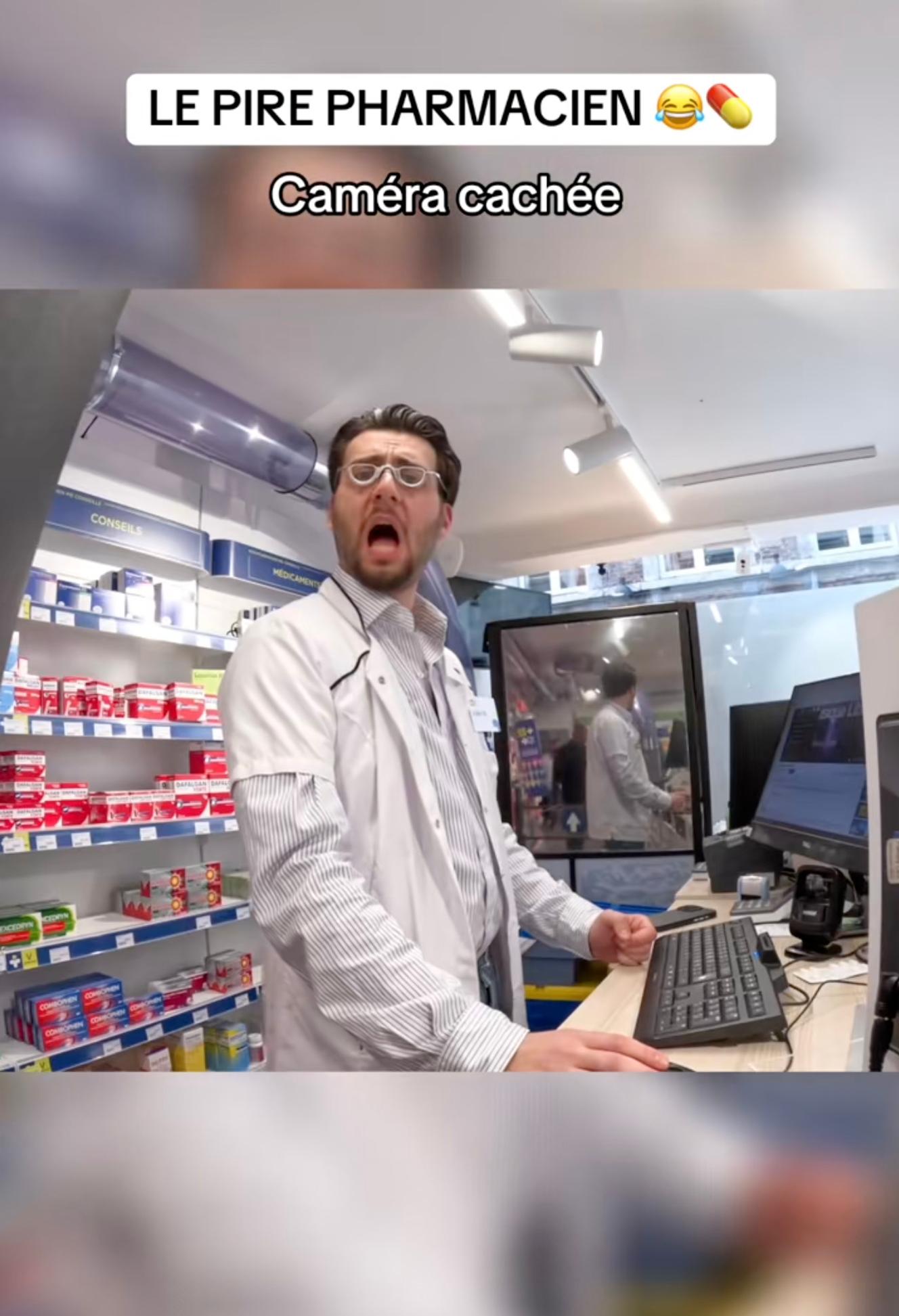Une convention citoyenne sur les temps de l’enfant pour dépasser le clivage autour des rythmes scolaires
Une nouvelle convention citoyenne s’ouvre vendredi 20 juin, à Paris, composée de Français tirés au sort, chargés de réfléchir au quotidien, scolaire et extrascolaire, des plus jeunes. Une initiative présidentielle qui laisse les acteurs sceptiques.

Dans les locaux de la société de sondage Le Terrain, nichés dans un passage du 11e arrondissement de Paris, la même phrase se répète inlassablement. « Le président de la République a souhaité l’organisation d’un débat autour de l’éducation et de l’enfance. C’est dans ce cadre que le Conseil économique, social et environnemental [CESE] organise une convention citoyenne sur les temps de l’enfant. (…) Votre numéro de téléphone ayant été tiré au hasard, nous vous donnons la possibilité de participer », exposent à leurs interlocuteurs au téléphone les enquêteurs, qui travaillent en partenariat avec Harris interactive sur ce tirage au sort.
Leur objectif : finaliser la liste des 130 personnes qui vont composer l’assemblée de citoyens chargée de travailler, pendant les six prochains mois, sur l’épineuse question des temps de l’enfant. Les appels se sont enchaînés jusqu’à quelques jours avant le début de la convention, vendredi 20 juin, pour trouver les derniers profils.
Après celles sur le climat, en 2020, et sur la fin de vie, en 2023, Emmanuel Macron a annoncé, début mai – à la surprise générale –, la tenue de cette convention. « Il me paraît nécessaire de faire en sorte que l’organisation des journées de nos élèves soit plus favorable à leur développement et aux apprentissages, qu’un équilibre soit trouvé aussi pour faciliter la vie des familles », a alors déclaré le chef de l’Etat au Parisien. Depuis 2023, le président de la République a plusieurs fois répété qu’il trouvait les vacances scolaires trop longues, mais ni le ministère de l’éducation, ni les acteurs de l’enfance n’étaient demandeurs d’un tel débat.
Nicole Belloubet, n’en a, elle, pas été étonnée. L’ancienne ministre de l’éducation (de février à décembre 2024) avait soufflé l’idée d’une convention citoyenne sur le temps scolaire à Emmanuel Macron, au printemps 2024, après les travaux de la commission « écrans ». « Ses membres nous ont parlé des conséquences des écrans sur les temps de sommeil des enfants et des adolescents. Il me semblait que cela pouvait s’inscrire dans une réflexion plus vaste », raconte aujourd’hui Mme Belloubet.
« Le temps scolaire pose la question de ce qu’on fait avant et après l’école. Cela permet de relire l’ensemble des dispositifs qui se sont accumulés au fil des années, de lutter contre les inégalités et peut-être de faire progresser les élèves », juge-t-elle. Car, souligne l’ancienne ministre, la « charge mentale » que l’organisation du temps scolaire fait aujourd’hui peser sur les enfants « conduit à en détourner un certain nombre de la réussite scolaire ».
Journées particulièrement longues
En la matière, la singularité française est connue de longue date. Les élèves français sont parmi ceux qui suivent le plus d’heures de cours par an, tout en ayant le nombre de journées de classe le moins élevé du fait de vacances en moyenne plus nombreuses qu’ailleurs. S’y ajoute, en primaire, une semaine limitée à quatre jours, un rythme hebdomadaire institué en 2008 sous Nicolas Sarkozy, et qui n’existe qu’en France. Il en résulte, pour les élèves – et leurs enseignants –, un temps de classe particulièrement dense et des journées particulièrement longues.
Or, les spécialistes du développement de l’enfant s’accordent tous pour dire que cette organisation scolaire n’est pas pensée en fonction des enfants : en primaire, la semaine de quatre jours alourdit leurs journées et casse leur rythme hebdomadaire ; au collège et au lycée, les cours commencent trop tôt pour des adolescents dont les cycles de sommeil sont décalés ; les journées sont globalement trop chargées pour des enfants dont les capacités de concentration et de mémorisation varient au cours de la journée et ne sont pas les mêmes au fil des âges. « La première chose que doivent faire une société et un système éducatif, c’est de s’adapter aux rythmes et aux besoins psychologiques, cognitifs ou affectifs des enfants, et, aujourd’hui, ce n’est pas le cas », déplore Grégoire Borst, chercheur en psychologie du développement, qui sera auditionné par la convention, samedi 21 juin.
Cette question des rythmes scolaires est depuis longtemps un dossier miné au consensus impossible. L’échec de la réforme mise en œuvre par le ministre de l’éducation nationale (2012-2014) Vincent Peillon, en 2013, est encore cuisant dans bien des esprits. La semaine d’école était alors passée à quatre jours et demi, avec le mercredi matin travaillé et des journées d’enseignement raccourcies. Elle avait toutefois suscité une fronde d’enseignants, d’une partie des parents d’élèves et des communes. Les assouplissements proposés à partir de 2017 par Jean-Michel Blanquer ont conduit la grande majorité des municipalités à revenir à quatre jours. Les réflexions sur les vacances, elles, se heurtent aussi à l’opposition ferme des acteurs du tourisme.
Faut-il y voir une volonté de dépasser les blocages ? Le sujet finalement retenu par la convention citoyenne n’est pas celui du temps scolaire, mais des « temps de l’enfant », de 3 ans à 18 ans. Une distinction qui a toute son importance. Le premier ministre, François Bayrou, a prévenu d’emblée le président du CESE, Thierry Beaudet, dans sa lettre de saisine : « Cette réflexion ne se limite pas aux rythmes scolaires. »
« Partir du besoin des enfants »
Elle doit englober les temps périscolaires et extrascolaires, ainsi que l’« impact croissant des outils numériques et technologiques sur la vie quotidienne des jeunes » pour proposer une « approche globale ». « Comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu’ils soient plus favorables à leurs apprentissages, à leur développement et à leur santé ? » est devenue la « question clé ».
« Ce n’est pas une convention sur l’école, mais une convention sur les temps de l’enfant. Ce qui se passe en dehors de l’école est tout aussi important dans la lutte contre les inégalités ou pour la réussite scolaire », affirme Thierry Beaudet. Comme le notait le CESE dans un rapport de 2024, seul un tiers du temps disponible des enfants est consacré à l’école, devoirs compris. Le reste se partage entre « des temps et lieux tiers » et le temps en famille ou à la maison. « On sait que les enfants peuvent développer et mobiliser des compétences transversales qui leur seront importantes dans leurs apprentissages, dans des contextes qui ne sont pas du tout scolaires, qu’il s’agisse des loisirs ou des activités en famille. C’est aussi là que se nichent les inégalités », souligne Grégoire Borst.
« L’idée est de partir du besoin des enfants et des problématiques qu’ils rencontrent », abonde Kenza Occansey, vice-président du CESE chargé de la participation citoyenne. Un panel de jeunes de 10 à 17 ans viendra d’ailleurs exprimer le point de vue de la jeunesse. Le large intitulé de la convention ouvre un vaste champ de réflexion : les temps de sommeil, indispensables pour les apprentissages et la santé, et gérés par les familles, le transport scolaire, à la main des collectivités, l’impact du réchauffement climatique sur l’année scolaire, ou encore le contenu des vacances, durant lesquelles le rôle des associations est central. « Les colonies de vacances n’arrivent plus à mélanger les milieux sociaux comme elles le faisaient il y a encore quelques décennies », remarque par exemple Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde, qui a travaillé avec le CESE pour repérer des citoyens en grande précarité et les intégrer à la convention.
Celle-ci suscite de vives réticences parmi les enseignants et les collectivités, échaudés par la dernière réforme des rythmes. « Nous attendons encore une évaluation de la semaine de quatre jours et demi d’école ou une étude d’impact sur la semaine de quatre jours, en vigueur dans la plupart des écoles aujourd’hui, s’agace le maire centriste d’Arras (Pas-de-Calais) et président de la commission éducation de l’Association des maires de France, Frédéric Leturque. Nous n’avons pas attendu cette convention citoyenne pour conduire des politiques en direction des familles. C’est notre travail quotidien. »
Débouchés politiques
Pour Guislaine David, cosecrétaire générale du premier syndicat du primaire, le SNUipp-FSU, le thème de la convention n’est pas l’« enjeu essentiel du débat actuel sur l’école, où se posent des problèmes d’effectifs de classe, d’inclusion des enfants en situation de handicap et de manque de moyens ». Les enseignants craignent que cette période de débat « soit encore une occasion de faire du “prof bashing” ». Un point sur lequel Thierry Beaudet se veut rassurant : « La convention citoyenne ne fait pas entrer dans une logique de confrontation, mais dans une logique d’échange et de compréhension. »
Pour composer l’assemblée, le CESE a fait en sorte de reproduire la diversité de la population française en matière d’âge, de genre, de région, de niveau de diplôme, de configuration familiale ou de catégorie socioprofessionnelle. Des professionnels de l’éducation et de l’enfance feront partie du panel, sans être surreprésentés. Des ateliers se dérouleront également dans différents territoires durant l’été pour avoir des remontées de réalités diverses. Pour mener à bien leurs travaux, les 130 citoyens disposent de sept week-ends de trois jours jusqu’au 23 novembre. Les deux premiers doivent permettre aux citoyens de s’acculturer au sujet en auditionnant des experts avant de déterminer eux-mêmes les sujets qu’ils veulent approfondir.
Ces mois de travail trouveront-ils des débouchés politiques, à quelques mois des élections municipales, en mars 2026, et à un an et demi de la présidentielle de 2027 ? Les ratés de la convention sur le climat laissent les acteurs prudents voire sceptiques. Emmanuel Macron avait alors promis de reprendre in extenso les propositions des participants, mais n’a pas tenu parole.
Thierry Beaudet a retenu la leçon : « Nous avons prévu dès les premiers week-ends des temps d’échange entre les citoyens et les ministres concernés, afin que le contrat soit clair et que les responsables politiques expliquent comment ils peuvent donner suite aux propositions. Sur ce point essentiel, le CESE sera vigilant et pleinement mobilisé. »Thierry Beaudet veut croire en l’utilité d’un tel projet : « Comme cela s’est passé sur la fin de vie, le format peut permettre de dénouer les nœuds qui existent depuis trop longtemps sur les temps de l’enfant, et de dessiner un chemin. »
[Source: Le Monde]