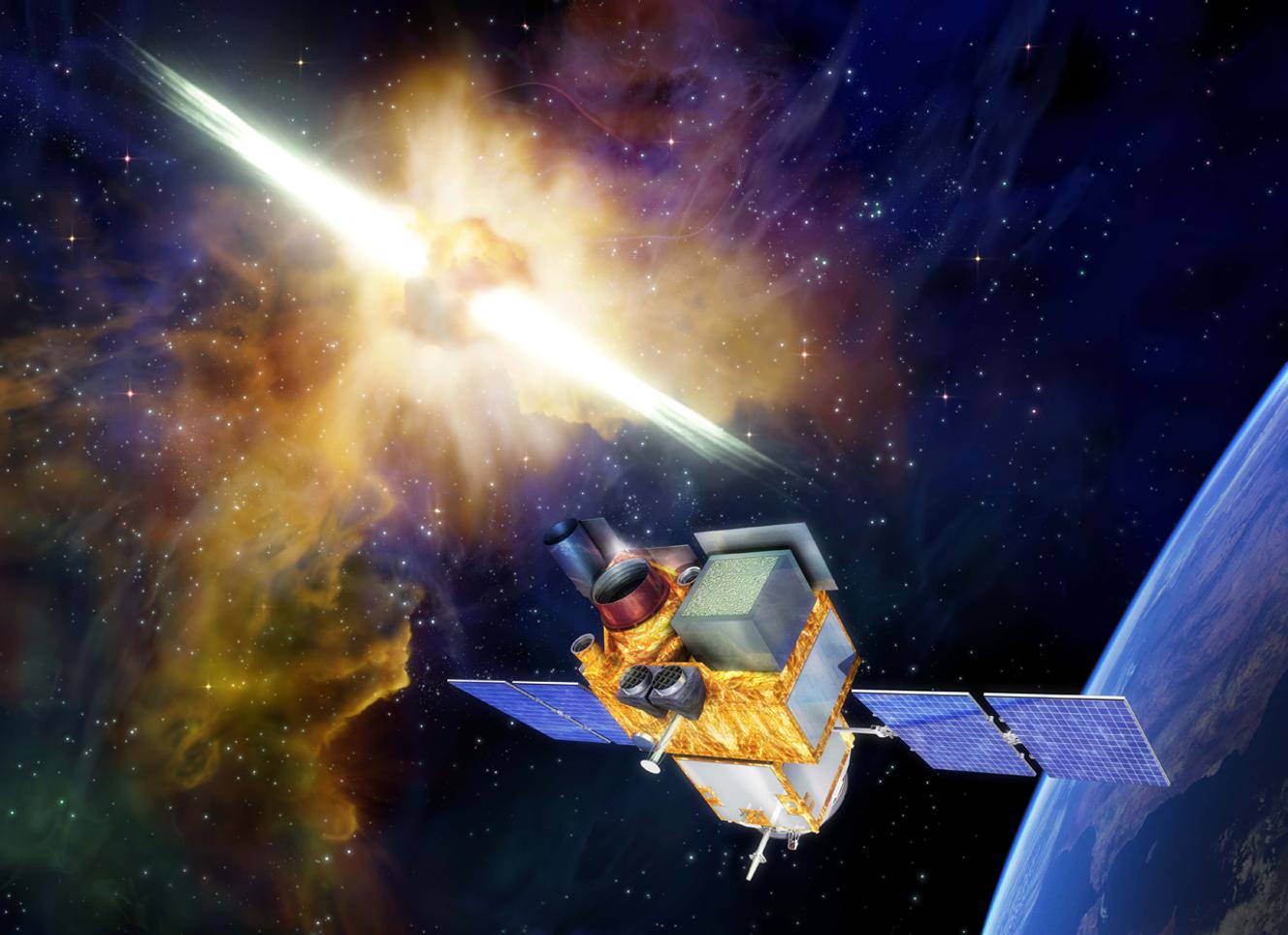La génération Z à l’assaut des vieilles élites politiques en Asie
Sri Lanka, Bangladesh, Népal… Depuis 2022, une série de révoltes est menée par une jeunesse désireuse de ruptures radicales, avec un dénominateur commun : le ras-le-bol face à la corruption et aux privilèges que s’arrogent les hommes politiques.

Sri Lanka, Bangladesh, Népal, un « tsunami jeune » souffle depuis 2022 sur l’Asie du Sud, balayant tout sur son passage, même les régimes les plus autoritaires. L’embrasement, les 8 et 9 septembre, à Katmandou, de la génération Z, les « zoomers » hyperconnectés, nés entre 1997 et 2012, constitue le dernier épisode d’une série de révoltes menées par une jeunesse désireuse de ruptures radicales qui menace désormais de s’étendre à l’Indonésie et aux Philippines.
En trois ans, trois gouvernements ont chuté sous l’assaut de la rue, avec une accélération spectaculaire des événements. Il a fallu cinq mois, en 2022, aux jeunes Sri-Lankais pour éjecter le clan Rajapaksa qui dirigeait le pays depuis plusieurs décennies, six semaines, en 2024, aux Bangladais pour chasser Sheikh Hasina, 76 ans à l’époque, au pouvoir depuis plus de quinze ans, et seulement deux jours à la génération Z népalaise en septembre 2025 pour mettre fin au gouvernement du maoïste Khadga Prasad Sharma Oli, 73 ans.
Le Pakistan, en mai 2023, et la Birmanie, début 2021, auraient pu rejoindre la liste des « printemps asiatiques » si, dans les deux cas, les militaires extrêmement puissants n’avaient réprimé brutalement la flambée de colère des jeunes.
Le Sri Lanka, étranglé par la crise
D’un pays à l’autre, les mêmes maux nourrissent les mêmes frustrations : une coupure béante entre des dirigeants âgés et la population particulièrement jeune, une corruption endémique des élites, un accaparement du pouvoir par des clans ou des dynasties, des inégalités sociales insupportables et un manque criant de perspectives économiques. Les gouvernements sont tombés comme des pommes pourries.
Quand le Sri Lanka ouvre la voie d’une révolution pacifique en 2022, l’île de 22 millions d’habitants, considérée comme la perle de l’océan Indien, est au bord de la banqueroute, étranglée par la crise du Covid-19 et par sa dette, liée à des investissements hasardeux réalisés par les frères Gotabaya et Mahinda Rajapaksa. Pendant des mois, les Sri-Lankais subissent les privations : des coupures d’électricité pouvant durer jusqu’à treize heures par jour, des heures d’attente devant les stations-service, des pénuries de médicaments et autres biens de première nécessité. L’épilogue semble inévitable, tant la haine de la population contre la famille Rajapaksa, tenue responsable de la faillite du pays, transcende toutes les couches de la société.
A partir du mois d’avril 2022, l’Aragalaya (la « lutte ») s’enracine le long de la mer, non loin du palais présidentiel, sur une esplanade bordée d’hôtels de luxe. Le président fuit piteusement le pays pour les Maldives, le 13 juillet. Les Sri-Lankais viennent d’ouvrir une page d’histoire en démontrant qu’aucun gouvernement – fût-il autoritaire – n’est à l’abri d’un soulèvement populaire.
Une scène symbolisant ce raz-de-marée de la jeunesse restera dans les mémoires : celle de centaines de jeunes Sri-Lankais investissant joyeusement le palais présidentiel à Colombo, essayant le lit et les sous-vêtements du président, Gotabaya Rajapaksa, plongeant dans sa piscine.
Au Bangladesh, un début de révolte étudiante
Deux ans plus tard, le 5 août 2024, la scène cathartique se joue à Dacca, dans la résidence de la présidente bangladaise, Sheikh Hasina. Lorsqu’ils apprennent la nouvelle de la fuite de leur dirigeante vers l’Inde, les Bangladais, euphoriques, envahissent la propriété, se servent dans les cuisines, chargent des tuk-tuks de mobilier, partent avec des lapins ou des canards.
La « bégum de fer », qui représentait autrefois les aspirations démocratiques du pays, s’est maintenue au pouvoir au prix d’élections truquées et d’une chasse systématique de ses opposants et de toute voix critique. Alors que rien ne semblait pouvoir ébranler le régime, l’imposition de quotas dans la fonction publique – accusés de favoriser les membres du parti au pouvoir – met le feu aux poudres. Dans ce pays de plus de 170 millions d’habitants dont la moitié de la population a moins de 26 ans, la jeunesse souffre d’un chômage de masse.
Le mouvement de contestation a vu le jour à l’université de Dacca, avant de s’étendre aux établissements privés. La répression des manifestations, d’une violence extrême – quelque 1 400 personnes tuées selon les estimations de l’ONU – fait basculer la révolte étudiante dans un mouvement général exigeant le départ de Sheikh Hasina.
Au Népal, un embrasement sans précédent
Un an après, c’est au Népal que la génération Z s’enflamme à son tour contre ses dirigeants. L’ancien royaume, devenu une république en 2008, est le théâtre d’une révolution éclair, sans leaders désignés. Le mouvement se propage sur les réseaux sociaux, où les jeunes dénoncent, sous le hashtag #NepoBaby, le train de vie des fils et filles des dirigeants politiques, symboles de la corruption et des inégalités qui gangrènent le pays.
Pensant étouffer ce foyer de critiques, le gouvernement du communiste Oli décide, le 4 septembre, de suspendre vingt-six plateformes numériques. Il vient d’allumer la mèche de la révolte. Privés de Facebook et de WhatsApp, les jeunes s’organisent sur l’application Discord. Rendez-vous est donné pour une grande manifestation contre la corruption, le 8 septembre, à Katmandou.
La marche pacifique bascule dans l’extrême violence quand la police tire sur la foule. Les étudiants sont rejoints par d’autres groupes plus radicaux et la capitale népalaise se transforme en brasier, le 9 septembre. Tous les lieux de pouvoir – exécutif, législatif et judiciaire – sont incendiés. L’embrasement est « d’une ampleur et d’une rapidité sans précédent, équivalant à un rejet total de l’establishment au pouvoir après des années de mauvaise gouvernance et d’exploitation des ressources de l’Etat », note Ashish Pradhan, du centre de réflexion International Crisis Group.
La vague de contestation a désormais gagné l’Asie du Sud-Est – Indonésie, Philippines, Timor oriental –, avec un dénominateur commun : le ras-le-bol de la jeunesse face à la corruption et aux privilèges que s’arrogent les hommes politiques.
Indonésie, Philippines : assainir la vie politique
Dans l’archipel indonésien, 284 millions d’habitants, c’est la décision, le 25 août, des parlementaires de s’octroyer des indemnités logement d’un montant de 50 millions de roupies par mois (environ 2 800 euros), soit près de dix fois le salaire minimum en vigueur dans la capitale, qui a allumé la mèche de la contestation chez les étudiants. Ils exigent une série de réformes pour assainir la vie politique.
Aux Philippines, le train de vie des proches de dirigeants d’entreprise de construction et de politiciens, impliqués dans un scandale massif de détournements de fonds publics alloués à la lutte contre les inondations, a poussé des milliers de personnes à défiler dans les rues de Manille, le 21 septembre. Ici aussi, le même mal taraude la démocratie : celle des clans familiaux qui se partagent le pouvoir aussi bien au niveau national que local. Cet héritage des colons espagnols, puis américains, a perduré malgré la révolution de 1986 : « Il n’y a jamais eu d’effort de la part de l’élite pour créer de véritables partis politiques modernes. Et même lorsque la dictature de Marcos est tombée, les Marcos eux-mêmes ont fini par être intégrés dans le système de dynasties politiques qui se perpétuent avec succès », analyse le politiste Richard Heydarian, en référence à l’élection de Ferdinand « Bongbong » Marcos, le fils du dictateur Ferdinand Marcos, en 2022.
La concomitance des mouvements de protestation en Asie interroge sur leur propagation. Méthodes et slogans similaires, revendications communes : ces mouvements semblent s’être inspirés les uns des autres… Le drapeau du pirate au chapeau de paille du manga japonais One Piece, dont le héros, un adolescent, symbolisant le courage, la solidarité et la lutte contre la corruption des dirigeants, semble devenu l’étendard de la génération Z. Il a été brandi en Indonésie, puis au Népal et, enfin, aux Philippines. Il a, depuis, largement été vu dans les manifestations de la rentrée en France.
L’issue de ces « printemps asiatiques » reste incertaine et l’exemple des « printemps arabes », dans les années 2010, qui avaient enflammé la Tunisie après l’immolation d’un jeune vendeur tunisien, excédé par la misère et les humiliations policières, avant de gagner l’Egypte, la Libye, Bahreïn, le Yémen, la Syrie, incite à la prudence quant à leurs débouchés. Ces soulèvements populaires de la jeunesse, alimentés, comme en Asie, par les réseaux sociaux, avaient très vite tourné à l’insurrection des peuples contre les gouvernements tyranniques en place. Ils se sont soldés par des régimes encore plus autoritaires.
Transitions pacifiques
Malgré leurs traits communs, la jeunesse au cœur des émeutes, le chômage, la corruption et les violences policières au centre des revendications, l’effet d’entraînement qui avait incité les peuples à vaincre la peur, le contexte des « printemps asiatiques » est bien différent. Les manifestations se sont produites dans des régimes démocratiques, certes imparfaits et autoritaires, et elles ont débouché, pour l’heure, sur des transitions pacifiques plaçant les jeunes au cœur du changement.
Qu’adviendra-t-il des profondes aspirations au renouveau de la génération Z ? Au Sri Lanka, le grand soir n’est pas arrivé, mais l’économie se rétablit et le pays renoue avec la croissance. L’ancien marxiste Anura Kumara Dissanayake, l’un des acteurs de l’Aragalaya, élu en 2024 à la présidence de la République, a dû se plier aux contraintes imposées par le Fonds monétaire international, en échange de prêts financiers.
Au Bangladesh, dirigé provisoirement par le Prix Nobel de la paix Muhammad Yunus depuis août 2024, les partis politiques et les étudiants peinent à s’entendre sur les réformes à entreprendre et la violence a connu une forte recrudescence depuis un an. Des élections devraient avoir lieu début 2026, avec le risque que les élites politiques traditionnelles reviennent au pouvoir.
Au Népal, où l’ancienne présidente de la Cour suprême, Sushila Karfi, l’une des figures de la lutte contre la corruption, a pris les rênes du pays jusqu’aux prochaines élections prévues en mars 2026, les vieilles élites sont aussi prêtes à s’engouffrer dans la moindre brèche pour revenir au pouvoir. L’histoire reste à écrire, l’Asie regorge de révoltes sans lendemain.
[Source: Le Monde]