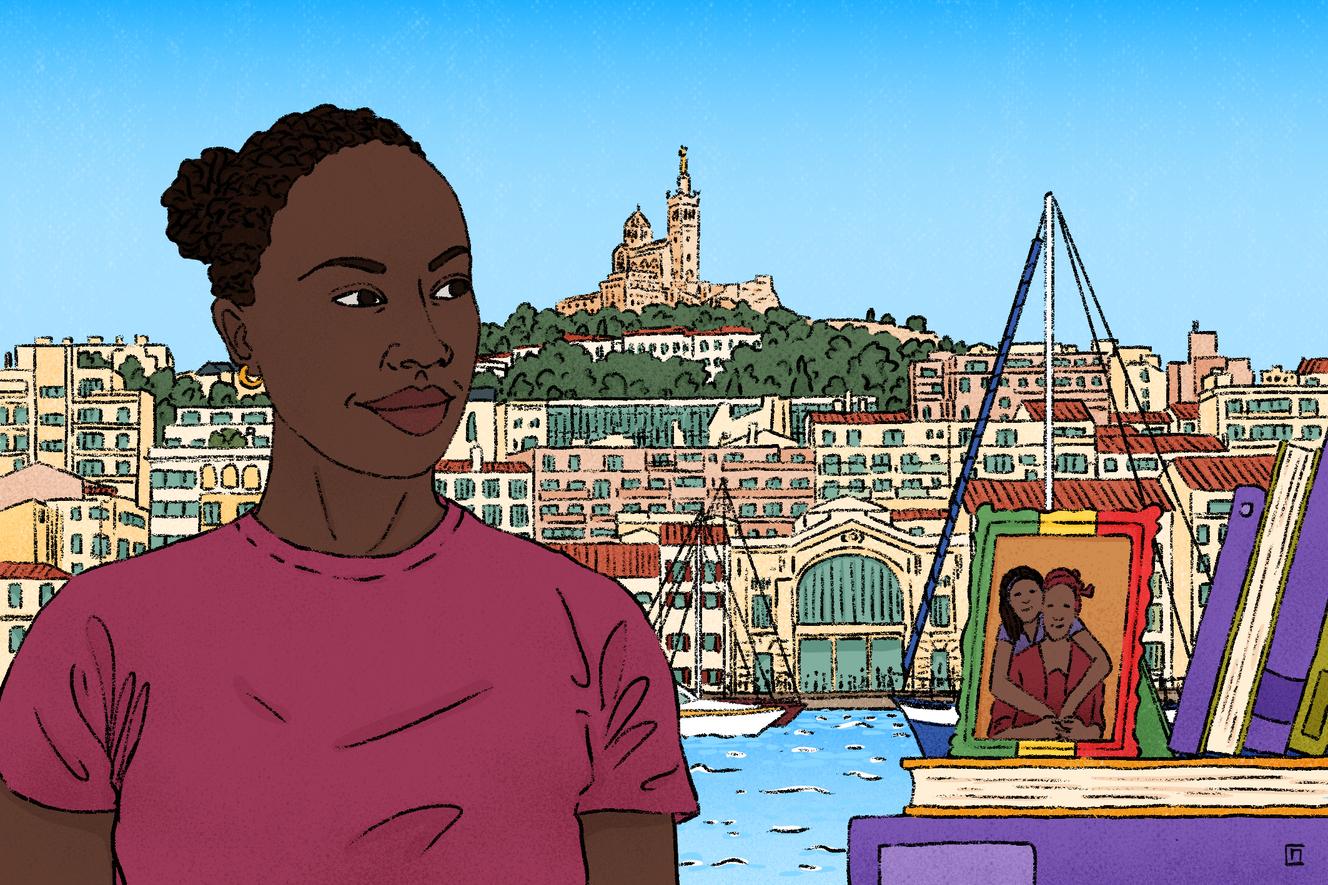Au Maroc, les visages d’une jeunesse en colère : « On ne demande pas la lune, seulement des droits élémentaires »
Le mouvement de contestation qui fait descendre dans la rue de jeunes Marocains depuis fin septembre semble s’essouffler. Mais les revendications des 15-30 ans révoltés contre l’injustice sociale et l’absence de moyens en matière de santé et d’éducation restent intactes. Quatre participants à la mobilisation témoignent de leur engagement et de leurs aspirations.

Depuis le 27 septembre, une partie de la jeunesse marocaine a exprimé sa colère dans la rue. Les rassemblements étaient quotidiens, ils sont désormais épisodiques, traduisant l’essoufflement d’un mouvement en partie brisé par la répression policière et judiciaire. Plus de 600 manifestants ou sympathisants sont en prison, certains ayant écopé de cinq ans ferme pour le simple fait d’avoir appelé à manifester. La crainte d’un embrasement, que le collectif GenZ 212 (212 étant l’indicatif du Maroc) veut à tout prix éviter, a aussi douché l’enthousiasme des premiers jours : au pic des débordements, dans la nuit du 1er au 2 octobre, trois jeunes ont été tués par des gendarmes.
Près de 70 % des protestataires sont des mineurs, selon le ministère de l’intérieur, mais leurs revendications (de meilleurs services publics d’éducation et de santé) sont celles de toute la population, excédée par les défaillances des hôpitaux et du système éducatif. Déjà écrasées par la cherté de la vie, les classes populaires et moyennes doivent emprunter pour inscrire leurs enfants dans des écoles privées ou se soigner dans des cliniques à but lucratif.
Frappés de plein fouet par le décrochage scolaire, le chômage et les inégalités, les 15-30 ans sont les premières victimes de cette majorité qui s’estime abandonnée. En faisant entendre leur voix, ils jettent une lumière crue sur un « Maroc à deux vitesses » contre lequel le roi Mohammed VI s’était élevé, lors de son dernier discours du trône, le 29 juillet. Mais l’adresse royale a beau être écoutée, le constat se répète.
Dénoncée depuis des décennies, la crise qui mine le pays n’a sans doute jamais été aussi aiguë. Ces derniers mois, la jeunesse voit pourtant l’Etat financer à coups de milliards des infrastructures de pointe (TGV, ports, stades, autoroutes…) en prévision de la Coupe du monde de football 2030. « À quoi bon quand nous n’avons pas d’hôpitaux dignes de ce nom ? », répètent en chœur les manifestants. Quatre d’entre eux racontent la contestation et partagent leurs attentes.
Douaa Bourhaba, 20 ans, à Salé
Elle est devenue en un quart d’heure la figure d’une jeunesse qui se voulait sans leader. Invitée à 2M, la deuxième chaîne de télévision marocaine, le 5 octobre, Douaa Bourhaba réprimandait en direct un ministre du gouvernement, Nizar Baraka, l’accusant de ne pas avoir su répondre aux attentes de la « gen Z ». Relayés en ligne, ses propos lui ont valu une petite célébrité parmi les manifestants. « On me reconnaît, on me félicite », dit la jeune femme, silhouette longiligne et longs cheveux noirs. Elle réunit désormais 40 000 abonnés sur les réseaux sociaux.
La majorité des contestataires a beau expliquer ne plus avoir confiance dans les partis, Douaa Bourhaba a choisi de s’encarter à gauche, persuadée que le changement ne viendra pas « avec des likes ou des posts sur Instagram ». Sa famille observe sa mue avec circonspection. Son grand frère s’y oppose, mais sa mère, femme au foyer, et son père, policier à la retraite, la soutiennent, même si son engagement n’est pas sans susciter leur crainte. Au cours d’un rassemblement à Rabat, le 29 septembre, les forces de l’ordre l’ont violemment prise à partie : une vidéo la montre hurlant et se débattant, cernée par des boucliers antiémeutes, tandis qu’un policier l’agrippe brutalement. Deux semaines après, son bras droit est encore endolori.
La répression sécuritaire, alors que les manifestations se déroulaient « pacifiquement » les premiers jours, a provoqué chez elle un profond ressentiment. « On ne demande pas la lune, seulement des droits élémentaires. » Elle est convaincue que les autorités ont cherché à effrayer la jeunesse pour briser leur mouvement. Douaa Bourhaba suit des études d’ingénierie économique dans une université publique de Salé, près de Rabat, mais la révolte en cours pourrait lui faire changer de voie. Elle caresse à présent l’idée d’une carrière politique : « Et pourquoi pas, un jour, être ministre. »
Adam Samine, 17 ans, à Casablanca
Son visage poupin trahit son âge, mais l’adolescent se révèle d’une étonnante maturité. En juillet, Adam Samine a pris une grande décision : il fera du droit. Depuis octobre, il étudie à la faculté publique des sciences juridiques de Casablanca, espérant devenir magistrat et peut-être – c’est son rêve – siéger au Conseil constitutionnel de son pays.
Regard vif derrière des lunettes rondes, le jeune homme se veut plein d’espoir, à contre-courant d’une jeunesse en détresse : près de la moitié des 15-24 ans sont au chômage dans les villes. Face à « l’accumulation des injustices », il a rejoint les rassemblements, dès le 27 septembre, mais les doléances de la « gen Z » lui paraissent insuffisantes. « Oui, la santé, l’éducation, c’est essentiel, mais il faut aussi parler d’écologie, de libertés individuelles, de droits des femmes ! », lance-t-il, mains écartées. Une évidence pour lui : il vit avec sa mère, divorcée, et se décrit comme « féministe », prônant un avortement gratuit et accessible à toutes – une position rare au Maroc, où l’IVG est strictement encadrée.
Il y a trois mois, lassé de n’être qu’un « spectateur », le jeune homme a intégré un parti de gauche, certain que l’engagement est la seule voie pour faire bouger les choses. Il s’étonne d’ailleurs que la politique ne passionne pas les foules, même s’il se dit conscient que les élus ont leur part de responsabilité. « Dans ma famille, soit ils n’ont voté qu’une fois, soit ils ne savent pas qu’il faut s’inscrire sur les listes électorales. »
La brutalité des sanctions prononcées par les tribunaux l’interpelle également. Des manifestants qui ne sont ni des casseurs ni des émeutiers ont écopé de prison ferme. « Enfermer un jeune, ça n’a aucun sens. Nous avons une justice qui frappe les plus faibles. » En novembre, Adam Samine fêtera ses 18 ans. Il votera donc, pour la première fois, aux législatives de 2026. Avec la conviction que l’élection sera synonyme d’alternance, au risque d’une nouvelle colère de la jeunesse.
Houria Bamensour, 30 ans, à Agadir
Mère d’un enfant de 5 ans, elle incarne la frange la plus « âgée » de la génération Z. A Agadir, elle est l’une des figures marquantes des manifestations, bien qu’elle récuse le terme de « leader locale » : « Le mouvement est sans hiérarchie et très démocratique puisque sur Discord, après chaque rassemblement, on fait le bilan de la journée, on débat et on vote sur la suite à donner à nos actions ».
Déjà engagée dans des associations en faveur de l’éducation, de la santé et du logement, l’ancienne étudiante en sociologie a endossé tout naturellement les revendications de la « gen Z » sur l’accès à l’instruction et à l’emploi, la lutte contre la corruption ou l’amélioration du secteur public de la santé. « C’est la manifestation devant l’hôpital Hassan-II, ici à Agadir, le 14 septembre, qui a déclenché ce hirak [mouvement] », rappelle-t-elle d’une voix éraillée par les slogans clamés la veille.
L’un des mots d’ordre des cortèges de 2025 reprend d’ailleurs un slogan des mobilisations du « printemps arabe » : « Liberté, dignité et justice sociale ». « La demande de dignité renvoie à la hogra, cette forme de mépris dans laquelle nous tiennent les institutions et les dirigeants politiques. Mais les jeunes du Maroc ne sont pas des fainéants, au contraire, ils veulent s’en sortir et réussir dans leur propre pays. »
Regard déterminé et pas rapide, la trentenaire n’hésite pas à s’époumoner durant les manifs, mais aussi à prendre le pouls d’une société qu’elle juge malmenée. A Lqliaa, ville en banlieue d’Agadir endeuillée à la suite d’affrontements violents entre casseurs et gendarmes, elle part à la rencontre de la population. Quelques jours plus tard, c’est à Rabat qu’elle se rend en voiture, pour débattre de l’importance des combats féministes. Cette jeune femme pressée partage le reste de son temps entre sa vie de famille et son nouveau projet professionnel, le lancement d’une petite entreprise de recyclage de cartouches d’imprimantes.
Yasser Semeyani, 23 ans, à Marrakech
Dans les rassemblements de la « gen Z », il semble veiller sur les manifestants comme sur sa propre famille. Yasser Semeyani, 23 ans, fait partie du groupe restreint de jeunes Marrakchis qui coordonnent le mouvement dans la métropole touristique du centre du Maroc : de ceux qu’on appelle pour confirmer l’horaire d’un rassemblement, de ceux qui veillent au respect scrupuleux de l’itinéraire choisi et des consignes fixées pour éviter toute anicroche.
Avec ses cheveux courts, son allure soignée et ses fines lunettes, il renvoie une image rassurante dont le mouvement a besoin. Car la « gen Z », qui s’est toujours présentée comme un collectif non violent, est aussi décriée parmi une partie de la population du royaume, notamment à Marrakech, où les habitants gardent en mémoire les images des deux nuits d’émeutes qui ont secoué, les 1er et 2 octobre, le quartier populaire de Sidi Youssef Ben Ali.
L’apparition du collectif GenZ 212 a été le baptême du feu de cet étudiant sans expérience politique ni associative antérieure. « J’ai rejoint le mouvement dès le premier jour. Beaucoup d’entre nous manquent d’expérience, c’est vrai, mais elle vient avec le temps », confie ce multidiplômé, qui cumule un titre universitaire en management des entreprises, une licence en finance appliquée, et est actuellement étudiant en master dans le domaine de la science des données.
La plongée dans le mouvement a été brutale pour le jeune homme, arrêté à trois reprises depuis le 27 septembre. Au cours de sa troisième interpellation, qui lui a valu un procès-verbal pour participation à une manifestation non autorisée, il a été pris d’une crise de panique qui s’est soldée par un passage de quelques heures en hôpital psychiatrique. Cet événement n’a pas entamé sa détermination, ni les interdictions répétées de ses parents à se joindre aux protestataires. « Je ne manifeste pas contre mon pays mais pour mes droits, et pour l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques à l’écoute des aspirations de la jeunesse du Maroc. »
[Source: Le Monde]