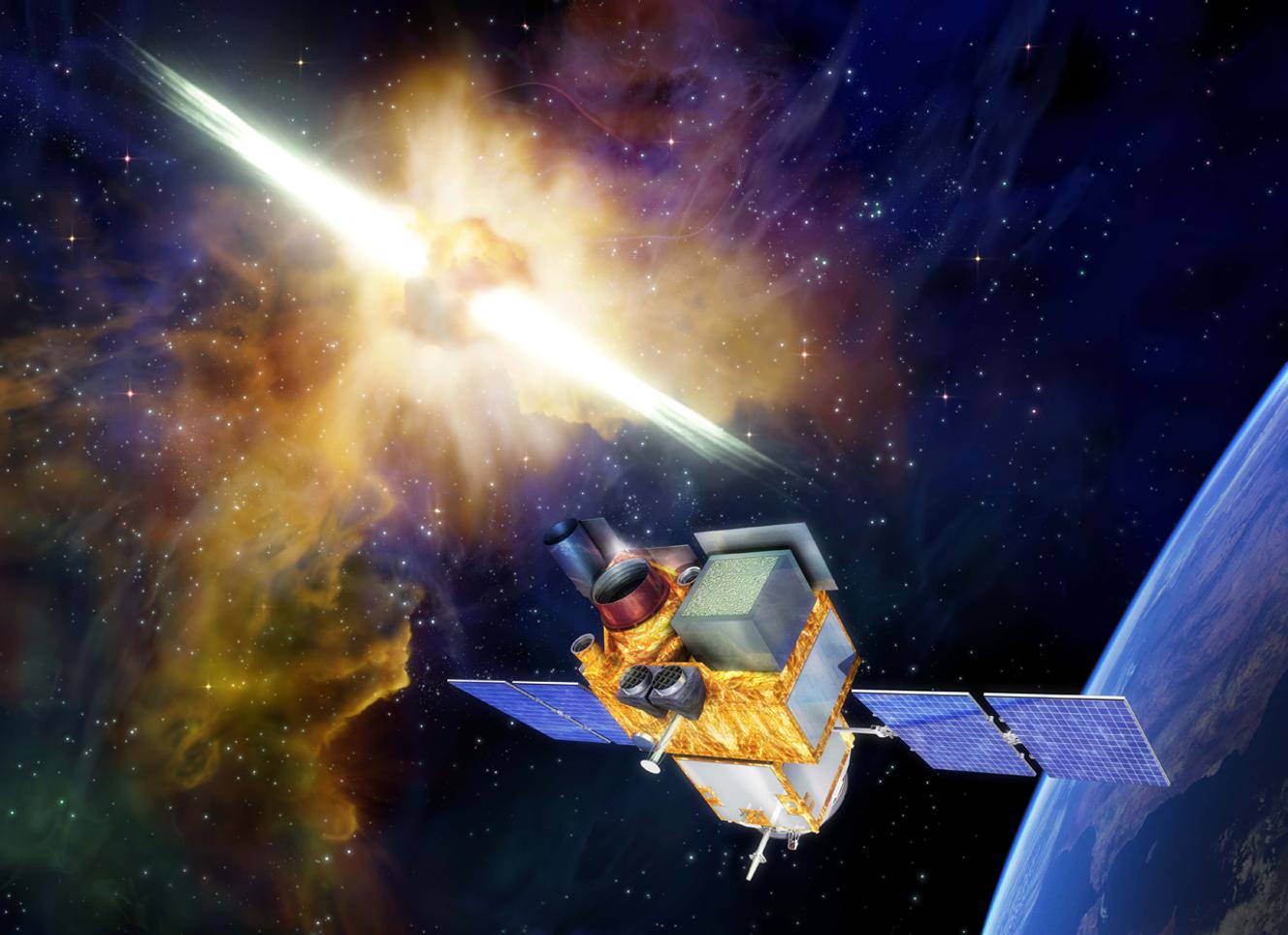Pourquoi les meilleurs joueurs de tennis finissent la saison exténués
Face à la multiplication des signes de fatigue et à l’accumulation des blessures, certains joueurs dénoncent l’alourdissement du calendrier des tournois, une conséquence de l’allongement des Masters 1000, mais aussi de l’attrait financier des exhibitions.

Quelque chose ne tourne pas rond sur la planète tennis : beaucoup de joueurs parmi les meilleurs du monde finissent l’année éreintés. Le dernier Masters 1000 de la saison – catégorie de tournois la plus élevée après ceux du Grand Chelem –, à Paris La Défense Arena (du 27 octobre au 2 novembre), se disputera sans trois membres du top 10. En effet, le Serbe Novak Djokovic (5e), le Britannique Jack Draper (9e) et le Danois Holger Rune (10e) ont déclaré forfait. Le dernier pourrait même être absent des courts pendant un an. En cause : une rupture du tendon d’Achille lors d’une demi-finale à Stockholm, samedi 18 octobre.
« Holger est le dernier d’une longue liste (…). Ce genre de blessure survient souvent à cause de la fatigue », a déploré dans la foulée sa mère, Aneke Rune. Elle a accusé l’ATP, l’instance régissant le circuit professionnel masculin, de ne pas faire assez pour « préserver la santé » des joueurs. Ceux-ci jonglent avec un calendrier surchargé – des événements de l’ATP à la Coupe Davis, sans compter les Grand Chelem et les exhibitions devenues si lucratives qu’elles sont difficiles à refuser –, qui peut représenter, au total, plus de 33 semaines de compétition.
Pour Aneke Rune, le problème réside surtout dans le « trop grand nombre de tournois obligatoires ». En réalité, aucun tournoi n’est, à proprement parler, obligatoire. Toutefois, les 30 meilleurs joueurs mondiaux de 2024 doivent prendre part à huit des neuf Masters 1000 de la saison (sauf celui de Monte-Carlo), cinq ATP 500, dont un forcément après l’US Open (généralement fin août-début septembre), et aux finales ATP pour les huit qualifiés et leurs remplaçants, sous peine de sanction financière. Se pose aussi, forcément, la question des points à défendre au classement mondial : en cas d’absence, le joueur se voit infliger un zéro.
De quoi faire prendre la raquette à des hommes blessés ou malades, déplorait le Norvégien Casper Ruud, après son élimination au 2e tour de Roland-Garros, cet été, tournoi qu’il a disputé sous anti-inflammatoires en raison d’une douleur à un genou.
La densité du calendrier est telle que certains sont contraints à des choix difficiles, que le public a parfois du mal à comprendre. L’Italien Jannik Sinner s’est ainsi attiré les foudres de la presse transalpine après avoir annoncé qu’il ne représenterait pas son pays lors de la phase finale de la Coupe Davis, à Bologne, du 18 au 23 novembre.
Fatigue physique et mentale
Mise en place en 2025 par l’ATP, sans que les joueurs y aient été associés, la réforme des Masters 1000 a aussi des conséquences délétères. Leur durée est passée de sept à douze jours (à l’exception de Paris et de Monte-Carlo), avec un élargissement du tableau principal de 56 à 96 engagés. Pour l’instance régissant le circuit, ce nouveau format est bénéfique, car il accorde une plus longue plage de repos entre les tours.
Une vision contestée par Camille Pin, ex-61e mondiale et désormais consultante pour Eurosport : « Les joueurs sont fatigués de ces tournois qui n’en finissent plus. Ils sont impatients de rentrer chez eux. A la fatigue physique s’ajoute la fatigue mentale. » Les intéressés eux-mêmes ont déjà donné de la voix pour dénoncer la situation. D’autant que, sous la pression de l’ATP, les surfaces et les balles ont aussi été standardisées afin de ralentir le jeu et d’améliorer le spectacle, ce qui allonge les matchs et sollicite davantage le physique des joueurs.
En mars, l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) a attaqué l’ATP en justice, dénonçant la trop faible redistribution des recettes générées par ses tournois, mais aussi le « calendrier insoutenable » et un « système draconien » de classement qui force à participer à des compétitions dans des conditions éprouvantes.
Les premières fissures sont apparues cet été, lors du Masters 1000 de Toronto (Canada), quand quatre des six premiers mondiaux ont déclaré forfait. Disputée sous des chaleurs extrêmes, la tournée nord-américaine a laissé de nombreux tennismen exsangues. Malade et proche de l’insolation, Jannik Sinner a abandonné face à Carlos Alcaraz lors du match pour le titre à Cincinnati (Ohio). « Une finale un lundi, à 15 heures, en août, après toute la tournée de Toronto et Cincinnati, avec tant de retraits et de joueurs épuisés physiquement… Quelque chose doit changer », avait alors réagi l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina sur les réseaux sociaux.
La suite lui a donné raison. La tournée asiatique, entre la mi-septembre et la mi-octobre, a, elle aussi, été jouée dans des conditions difficiles. Au Masters 1000 de Shanghaï (Chine), le taux d’humidité, parfois supérieur à 80 %, a provoqué de nombreux malaises. De nouveau, Jannik Sinner a dû abandonner, victime de crampes.
Un jeu de plus en plus intense, des matchs qui durent, de longs voyages, du décalage horaire et peu de plages de récupération : le cocktail est fatal. Ainsi, il y a eu huit abandons à Cincinnati, neuf à Madrid (Espagne) et sept à Shanghaï cette saison. « Environ 5 % des matchs programmés cette année se sont conclus par un abandon ou un forfait. C’est le taux le plus élevé depuis la création de l’ATP Tour, en 1990 », insiste Constance Sénac de Monsembernard, qui compile des statistiques sur le tennis sur son compte « Jeux, set et maths » sur X.
« Responsabilité individuelle »
C’est avec un bandage à la cheville gauche que Carlos Alcaraz a remporté, le 30 septembre, le tournoi ATP 500 de Tokyo (Japon), son huitième titre de la saison. Dans la foulée, le numéro 1 mondial a annoncé son retrait du Masters 1000 de Shanghaï pour « se reposer et récupérer ». Soulignant que le calendrier était « vraiment dense », le vainqueur de Roland-Garros et de l’US Open a exhorté les instances à « faire quelque chose »… Ce qui ne l’a pas empêché de participer, quelques jours plus tard, à l’exhibition Six Kings Slam, en Arabie saoudite, le tournoi le plus lucratif au monde.
D’autres exhibitions comme l’Ultimate Tennis Showdown ou la Laver Cup se télescopent avec le circuit traditionnel, ce qui contribue à l’épuisement des têtes d’affiche. « Il y a beaucoup plus de compétitions non officielles, mais personne ne vous oblige à rien. Il y va de la responsabilité individuelle de chaque joueur, qui décide de son programme », observe Camille Pin.
A la tête de la PTPA, Novak Djokovic a critiqué les joueurs qui se plaignent du calendrier tout en disputant des exhibitions. « Il y a plus de quinze ans, je disais déjà que nous devions nous réunir et réorganiser le calendrier, a déclaré le Serbe de 38 ans à l’occasion d’une conférence de presse. Il faut que les meilleurs joueurs, en particulier, s’assoient, retroussent leurs manches et s’impliquent vraiment. On peut toujours faire des choix pour jouer moins. »
Depuis plusieurs années, lui se concentre sur les tournois du Grand Chelem. Il profite de la règle protégeant les tennismen âgés de plus de 30 ans et ayant disputé plus de 600 matchs en douze ans de carrière : aucun tournoi ne leur est imposé en dehors des Majeurs. Malgré ce statut privilégié et seulement 12 tournois disputés, l’ex-numéro 1 mondial termine, lui aussi, l’année recru, au point d’avoir dû abandonner lors du Six Kings Slam.
Face au mécontentement grandissant, le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a reconnu, jeudi 23 octobre, que « l’intersaison devrait être plus longue ». Laissant entendre que le nombre de tournoi ATP 250 (actuellement 30) allait diminuer, l’Italien annonçait, le même jour, la création d’un dixième Masters 1000 en Arabie saoudite « dès 2028 ». La stratégie de l’instance consiste donc à sacrifier des tournois qu’elle juge mineurs au profit des plus rentables. Il n’est pas certain que la santé des joueurs y gagne au change.
[Source: Le Monde]