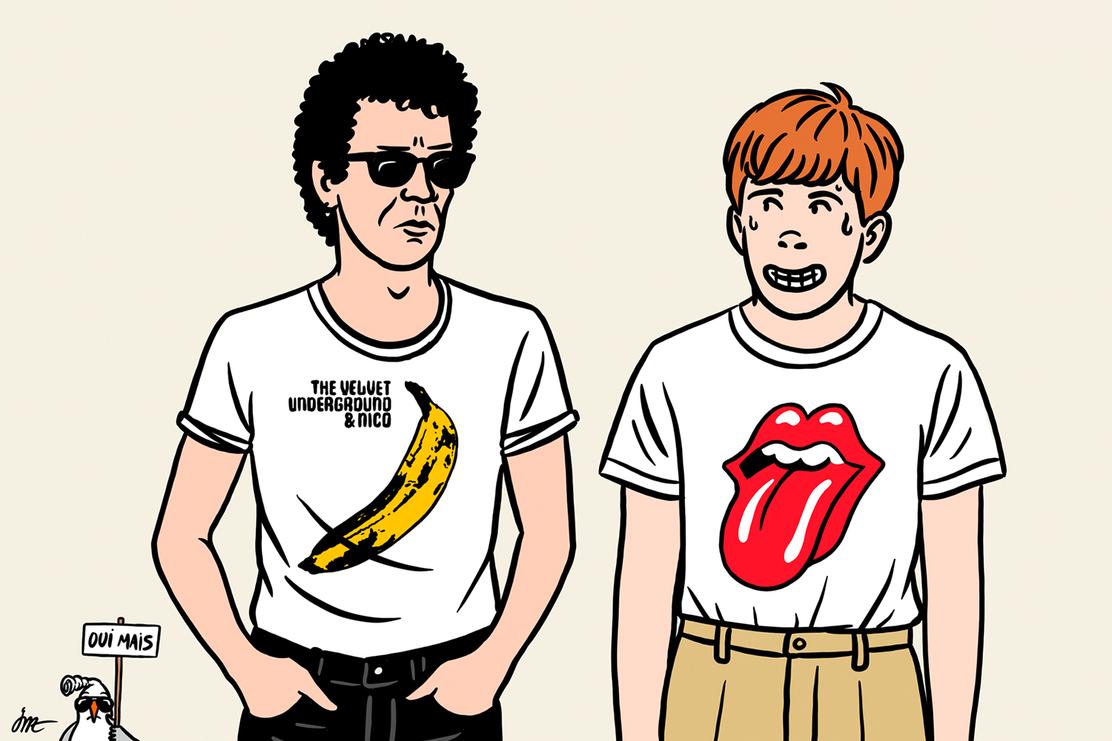Universités : la liberté académique est plus fragile que jamais selon un rapport
Les libertés accordées aux chercheurs et enseignants se sont nettement limitées partout dans le monde, y compris en France, alerte la chercheuse Stéphanie Balme, dans un rapport qu’elle doit remettre mercredi 15 octobre. Elle appelle à inscrire la liberté académique dans la Constitution.
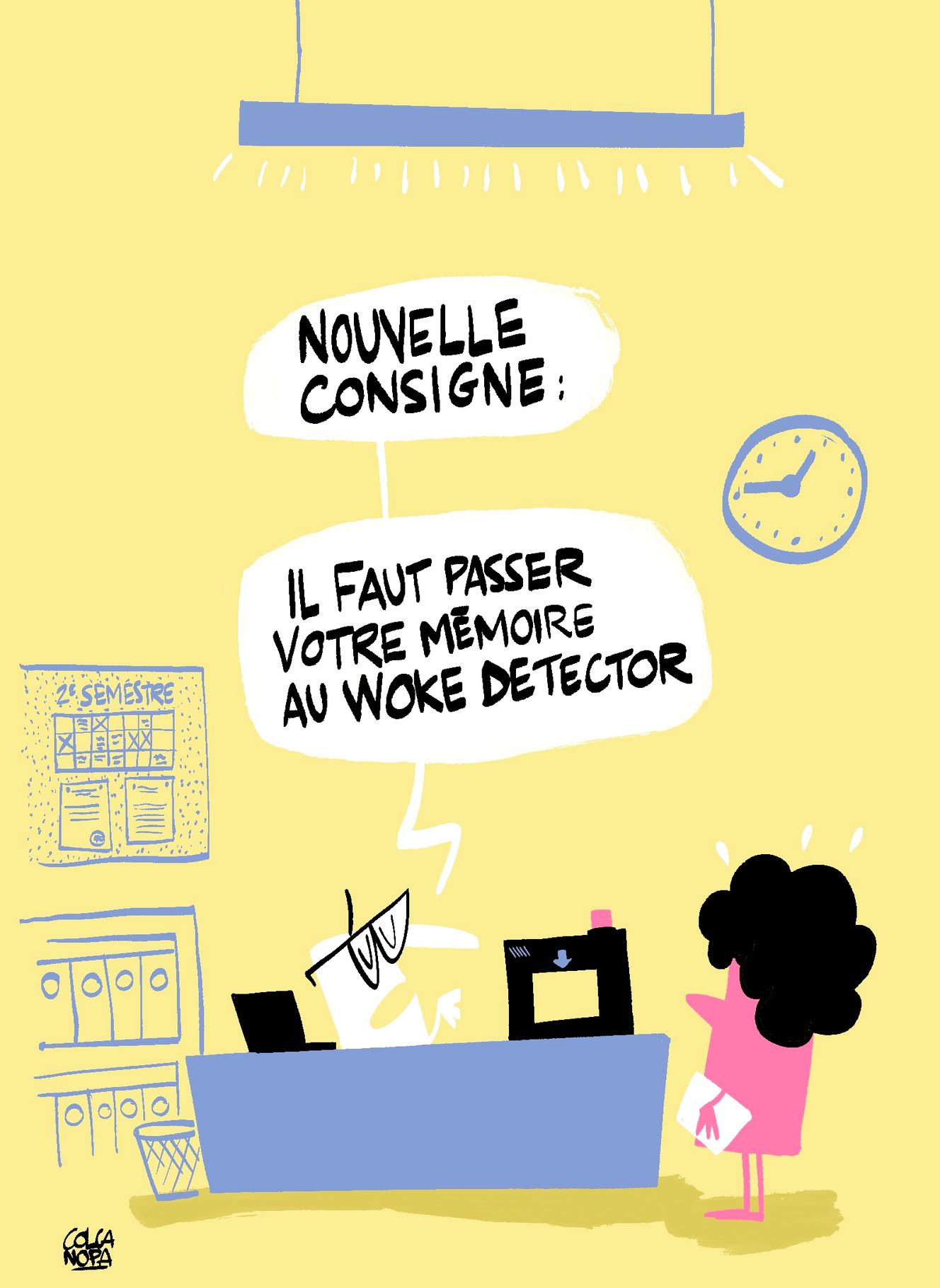
Au cœur des Etats de droit, la liberté de penser, d’enseigner, de mener des recherches, de publier et de débattre à l’abri de toute ingérence, est en péril. L’alerte est lancée par Stéphanie Balme, directrice du Centre de recherches internationales à Sciences Po, dans un rapport intitulé « Défendre et promouvoir la liberté académique », qu’elle doit remettre, mercredi 15 octobre, lors d’un colloque de l’association des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur, France Universités.
Défendre la liberté académique des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche est « un enjeu mondial, une urgence pour la France et l’Europe », car le cadre de la démocratie constitutionnelle, aussi ancré soit-il, ne suffit plus à assurer, à lui seul, la protection effective d’un espace scientifique, affirme l’étude qui dresse, sur 200 pages, un état des lieux des plus inquiétants aux quatre coins de la planète.
Alors que plus de la moitié de la population mondiale réside dans des régions où la liberté académique est soit « complètement » soit « sévèrement » restreinte, « il ne serait pas raisonnable de ne pas y réfléchir aussi en France », souligne auprès du Monde Stéphanie Balme. Des universitaires français lui ont confié « qu’ils s’interrogent sur les limites de ce qu’ils peuvent légitimement dire ou écrire, même lorsqu’ils savent qu’ils en ont le droit, voire le devoir ».
Définir l’agenda scientifique
Comment en est-on arrivé là ? Trois tendances sont à l’œuvre, selon Lamri Adoui, président de France Universités – qui avait commandé ce rapport en 2023 : « La remise en cause de la science, la viralité de “l’information-déni” et la fragilisation, voire les attaques envers l’institution universitaire. » Un « climat toxique » qui, en cas de basculement politique, « prépare les esprits au fait de restreindre la liberté académique, certains estimant normal qu’il y ait une reprise en main ».
Tel fut le cas aux Etats-Unis. « Donald Trump n’est pas contre la science, mais contre la science telle qu’elle est faite, illustre Stéphanie Balme. Il voudrait que les établissements proposent des enseignements différents, faisant l’impasse sur tel ou tel objet scientifique. » En Chine, Xi Jinping promeut, quant à lui, une définition de la science réduite au seul rôle de vecteur de puissance, au nom d’un « techno-nationalisme triomphant », par ailleurs hostile à tout savoir critique.
Partout dans le monde s’affirme l’idée que la sphère politique a le droit de « définir l’agenda scientifique ». « Evidemment, pour parler de physique quantique, il faut être un expert. Mais quand il s’agit de la santé, du climat, de l’immigration… le discours politique considère qu’il n’y a pas de savoir académique qui prévaut », ajoute la chercheuse.
En France, ces dernières années, les atteintes à la liberté académique ont été le fait, minoritairement, d’universitaires eux-mêmes, mais majoritairement d’acteurs extérieurs, décrit le rapport : dirigeants politiques ou groupes de pression menant des campagnes médiatiques orchestrées, dont la virulence et la systématicité évoquent « une forme de maccarthysme contemporain 2.0 ».
Plusieurs approches critiques en sciences humaines et sociales continuent de faire l’objet d’« amalgames idéologiques », souvent qualifiées de manière péjorative de « dérives décoloniales », de « wokisme » ou d’« islamo-gauchisme », souligne le rapport.
Contenus jugés « sensibles »
Dans le contexte de la guerre entre Israël et Gaza, qui a polarisé l’espace intellectuel, des conférences ont été annulées sur fond de polémiques ou d’invocation de risques de trouble à l’ordre public, des sanctions disciplinaires ont pu être engagées contre plusieurs universitaires. L’ouvrage de l’historien israélien Ilan Pappé, Le Nettoyage ethnique de la Palestine (Fayard, 2008), a ainsi été retiré du catalogue de son éditeur fin 2023. Il a été réédité en mai 2024 aux éditions La Fabrique.
« Certaines personnalités politiques ont cherché à intervenir directement dans la vie universitaire », poursuit le rapport, comme lorsque Gabriel Attal, alors premier ministre, s’était invité à la séance du conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), le 13 mars 2024.
La chercheuse souligne que le nombre de procédures bâillons augmente, de même que les retraits de financements de recherche ou de bourses doctorales, y compris de la part de collectivités locales, « au prétexte de contenus jugés sensibles ou polémiques ». Par ailleurs, des chercheurs français ont été privés de liberté à l’étranger, notamment en Iran, en Russie ou en Tunisie. D’autres se sont vu interdire l’accès à leur terrain d’enquête ou en ont été expulsés.
Pour Stéphanie Balme, il est urgent de former à la liberté académique comme on forme déjà à l’importance de la liberté de la presse, à travers l’éducation civique. « C’est un peu comme si on était à la fin du XIXe siècle, au moment où on se demandait quel droit de la presse il nous fallait », compare l’universitaire.
Campagne de sensibilisation
Parmi 65 propositions, dont France Universités a extrait les 10 principales pour les soutenir officiellement, figure l’inscription du principe de la liberté académique dans la Constitution. Cette initiative n’est pas sans risque, alors que l’étape, cruciale, de la définition du concept par les élus pourrait impliquer au contraire une certaine restriction de cette liberté. Sans compter la difficulté que représente actuellement l’obtention d’une majorité des voix des parlementaires réunis en congrès.
Le rapport préconise aussi d’instaurer un régime autonome de protection des sources pour les chercheurs en s’inspirant du secret des sources journalistiques et de lutter contre les procédures bâillons avec des amendes réellement dissuasives. Les universités elles-mêmes sont appelées à systématiser la protection fonctionnelle des enseignants-chercheurs lorsqu’ils sont attaqués, à désigner un référent et à définir un protocole de réponse d’urgence.
Stéphanie Balme souhaite lancer une vaste campagne auprès de la société civile. Elle en appelle aux dessinateurs pour concevoir des « représentations humoristiques de la liberté académique ».
A l’échelle européenne, la chercheuse invite à la création d’un indice européen de la liberté académique, à intégrer aux classements internationaux. Un observatoire européen de la liberté académique pourrait, en outre, proposer une cartographie des risques et une plateforme de signalement. Stéphanie Balme doit présenter son rapport à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, lors d’une conférence sur la diplomatie scientifique européenne, les 17 et 18 décembre.
[Source: Le Monde]