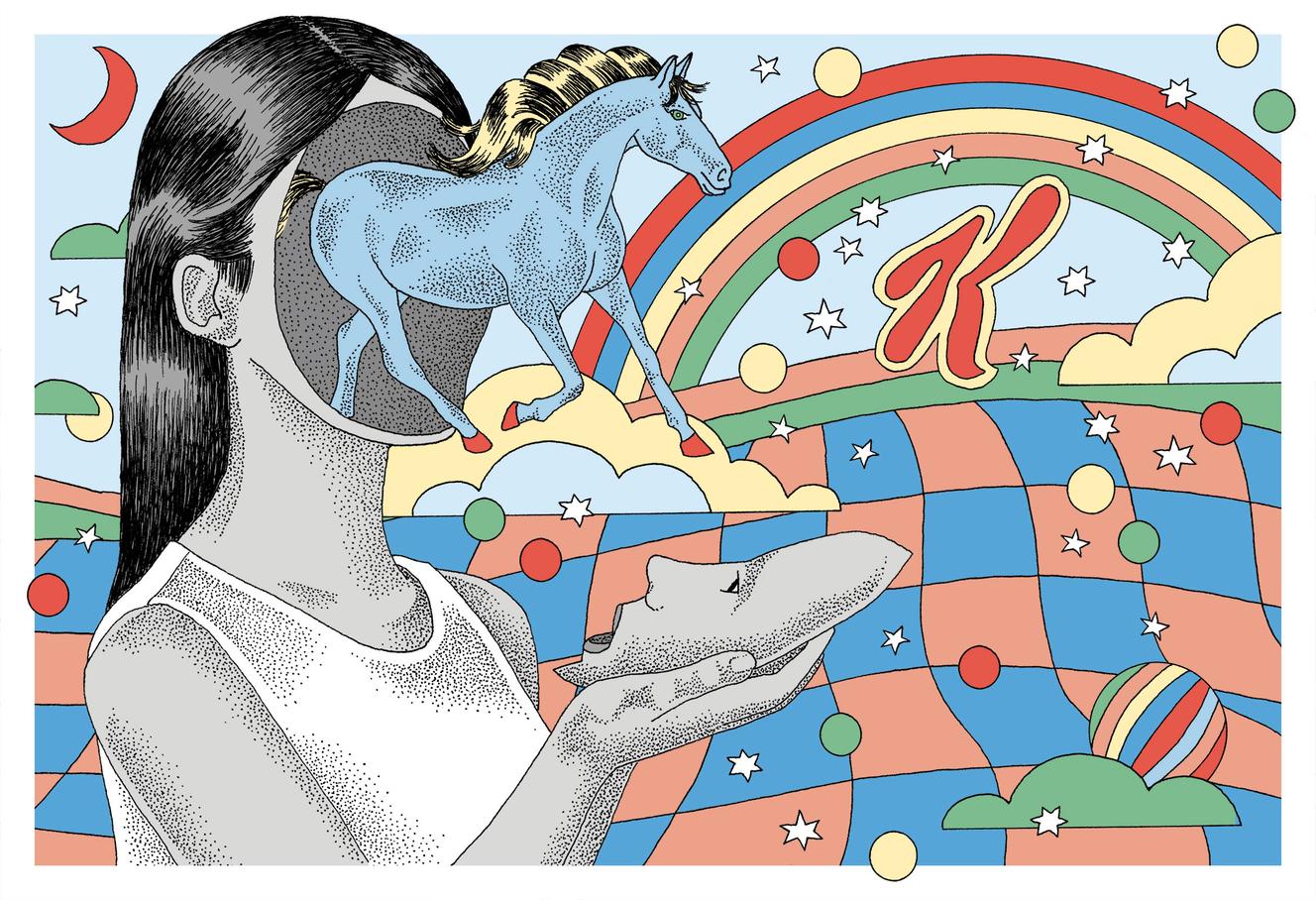Violences à l’école : l’internat, lieu privilégié des agressions
La commission d’enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires souligne l’importance des internats dans le schéma d’agression d’élèves. Dans leur rapport, publié le 2 juillet, les deux corapporteurs plaident pour un contrôle des locaux au moins une fois tous les trois ans.

Parmi les facteurs aggravant les risques de violences sexuelles dans les établissements scolaires, un paramètre semble dominer les autres : l’existence d’un internat. « Au-delà du cas de Bétharram, la présence d’internats revient dans tous les établissements (…) où sont décrites des violences systémiques, à l’exception notable du collège Saint-Pierre au Relecq-Kerhuon [Finistère] », écrivent les corapporteurs de la commission d’enquête parlementaire sur la prévention des violences dans les établissements scolaires, les députés Paul Vannier (La France insoumise, Val-d’Oise) et Violette Spillebout (Renaissance, Nord), dans leur rapport rendu public mercredi 2 juillet.
Le rôle des internats comme lieux favorisant les violences a été précisé, devant la commission, par Jean-Marc Sauvé, le président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase). Il a rappelé que la « prévalence près de trois fois supérieure des violences sexuelles dans les établissements privés catholiques s’explique en grande partie par la présence d’internats plus nombreux en leur sein », résument les rapporteurs.
Si ce n’est plus le cas aujourd’hui, les internats étaient en effet « près de deux fois plus nombreux dans les établissements privés : les données disponibles font état d’une part d’élèves internes de 11 % dans les établissements publics en 1970-1971, passée en 1983-1984 à 6,1 %, quand, aux mêmes dates, les établissements privés comptaient un taux d’élèves internes respectivement de 22 % et 11,2 % ». En 2023, 39 000 élèves étaient internes dans l’enseignement privé, et 144 000 dans le public. L’internat comme facteur aggravant des violences vaut, du reste, indépendamment du caractère confessionnel de l’établissement : selon les chiffres de la Ciase, sur les 191 000 cas de violences sexuelles dans l’enseignement public entre 1940 et 2020, 50 000 ont eu lieu dans des internats.
« Des lieux de vulnérabilité »
Le lien entre internats et violences sexuelles est évident à plusieurs titres : lieux de plus grande promiscuité, mais également de moindre surveillance durant la nuit, les internats créent un « effet d’aubaine » pour les agresseurs – les corapporteurs ayant pris soin de rappeler que la prédation à l’égard d’enfants est aussi affaire d’opportunité.
« Ma conviction, qui est celle de la Ciase également, est que les internats sont des lieux de vulnérabilité au regard des agressions sexuelles, car l’encadrement, qu’il soit laïque, religieux ou mixte, a accès aux jeunes vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Là où, dans un externat, le temps de face-à-face individuel est beaucoup plus limité », atteste Jean-Marc Sauvé au Monde. De plus, les internes ont longtemps été envoyés dans des institutions loin de chez eux, dont ils ne revenaient que pour les vacances scolaires, « voire une fois par trimestre », insiste Jean-Marc Sauvé : le fait d’être coupés de leur famille rendait les élèves particulièrement vulnérables.
Le choix de l’internat a aussi progressivement changé de signification : s’il a longtemps été choisi pour des raisons d’éloignement géographique, il s’est transformé, au fil du temps, en dernier recours éducatif, choisi pour sa dureté et présenté comme une punition à des enfants considérés comme difficiles. Des contextes de « rupture ou de conflits familiaux, que les agresseurs exploitaient volontiers », résument les corapporteurs. Ce choix d’un établissement « à la dure » explique aussi, en retour, l’invisibilisation des violences sexuelles : les parents ayant accepté, même tacitement, un contrat éducatif où le recours à la violence physique est possible, le basculement dans la violence sexuelle a pu être tu par les victimes, persuadées qu’on ne les écouterait pas.
Face à ces constats, la commission parlementaire recommande d’instaurer un contrôle régulier des internats, « chaque année pour le premier degré, et au maximum tous les trois ans pour le second degré », et de distribuer aux internes, tous les ans, une charte des droits de l’élève interne. « Le contrôle des internats constitue un enjeu essentiel dans la mesure où ces lieux sont surreprésentés dans les statistiques relatives aux violences, a fortiori sexuelles, dans les établissements scolaires », martèlent les auteurs.
« Engagement actif »
L’éducation nationale a identifié le risque lié aux internats, à la faveur de la prise de conscience qui a suivi l’affaire de Bétharram. Dans le cadre du plan « Brisons le silence, agissons ensemble » annoncé par la ministre Elisabeth Borne, en mars, le ministère a prévu la diffusion de questionnaires auprès des élèves des internats, chaque trimestre, ainsi qu’au retour de voyages scolaires « dès lors qu’ils comportent une nuitée ». L’éducation nationale a également créé un guide du contrôle des établissements sous contrat, entré en vigueur au début de l’année, qui rappelle que « les locaux de l’internat, même situés en dehors de l’enceinte de l’établissement, font partie intégrante de l’établissement (…) de sorte que des opérations de contrôle par les services de l’éducation nationale peuvent y être menées ».
Le secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC) s’est, lui aussi, saisi du sujet. Lors d’une conférence de presse, le 19 juin, son dirigeant, Philippe Delorme, a indiqué que l’enseignement catholique prenait « l’engagement actif » de « garantir des internats sûrs ». Pour ce faire, le SGEC va « entrer dans un processus de certification de tous ses internats », au nombre de 596, dont 138 dans l’enseignement agricole. La première étape consistant, toujours selon Philippe Delorme, à réaliser un « audit » de l’ensemble des internats sur l’année scolaire 2025-2026.
« S’ils seront vigilants quant à la transparence des résultats de ces audits, [les rapporteurs] considèrent toutefois que ceux-ci s’inscrivent en complémentarité (…) mais n’ont pas vocation à se substituer au contrôle de l’Etat », répond la commission d’enquête parlementaire. Le rapport rappelle, en outre, que le secrétaire général du secrétare général de l’enseignement catholique, s’il a finalement annoncé la certification des internats, s’était vivement opposé à la fiche numéro 5 du guide de contrôle des établissements privés – celle qui concerne la vie scolaire et les internats –, dans un courrier à la direction des affaires financières de l’éducation nationale, le 29 novembre 2024.