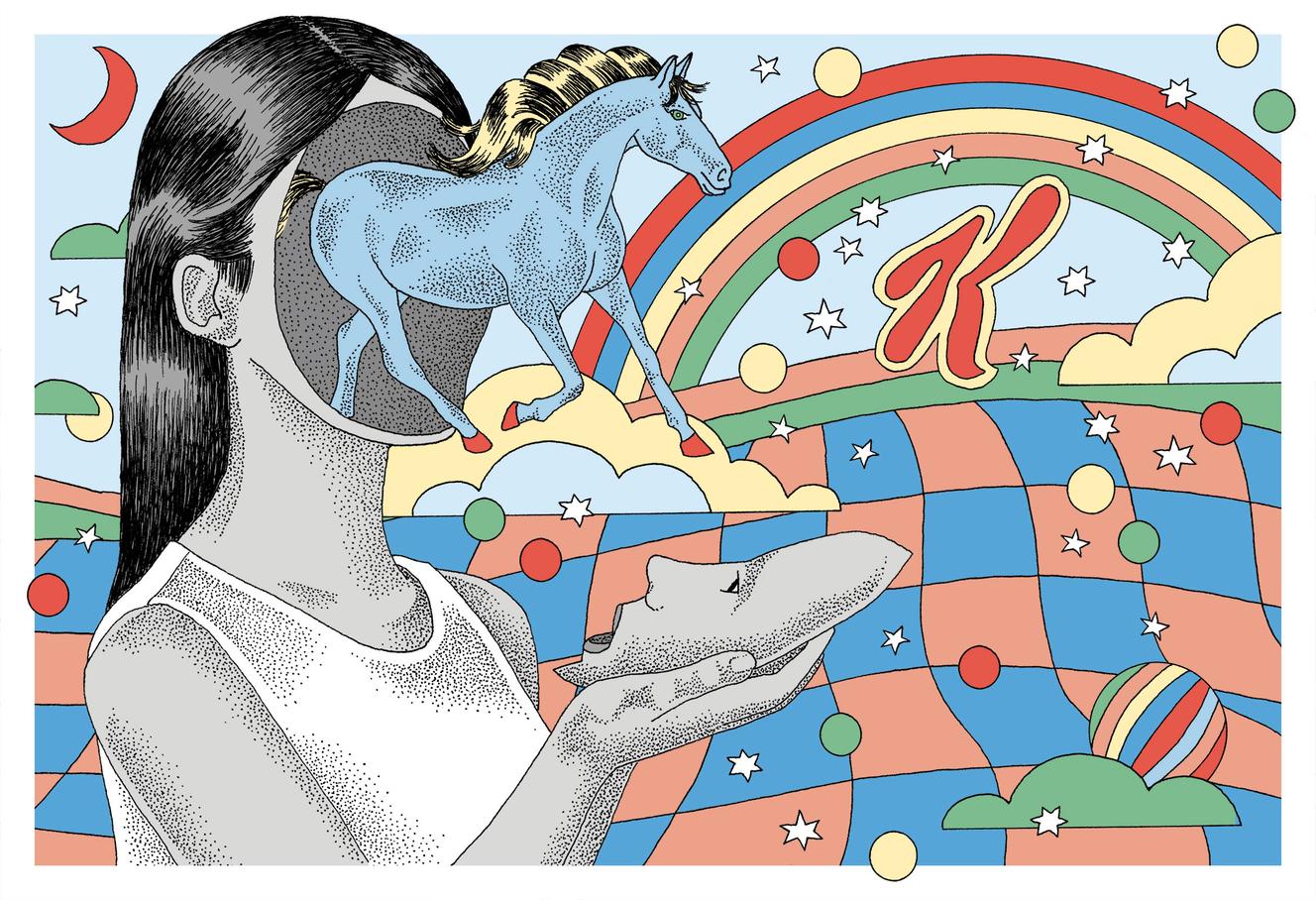La « gen Z » dans « Le Monde », des rêves de changement à génération anxieuse
Les récentes manifestations qui déstabilisent les élites vieillissantes de plusieurs pays du Sud sont menées par des jeunes de la « génération Z ». L’expression apparaît pour la première fois dans les colonnes du quotidien du soir en mars 2009.

Dans le sillage de manifestations qui ont agité le Népal, le Pérou ou encore Madagascar ces dernières semaines, le Maroc connaît, depuis le 27 septembre, un mouvement social important mené par le collectif « GenZ 212 » – 212 est l’indicatif téléphonique du Maroc. Cela fait trois ans que la vague de protestation menée par la génération Z – nom donné à ces jeunes nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010 – déstabilise les élites vieillissantes et corrompues de plusieurs pays du Sud.
Un cliché insistant fait pourtant de ces « zoomers », comme on les surnomme aussi pour évoquer leur agilité numérique (du verbe to zoom, « rouler à toute vitesse »), une jeunesse accro aux selfies et boudant le champ politique. Les archives du Monde racontent surtout l’avènement d’une génération angoissée, qui oscille entre individualisme et nouvelles formes de militantisme.
C’est d’ailleurs pour désigner le réveil militant d’enfants de la dictature que l’expression est apparue pour la première fois dans Le Monde. Le 27 mars 2009, Anaïs Favre brosse le portrait de la « génération Z » de Birmanie. Ces jeunes Birmans qui n’ont jamais connu que la junte, les courriels lus par la censure et les téléphones portables sur écoute, s’affranchissent des traditions et rêvent de changement. Ils ont été désignés comme la « génération Z » en écho à la « génération 88 » de leurs parents : en 1988, année de l’arrivée au pouvoir de la junte, le régime du général Ne Win avait réprimé avec une violence inédite un mouvement de contestation étudiant.
Une plus grande liberté
Dans cet article, on croise notamment Min Thu, 22 ans, un étudiant en économie, fils de petits commerçants de textile, le premier de sa lignée à avoir définitivement rejeté le longyi, un vêtement traditionnel fait d’une grande étoffe légère que les Birmans nouent autour de leur taille en guise de pantalon-jupe. Ou encore Nay Mar, 23 ans, masseuse dans un spa, fan de Shakira et des Backstreet Boys, qui sortait dans la rue en jean ou en pantacourt. Tous espéraient alors, sans trop y croire, que le développement économique de la Birmanie amènerait une plus grande liberté politique.
Il faudra attendre quelques années avant que la génération Z ne devienne une catégorie sociologique bien établie. Et c’est au sein du monde de l’entreprise que les désirs de changement des petits-enfants des boomeurs se font le plus entendre. Dans une chronique publiée en janvier 2015, Annie Kahn décrit comment les aspirations de la « gen Z » à plus de liberté et de bien-être au travail, bousculent les patrons.
Les zoomers réclament des entreprises plus humaines, un mode de fonctionnement moins hiérarchique et – cinq ans avant les confinements et le boom du télétravail – plus flexible, en matière d’horaires et de lieux de travail. C’est d’ailleurs pour les séduire que le recours à des « chief happiness officer », chargés du bonheur des salariés, se développe.
Les marques de cosmétique sont particulièrement attachées à plaire aux zoomers, la génération « selfie » comme l’appelle M Le magazine du Monde dans une enquête signée Lili Barbery-Coulon en avril 2016. On y découvre qu’une jeune femme appartenant à la « génération Z » dépense en moyenne 37 euros par mois en produits de beauté. Celles qui ont grandi avec un smartphone dans la poche maîtrisent leur image à la perfection. Elles sont expertes en retouche de photos et parlent « contouring », « zone T » ou « paupière libre », comme des maquilleuses professionnelles. Un savoir-faire appris grâce aux « tutos beauté » qui essaiment sur YouTube.
Santé mentale
La « gen Z » a sa marque de rouge à lèvres fétiche, mais aussi ses porte-drapeaux, comme la californienne Billie Eilish, dont Charlotte Chabas, en février 2020, nous apprend qu’elle revendique son véganisme et se montre régulièrement à Los Angeles aux côtés de jeunes militants engagés contre le réchauffement climatique, « les adolescents de la génération Z (…) l’adulent », constate-t-elle, ou encore la chanteuse Dua Lipa, racontée par Auréliano Tonet en mars 2021, en « Madonna de la génération Z ».
Car la génération Z a de nombreuses raisons d’être inquiète. Elle serait même la « génération anxieuse » par excellence, selon l’expression du spécialiste de psychologie sociale Jonathan Haidt. Dans une interview publiée en mars 2025, l’auteur de Génération anxieuse. Comment les réseaux sociaux menacent la santé mentale des jeunes (Les Arènes) détaille l’impact cognitif dévastateur d’une enfance passée devant des écrans. D’après lui, les chiffres sur l’anxiété, la dépression et l’automutilation connaissent une très forte hausse parmi la génération Z, plongée depuis toujours dans ce monde de comparaison permanente induite par les réseaux.
« Les enfants, particulièrement les filles, qui passent beaucoup de temps en ligne sont bien plus anxieux et sujets à la dépression, explique-t-il. Des expériences ont également été conduites au cours desquelles on demande aux gens de réduire le temps qu’ils passent sur les réseaux sociaux. La première journée est généralement marquée par une plus grande anxiété, à cause de l’effet de manque. Mais au-delà d’une semaine, ils se sentent mieux. » Et de considérer que l’arrivée de l’intelligence artificielle constitue une menace encore plus grande, rendant les écrans encore plus captivants. A moins que cette anxiété ne se transforme en un nouveau ferment de révolte.
[Source: Le Monde]