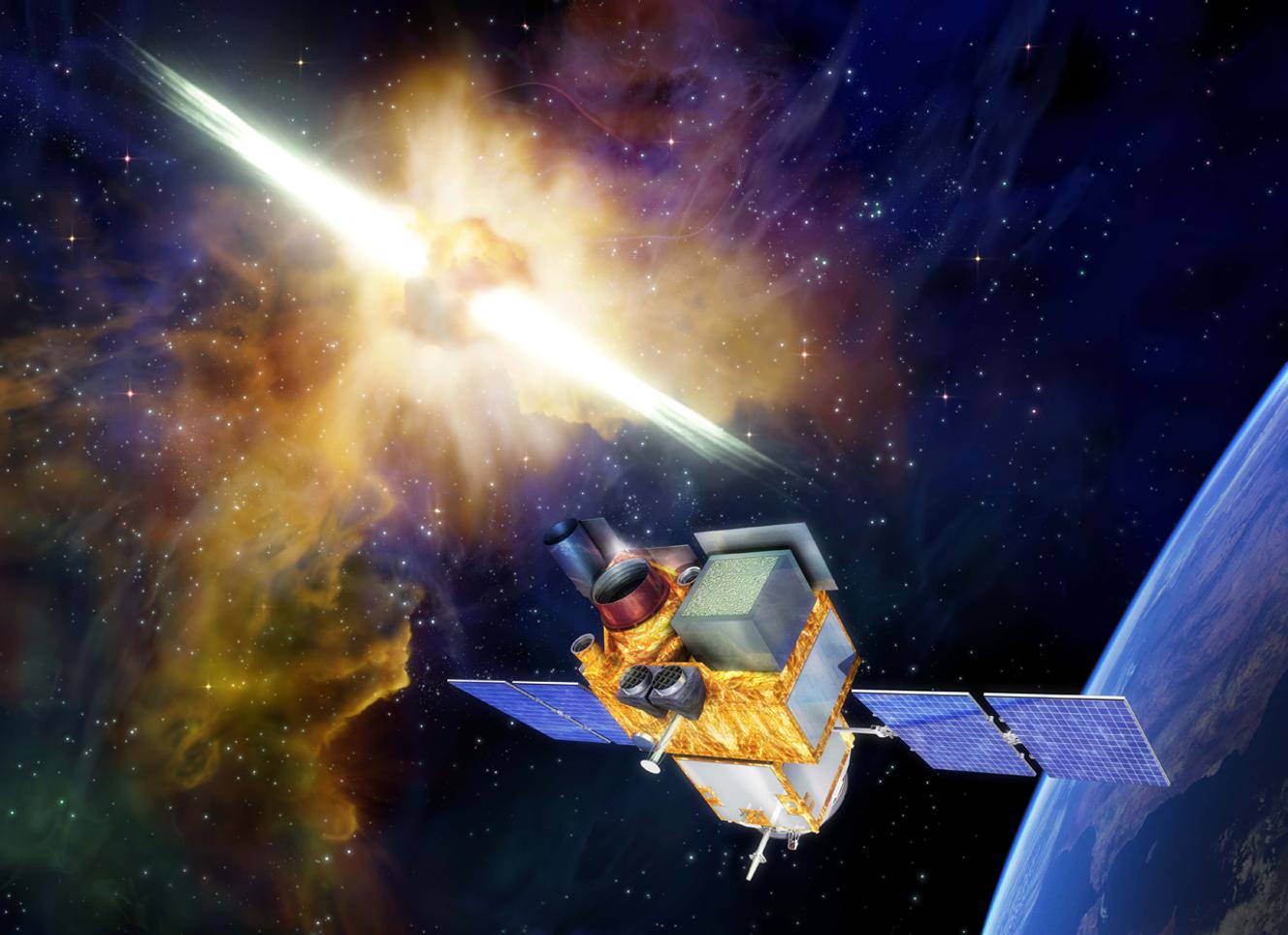Et si les manageurs arrêtaient d’avoir peur du « non-travail » ?
« Work in progress ». Pause café, flânerie en ligne, sieste : ces moments de distance avec le labeur sont aussi utiles au travail, estime dans sa chronique Nicolas Santolaria, journaliste au « Monde ».

ll ne vous aura pas échappé que se diffuse actuellement en entreprise une petite musique relative au retour sur site des salariés et à la remise en question des acquis liés au télétravail. Les raisons qui sont mises en avant par les employeurs sont souvent l’émulation, la productivité, la cohésion de groupe, autant de mots magiques qui consacrent la fréquentation assidue des humeurs de vos collègues comme un summum d’accomplissement professionnel.
Vous vous en doutez, derrière ce beau discours se cachent parfois des motivations plus douteuses. Dans un article publié sur le site The Conversation et intitulé « Le télétravail est-il devenu le bouc émissaire des entreprises en difficulté ? », Anthony Hussenot et Claire Estagnasié voient dans ce mouvement de rétropédalage un moyen de parfois pousser à moindres frais les salariés vers la sortie et, plus généralement, la manifestation d’une « pensée managériale conservatrice » qui gagne incontestablement du terrain. « Après une tendance à la flexibilité, le virage actuel dans certaines entreprises ressemble à un retour au “deuxième esprit du capitalisme”, fondé sur la hiérarchie et le contrôle. »
En d’autres termes, le problème n’est pas tant le télétravail lui-même – bien mis en œuvre, il possède de nombreuses vertus – que la conception totalement datée du travail qui se revivifie et s’agite de manière aussi désordonnée qu’un zombie sorti de sa tombe, contaminant progressivement les esprits. Dans cette vision passéiste, le travail serait cette activité pleine et entière, aussi dense et concrète que du beurre de cacahuète. On peut voir là un vieil héritage du taylorisme, dont l’organisation rationnelle et chronométrée de l’activité visait à éradiquer tout moment improductif. En soustrayant le salarié à la supervision directe du chef, le télétravail inciterait alors, pensent aujourd’hui de nombreux manageurs, à une forme d’implication moindre, parasitée par une session de courses au Monoprix et un rendez-vous chez l’orthodontiste avec votre petit dernier. Ce n’est pas faux, mais ce n’est pas vrai non plus.
Une part de flânerie
Cette vision, constate Sophie Rauch dans son fort recommandable ouvrage On se fait une pause ? Cafés, réunions, pauses sur Internet… : ce que le non-travail dit de nous (Vuibert, 224 pages, 19,90 euros, numérique 15 euros), traduit un « hiatus paradoxal entre représentations dominantes et expériences quotidiennes du travail ».
Pour cette chercheuse en sciences de gestion, la vie professionnelle est précisément marquée par une part de flânerie, de soustraction aux impératifs instrumentaux, qui en constitue un impensé. Ces « activités de non-travail » prennent des formes diverses (trente-huit manifestations différentes sont ici répertoriées, allant de la pause-café à la procrastination en ligne) et participent de la ritualité propre au travail lui-même.
Ces moments de « non-travail » peuvent aussi bien servir de tremplin vers l’activité que témoigner d’une incapacité à s’y mettre, éventuellement signe d’une souffrance personnelle. Permettant de se vivre autrement que comme un rouage processuel, le non-travail ménage une place à l’humain véritable et à sa complexité au sein de l’activité. Son utilité n’est donc pas à analyser à la seule aune de la productivité.
« Avoir une meilleure connaissance de son non-travail permet d’apprendre énormément de choses sur son moi professionnel », note Sophie Rauch. En résumé, il faut arrêter d’envisager le télétravail comme le ferment pernicieux du non-travail, et le non-travail comme de l’antitravail. Une fois qu’on aura compris tout ça, on pourra se remettre au boulot.
[Source: Le Monde]