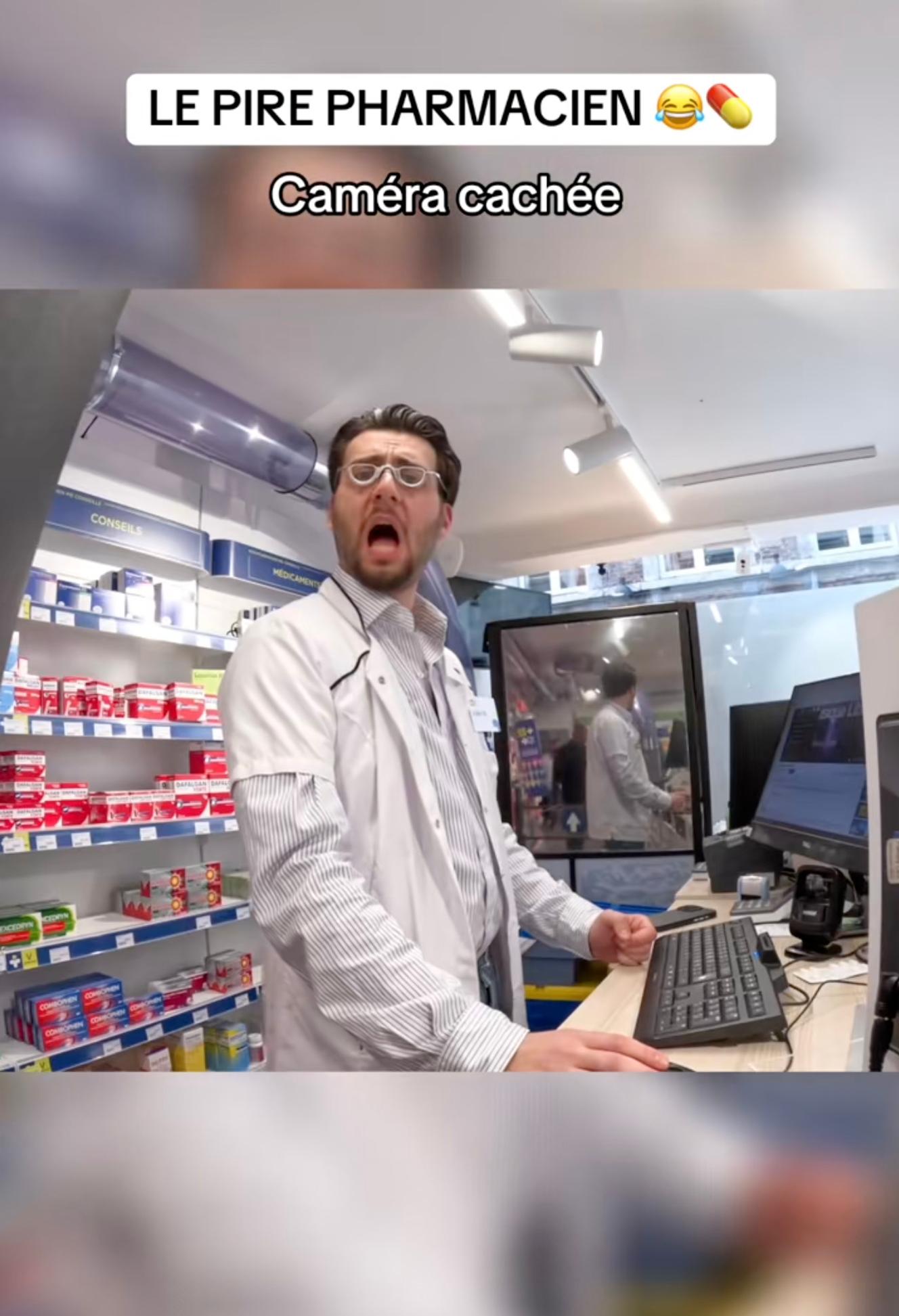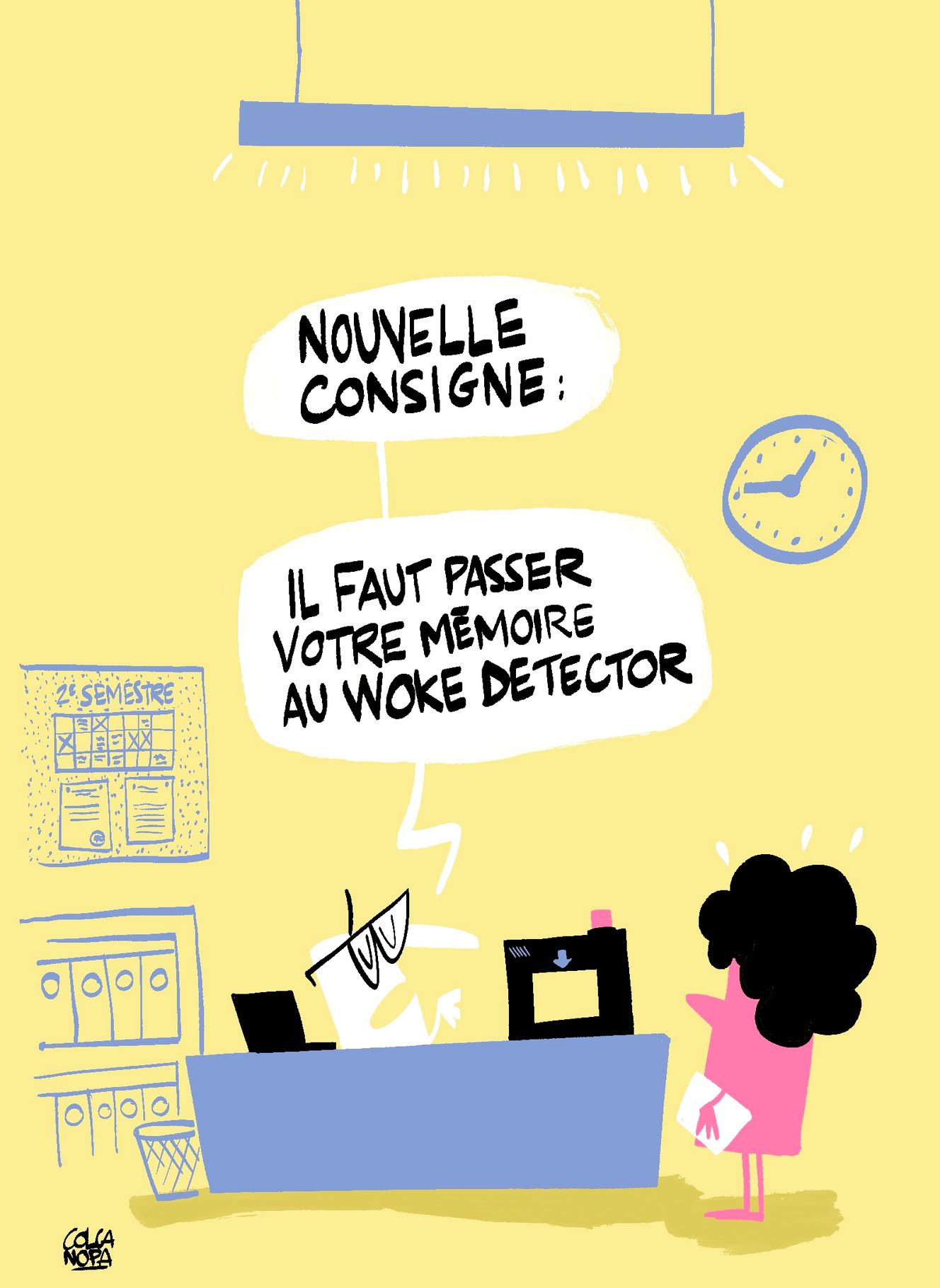L’atout des mini lémuriens pour devenir des cobayes
Une équipe internationale a pratiqué la dissection de quatre microcèbes mignons et établi un atlas de leurs cellules. Certaines ressemblances avec les cellules humaines seraient utiles pour la recherche biomédicale.

Ils pèsent à peine 50 grammes et font partie des plus petits primates. Mais ce ne sont pas leurs yeux gros comme deux billes, leurs grandes oreilles ni leur queue caractéristique qui ont amené une équipe de chercheurs internationaux à s’intéresser au génome des microcèbes mignons (Microcebus murinus). Historiquement plus proches de l’humain dans le développement des espèces, ils sont étudiés pour leur potentiel de modèle de laboratoire.
Avec l’examen de 27 organes comme le foie, le système auditif, le sang ou encore le cœur, issus de quatre individus euthanasiés car porteurs de maladies incurables, les chercheurs ont répertorié 226 000 cellules dans un atlas, publié dans Nature le 30 juillet. Pour ce faire, ils ont utilisé le séquençage ARN unicellulaire. La cellule est isolée pour extraire son bagage génétique, et identifier les gènes qu’elle exprime grâce à l’ARN, lui-même transcrit depuis l’ADN, qui leur attribue une fonction unique : pulmonaire, cardiaque, immunitaire…
Après l’identification des types de cellules de ces petits lémuriens de Madagascar, l’enjeu est de savoir lesquels sont communs avec d’autres espèces. Les chercheurs ont comparé les ARN avec celui de cellules d’humains, de souris et de macaques. Ils ont comparé plus de 60 types de cellules et ont trouvé des mécanismes communs à l’humain et au lémurien qui diffèrent parfois chez la souris : « A l’avenir, nous espérons pouvoir comparer tous les types de cellules de l’organisme chez un grand nombre d’espèces, mais pour l’instant, la majorité ne dispose pas d’ensembles de données similaires de grande qualité », relève Camille Ezran, chercheuse au Département de biochimie de l’université Stanford et première autrice de l’étude.
Rechercher de meilleurs modèles
Ces similitudes intéressent la recherche médicale, qui étudie des animaux au fonctionnement semblable au corps humain, pour mieux comprendre ce dernier. Jusqu’ici, les souris restent les modèles privilégiés des laboratoires. Bien qu’assez éloignées des humains, elles conservent cependant de nombreux gènes en commun. En outre, leur cycle de reproduction rapide permet de faire des recherches sur des vies complètes ou sur plusieurs générations en quelques années. Alors, pourquoi rechercher d’autres animaux modèles ? « Pour identifier certains gènes potentiellement intéressants qui ne sont pas exprimés chez la souris de la même manière que chez l’homme, et pour lesquels le lémurien pourrait être un meilleur modèle », détaille Camille Ezran.
« C’est un cas typique où l’étude d’une nouvelle espèce permet de découvrir des aspects qui avaient été mal interprétés ou simplement ratés sur les espèces très étudiées », ajoute Sophie Pantalacci, directrice de recherche de l’équipe Comparative and Integrative Genomics of Organ Development (Génomique comparative et intégrative du développement des organes, Cigogne) du CNRS, qui n’a pas participé à l’étude. Elle relève cependant que « le risque en étudiant des individus sacrifiés parce qu’ils étaient malades, c’est de lancer les futures recherches sur de mauvaises pistes ». Dans un article de commentaire, publié le même jour par Nature, le biologiste suisse J. Gray Camp accueille cet atlas comme « un grand pas en avant, car il fournit non seulement une base solide pour les études futures sur la biologie et les maladies des primates, mais constitue également une référence pour le développement d’autres organismes modèles émergents ».
L’atlas, pensé comme un outil en accès libre à destination de la communauté scientifique, est mis à l’épreuve par la même équipe dans une seconde étude, publiée dans Nature, où il sert pour une analyse approfondie. L’équipe y identifie plus de 500 gènes humains qui ne se retrouvent pas chez la souris mais sont bien présents chez le microcèbe mignon. Ces gènes pourraient être liés à des maladies ou jouer des rôles importants dans la physiologie humaine, comme le fonctionnement du système intestinal.
[Source: Le Monde]