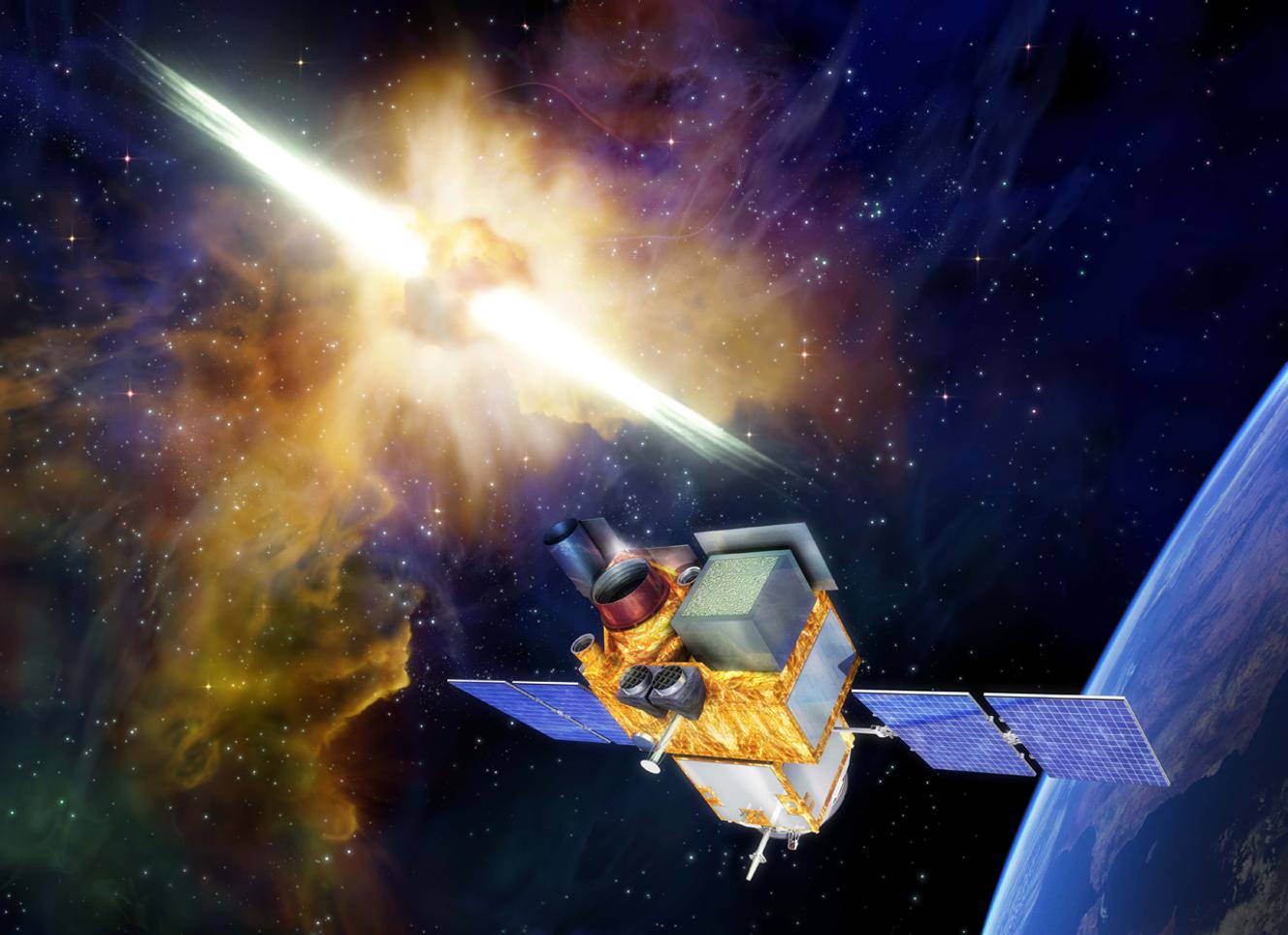Révolution ou coup d'État à Madagascar: l'armée est-elle vraiment du côté de la Gen Z?
À Madagascar, le colonel Michael Randrianirina a prêté ce vendredi 17 octobre serment comme chef de l'État. Une période de transition s'ouvre trois semaines après le déclenchement de la contestation de la Gen Z contre le régime du président Andry Rajoelina. S'agit-il d'une alliance de circonstances ou d'une adhésion au changement en profondeur demandé par la jeunesse et attendu par l'ensemble de la population?

"Un coup d'État, c'est quand les soldats entrent dans le palais présidentiel avec des armes, qu'ils tirent, qu'il y a du sang... Ce n'est pas un coup d’État". Voici comment le colonel Michaël Randrianirina, 51 ans, a répondu aux accusations de prise de pouvoir par la force, un jour avant de prêter serment ce vendredi en tant que "président de la refondation de la République de Madagascar".
Il aura fallu pas plus de trois semaines pour que le régime du président Andry Rajoelina s'effondre face à la contestation de la Gen Z conjuguée au soutien des militaires du Corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques (Capsat), importante unité de l'armée basée dans la capitale.
En appelant toutes les forces armées et de sécurité à ne pas tirer sur les manifestants, puis en s’imposant comme seul donneur d’ordres aux forces armées, le Capsat a pris de court Andry Rajoelina qui a fui le pays, abandonnant à son sort son Premier ministre fraîchement nommé.
Qui a fait couler le sang?
Érigé en "héros" dans la rue, le chef de ce camp militaire le colonel Randrianirina a finalement cueilli le pouvoir, sans effusion de sang, souligne-t-il. "Il y a deux jours [le samedi 11 octobre] les militaires et les jeunes avaient présenté cela comme une mesure de protection qui avait permis d'arrêter la violence", rappelle Ketakandriana Rafitoson, vice-présidente mondiale de Transparency International.
L'effet est immédiat dans la capitale malgache, des milliers de manifestants investissent la Place du 13 Mai qui leur était interdite. Des scènes de liesse et un sentiment de victoire s’empare de la foule. Dès le lendemain, une cérémonie d'hommage aux victimes se tient sur cette place symbolique devenue lieu de ralliement. Le bilan humain de la répression reste à établir officiellement tout comme les suites qui seront données à ces tués lors de ces événements. L'ONU avait déploré 22 tués, bilan que le régime Rajoelina avait réfuté.
"La répression très dure a été menée par des forces de sécurité mixte, mêlant l’armée, la gendarmerie et la police. Le refus du contingent du Capsat a fait basculer le mouvement vers cette jonction avec l’armée", observe auprès de TV5MONDE Christiane Rafidinarivo, politologue.
L'irruption du Capsat est un soulagement pour les manifestants. Des affrontements sporadiques ont eu lieu entre hommes en uniforme et un militaire du Capsat et un civil ont été tués, mais tout bain de sang a été évité.
Andry Rajoelina dénonce lui un coup d'État. L'ironie de l'histoire est qu'il est déchu par le même contingent qui l'a mis au pouvoir en 2009, provoquant la chute du président élu Marc Ravalomanana. Propulsé à 35 ans président d'une Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina avait alors paré le coup d'État de 2009 des habits de la Révolution orange.
Des gages pour le maintien des financements internationaux
Aujourd'hui en exil, Andry Rajoelina n'a eu de cesse de dissuader tout changement inconstitutionnel, en brandissant la menace de la coupure des financements internationaux et ses conséquences pour la population.
Cette perspective a été reprise par le président français Emmanuel Macron qui lui aussi avait initialement appelé au respect de l'ordre constitutionnel à l'instar de plusieurs chancelleries voisines, l'Afrique du Sud, les Comores, mais aussi la Communauté Économique d'Afrique Australe (SADC) et l'Union africaine.
Bien qu'excluant de démissionner, la fuite d'Andry Rajoelina a pourtant ouvert la boite de Pandore. Plusieurs initiatives et décisions extraordinaires ont été prises sur le plan juridique. L'Assemblée nationale a voté la destitution du président. Ce dernier a lui annoncé dissoudre l'Assemblée nationale de son exil.
En déclarant prendre le pouvoir, mardi 14 octobre, le Capsat a pris le risque de sortir du jeu légaliste. Par la voix du colonel Michael Randrianirina, le véritable homme fort du Capsat annonce la dissolution du Sénat, de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), la Haute Cour de Justice (HCJ), et le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit (HCDDED). Seule l'Assemblée nationale est épargnée.
Le même jour, la HCC constate la vacance du pouvoir et invite le colonel Randrianirina d'exercer les fonctions de chef de l’État. "Difficile de jouer sur les mots. Il y a bien eu une procédure pour prononcer la vacance du poste de président vu qu'il n'est plus sur le territoire. Donc maintenant il y a cette décision de la HCC", souligne à TV5MONDE Ketakandriana Rafitoson.
Finalement, la HCC est totalement réhabilitée selon le colonel Randrianirina pour sa prestation de serment. Le chef d'État veut inscrire son mandat sous le sceau de la légalité constitutionnelle. La présence d'ambassadeurs notamment américain, français, européens, asiatiques est un signe de reconnaissance tacite du nouveau pouvoir.
La place de la Gen Z dans la transition
Avant même son investiture, le colonel Randrianirina a livré une ébauche de la transition. L'option d'un retour devant les urnes dans les 60 jours après la vacance du pouvoir, conformément à la Constitution, n'est pas privilégiée. À plusieurs égards, la transition malgache présenterait des similitudes avec d'autres pays du continent dirigé par des militaires. D'une durée de 18 à 24 mois, elle devrait mener à un référendum constitutionnel. Selon le colonel Randrianirina, une révision des listes électorales s'impose.
Pour la politologue Christiane Rafidinarivo, "la prochaine phase devait être la nomination d’un Premier ministre de consensus. Le gouvernement de transition dont la mission sera de mettre en place le nécessaire pour le changement institutionnel vers une nouvelle constitution des élections générales". Des réunions de concertation se multiplient à Antananarivo, dont l'issue n'est pas encore joué. L'enjeu est la participation la plus large possible de toutes les catégories, la société civile, les syndicats, les partis politiques, dans les plus grandes villes du pays.
La Gen Z réaffirme de son côté son autonomie. Si elle s'est félicité du ralliement du Capsat, elle a été dépassée par la prise du pouvoir des militaires qui n'était pas une revendication. "Il y a eu ce soupçon de velléité d’accaparement du pouvoir par des militaires. Les jeunes ont essayé entretemps d’élaborer un plan mais il était déjà trop tard", commente Ketakandriana Rafitison. L'effacement de la direction de la Gen Z et la vacance du pouvoir ont laissé le champs libre aux militaires. "C’était un vide politique que les jeunes n’ont pas su combler."
Le précédent de la révolution confisquée du 13 mai 1972
Le colonel Randrianirina n'a de cesse de vouloir donner des gages aux civils, en leur réservant une place prépondérante dans les institutions. La Gen Z compte bien y prendre part. L'enjeu est de "structurer leur mouvement vers l’action politique au sein de ce gouvernement et aborder une nouvelle phase du mouvement non plus l’expression dans la rue mais vers la participation au gouvernement et l’action publique", observe la politologue Christiane Rafidinarivo.
Mais "l’essentiel est de revenir sous la houlette d’une véritable démocratie", insiste Ketakandriana Rafitoson, "car ce que l’on craint, c’est une autocratie militaire si les civils ne sont pas incorporés rapidement dans cette structure." Un tel scénario n'est pas à exclure. Il rappelle celui des événements qui ont suivi le 13 mai 1972, quand la jeunesse malgache s'est révoltée contre la Première République Malgache, qualifiée de néocoloniale et inféodée à la France.
Après des mois d'effervescence révolutionnaire et juvénile du "Mai malgache", c'est l'armée qui, en tant que gardienne des intérêts du peuple, prend le pouvoir. Elle ne le rendra jamais. Plus d'un demi-siècle après, l'histoire de cette révolution confisquée peut-elle se répéter en 2025? Et le politologue et historien Solofo Randrianja de prévenir, "cette fois-ci, Madagascar ne peut plus se permettre l'échec".
[Source: TV5Monde]