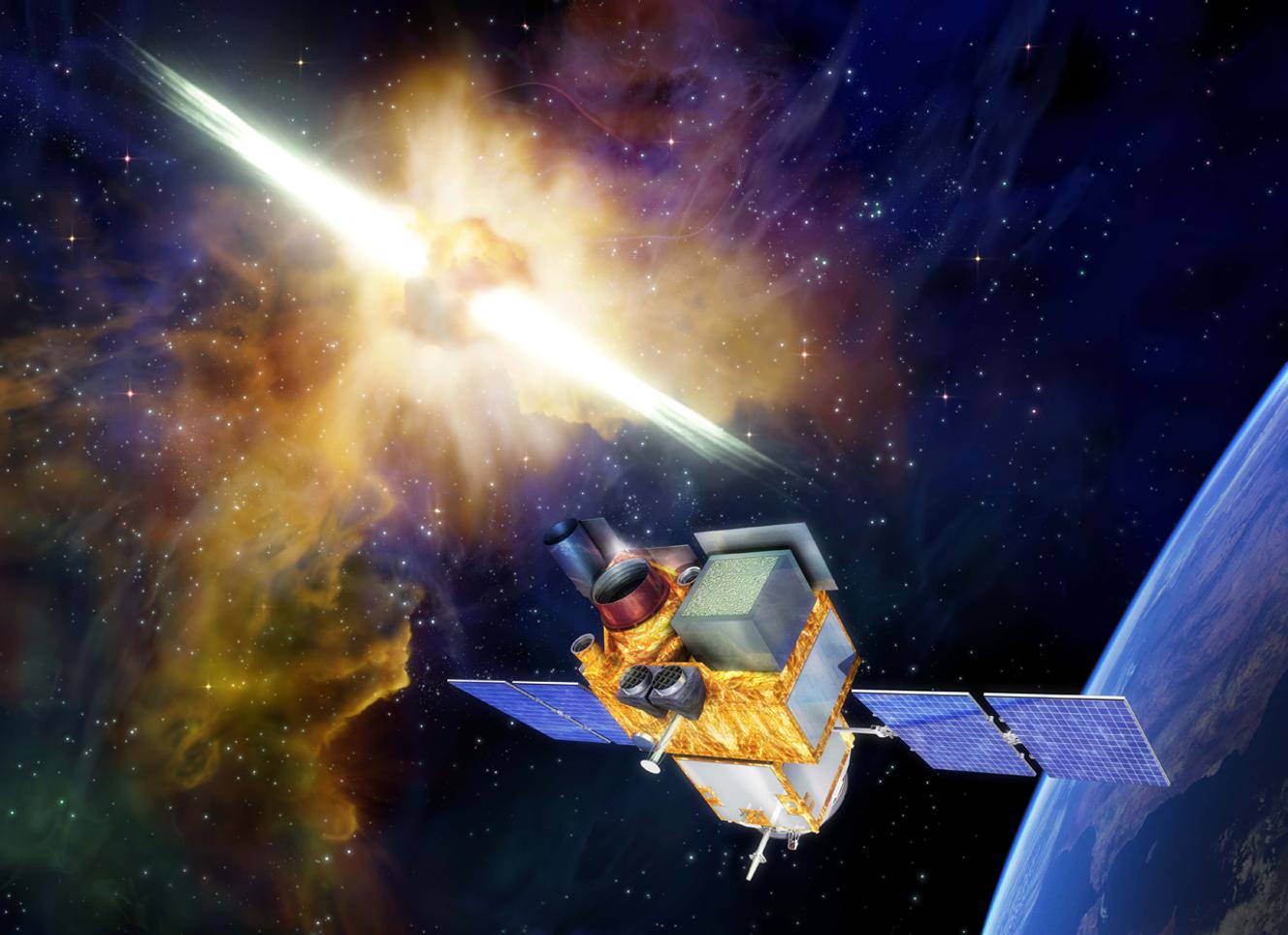Madagascar : Michaël Randrianirina, un putschiste en quête de légitimité
Le chef du Capsat, l’unité qui a renversé Andry Rajoelina, a été investi président, vendredi. Le colonel multiplie les gestes rassurants à l’égard de la communauté internationale, pour éviter à la Grande Ile d’être sanctionnée.

Le colonel Randrianirina, ce presque inconnu que tout le monde, depuis quelques jours à Madagascar, appelle par son prénom – Michaël –, se coule par la porte latérale de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), à Antananarivo. Dans les travées pleines à craquer, vendredi 17 octobre au matin, on ne repère pas tout de suite que l’homme de 51 ans, petite taille, gestuelle calme et composée, qui va être placé à la tête de l’Etat au terme de la cérémonie, a pénétré dans la salle d’audience de l’institution.
Depuis son irruption dans le fil des événements à Madagascar, sept jours plus tôt, lorsque, samedi 11 octobre, il a emmené les militaires de l’unité qu’il commande, le Capsat (contingent du corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques), soutenir les manifestants de la Gen Z, enclenchant la chute du régime du président Andry Rajoelina et le départ du pays en catimini de ce dernier, le colonel Randrianirina a constamment porté des treillis. Tout à coup, vêtu d’un costume, il semble différent.
En kaki, on l’a vu haranguer la foule, juché sur un blindé, puis faire irruption, mardi, devant l’un des sièges désertés de la présidence du centre-ville, à la tête d’un groupe d’officiers, pour se placer à la tête de l’Etat. Cela présentait toutes les caractéristiques d’un putsch. Mais le reconnaître risquait d’entraîner des conséquences immédiates : sanctions, interruption de l’aide internationale. Avec la conséquence, potentiellement, de voir la Russie en profiter pour prendre de l’ascendant à Madagascar. Le Comité national de défense de la transition (CNDT), que préside le colonel, a donc revu son approche.
M. Randrianirina avait annoncé la dissolution de la majeure partie des institutions, à commencer par la HCC. Il a été décidé qu’on faisait machine arrière. il s’agissait de rendre le pouvoir suffisamment légitime avant que soient menées des négociations avec les bailleurs de fonds, destinées à éviter un blocage général du pays.
Vendredi 17 octobre au matin, c’était le premier test d’ampleur pour voir si ces efforts ont porté. A 10 heures, le colonel Randrianirina entre à la HCC pour procéder à sa prestation de serment, portant une veste bleu nuit. Comme tous les détails de la cérémonie, celui-ci a été choisi pour dégager une impression d’austérité rassurante. Il s’agit de faire oublier le treillis et de trancher avec le côté bling, showman brouillon de son prédécesseur, Andry Rajoelina, qu’il évoque par le biais d’une allusion ironique discrète : « Nous, au moins, n’avons pas fui… nos responsabilités. » La salle rit doucement ; elle applaudit à d’autres moments, alors qu’Andry Rajoelina a quitté la Grande Ile pour Dubaï, via La Réunion, dimanche 12 octobre.
Garanties offertes à la Gen Z
En surplomb, sur une estrade, les neuf juges de la HCC, assis derrière un long meuble en chêne dans de grands fauteuils en skaï rouge assorti à leurs robes, semblent hiératiques et un brin tendus, étant donné le flou qui entoure les diverses lectures faites d’une Constitution dont ils ont la lourde tâche d’être les garants.
Il s’agit d’effacer, aussi, l’impression catastrophique des premières heures de la prise de pouvoir de mardi lorsque, sans doute par peur d’un « coup dans le coup » mené par la gendarmerie, les officiers annonçant la création du CNDT avaient donné l’impression de s’emmêler les pinceaux. Depuis, ils semblent avoir tiré profit des conseils de responsables malgaches de divers horizons. L’un d’eux se présente – en ne riant qu’à moitié –, comme un « conseiller de l’ombre ». Il est passé en souplesse du précédent système politique à celui-ci, qui émerge à peine et résume le point de vue de l’élite d’Antananarivo qui, comme lui, migre vers le nouveau pouvoir : « le pays était au bord du gouffre ».
Pour assister à l’investiture de Michaël Randrianirina, il y a foule : de nombreux corps constitués, trois anciens présidents de l’Assemblée, un ancien président du Sénat, des généraux en grande tenue, et le chef de la gendarmerie. Le secteur privé est là aussi, tout comme les jeunes de la Gen Z.
Des efforts ont été faits pour ramener à bord du nouveau pouvoir leurs représentants. Des garanties leur ont été offertes. Ils ne se verront pas, sans doute, décerner de postes au sein du gouvernement de civils qui devrait être nommé dans les prochains jours, mais ils auront leurs représentants dans tous les ministères, et leur mot à dire lors des futures Assises nationales, qui devraient être organisées rapidement.
Au sortir de la cérémonie d’investiture, vendredi, Sariaka Senecal, une des figures du mouvement Gen Z et l’une de ses porte-paroles, se disait satisfaite par l’état des négociations avec le pouvoir : « Ces dernières heures, des ponts ont été créés, de bon augure pour la suite. On a échangé avec le colonel Michaël et ses conseillers. Ils ont compris qu’on ne cherche pas des postes politiques. On veut que nos voix portent, avec nos revendications », dit-elle. Deux jours plus tôt, la jeunesse malgache se disait prête à redescendre dans la rue. « Si le pouvoir ne remplit pas ses promesses, c’est ce qu’on fera », avertit-elle.
Des Assises nationales pour une nouvelle Constitution
Personne ne savait à quel niveau de représentation se situeraient les diplomates, invités en fin d’après-midi, la veille. Or, les ambassadeurs sont tous là, ou presque. France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Maroc, Chine, Japon, Russie… La délégation russe avait pris les devants en étant la première à rendre visite au colonel Randrianirina au Capsat, les jours précédents, évoquant des « partenariats stratégiques ». Le message a été compris : en laissant un vide, Moscou s’y engouffrerait, comme cela s’est passé dans d’autres parties du continent, de la Centrafrique au Burkina Faso. « On ne va pas répéter les mêmes erreurs », dit une source diplomatique.
Les langues se délient au sujet du bateau ivre qu’était devenu le pouvoir d’Andry Rajoelina. Le représentant d’un bailleur de fonds s’étrangle en évoquant la note verbale adressée à ses pairs, intimant l’ordre de garder le silence le plus complet sur le pays. « On ne voit cela nulle part sauf dans les pires régimes autoritaires », dit-il, en détaillant aussi, comme le font tout à coup de multiples acteurs malgaches, un système de captation qui a dévasté une économie qui possède « pourtant des possibilités de croissance, celles d’un pays doté de nombreuses ressources ».
Dans ce contexte, voici qu’arrive au pouvoir un officier qui est à la tête du CNDT et, ce faisant, est le chef de l’Etat, mais supervise aussi l’action d’un gouvernement civil, dont le premier ministre devrait être connu vite, aux environs de mercredi, mais aussi organiser des Assises nationales en vue de la rédaction d’une nouvelle Constitution, incluant une réflexion sur le fédéralisme.
Or, le colonel Randrianirina – c’est peut-être le facteur le plus important, et le moins relevé lors de son accession au pouvoir –, est originaire du sud du pays. Il est, de plus, de confession luthérienne. A Madagascar, c’est une première, à double titre. Les responsables du pays ont toujours été issus de la région centrale, et pas de la côte. Cette subdivision entre plateau et régions côtières est l’une des grandes fissures qui traverse le pays.
Le colonel Randrianirina n’est pas l’un des visages connus de l’élite politique, économique et militaire du pays. Il est né à Sevohipoty, un village modeste de la région de l’Androy, dans le Sud. Après des études militaires, il est devenu gouverneur de cette zone, en 2016. Puis il a commandé un bataillon d’infanterie dans la ville de Tuléar. Dans ces deux fonctions, il s’est bâti une excellente réputation, toujours à sa façon, discrète. Puis il a eu maille à partir avec le pouvoir d’Andry Rajoelina, son exact opposé, au point d’être arrêté en 2023, accusé de fomenter un coup d’Etat.
Le colonel, depuis, passe pour exécrer les excès de ce pouvoir, son luxe tapageur dans un pays ravagé par la pauvreté. A sa libération en 2024, il est nommé à la tête du Capsat, en raison de ses états de service. Le voilà, à présent, à la tête d’un pouvoir encore incertain.
[Source: Le Monde]