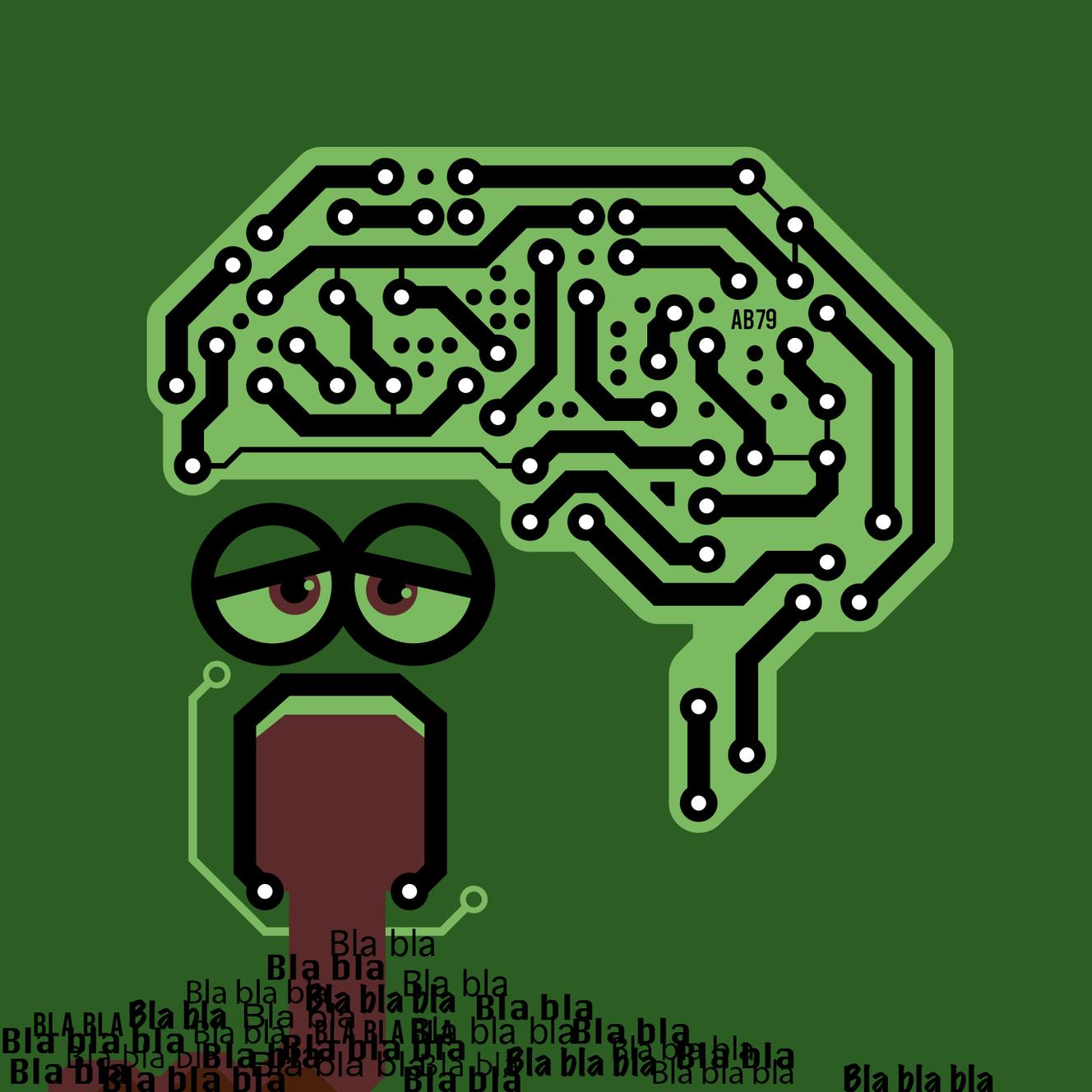Troubles du langage et de l’apprentissage : les prises en charge restent « insuffisantes »
Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie… Le diagnostic s’améliore, mais, à l’occasion de la journée nationale des troubles « dys », samedi 11 octobre, un sondage de la Fédération française des dys souligne les effets négatifs d’un parcours de soins tardif, notamment pour la santé mentale et l’insertion.

Longtemps considérés comme les cancres du fond de la classe, les enfants souffrant de troubles « dys » sont désormais mieux repérés et diagnostiqués, mais les prises en charge restent souvent tardives ou insuffisantes, selon un sondage réalisé par la Fédération française des dys (FFDys), à l’occasion de la journée nationale des troubles « dys », samedi 11 octobre.
Ces troubles spécifiques du langage et des apprentissages peuvent atteindre différentes fonctions cognitives : l’acquisition de la lecture (dyslexie), de l’écriture (dysorthographie) ou du calcul (dyscalculie), mais aussi le langage oral (dysphasie) ou les fonctions motrices (dyspraxie). Selon la Haute Autorité de santé, environ 8 % des enfants sont concernés, soit deux à trois enfants par classe en moyenne. Fréquemment, plusieurs de ces troubles « dys » sont associés, ou s’ajoutent à un trouble du spectre autistique ou un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).
La FFDys s’est associée à Poppins, start-up développant un dispositif médical sous forme de jeu vidéo pour les « dys », pour interroger 1 084 personnes dans toute la France, qu’ils soient parents d’enfants « dys » ou adultes concernés directement. « Cette enquête n’a pas été réalisée par un institut de sondage, et n’est pas forcément représentative, d’autant qu’il est difficile de toucher des personnes qui ont des troubles pour lire et écrire », avertit Nathalie Groh, présidente de la FFDys.
Toutefois, ces résultats confortent les observations des associations et des professionnels. Tout d’abord, un « progrès indéniable » entre les générations : parmi les enfants, 76 % ont été diagnostiqués avant 9 ans (à 7,4 ans en moyenne), contre seulement 42 % pour les adultes – 30 % d’entre eux n’ayant connu leur trouble qu’après l’âge de 20 ans. « Ce sont toujours les parents qui repèrent les premières difficultés, parfois les enseignants, mais avoir accès aux professionnels est très long, explique Catherine Grosmaître, neuropsychologue à l’hôpital Necker-Enfants malades, à Paris. Entre l’acceptation du dossier et le diagnostic, il faut compter un an à Necker et jusqu’à dix-huit mois dans les centres médico-psycho-pédagogiques à Paris. »
« Perte de confiance »
Les difficultés arrivent au moment de la prise en charge, inexistante pour 39 % des adultes, et jugée « insuffisante » par 58 % des parents. Les réponses thérapeutiques aux troubles « dys » nécessitent un suivi par des orthophonistes, associés à d’autres spécialistes : ergothérapeutes, psychologues ou psychomotriciens – avec des coûts pas toujours remboursés par la Sécurité sociale. Pour la moitié des enfants, le délai d’attente dépasse un an pour un premier rendez-vous. Et à raison d’une séance par semaine, difficile de rattraper des retards d’apprentissage, même si les troubles « dys » n’altèrent pas les compétences intellectuelles.
Cette prise en charge défaillante a des conséquences sur la scolarité (harcèlement, redoublement, décrochage scolaire…) et sur la santé mentale. « La majorité, voire la totalité des enfants avec lesquels je travaille ont une perte de confiance en eux, un désinvestissement scolaire et des troubles du comportement liés à la non-reconnaissance de leurs efforts », détaille Catherine Grosmaître, qui observe aussi « des comportements anxieux, des difficultés d’endormissement et pour une petite part, des idées noires voire suicidaires ».
Les adultes interrogés par la FFDys décrivent les mêmes conséquences sur l’estime de soi, couplées à des effets sur l’insertion professionnelle : problèmes relationnels avec des collègues, difficulté à trouver un emploi ou à le conserver et sentiment d’avoir un métier inférieur à ses compétences. Même si les aménagements scolaires améliorent l’accès aux études supérieures, les personnes atteintes de troubles « dys » le cachent souvent, déplore Nathalie Groh : « Ces handicaps invisibles créent beaucoup de discriminations, de désinsertion ou de burn-out. »
[Source: Le Monde]