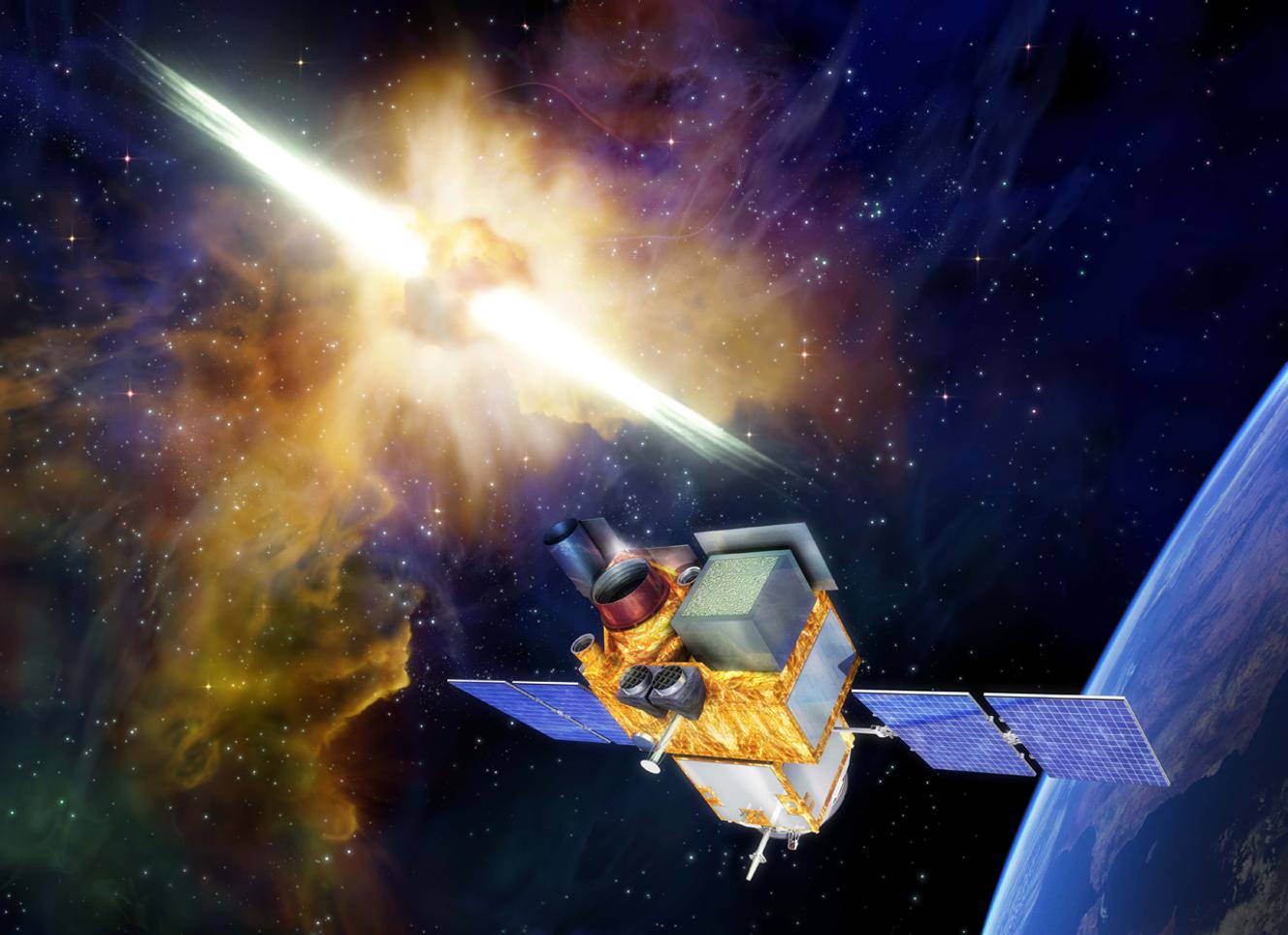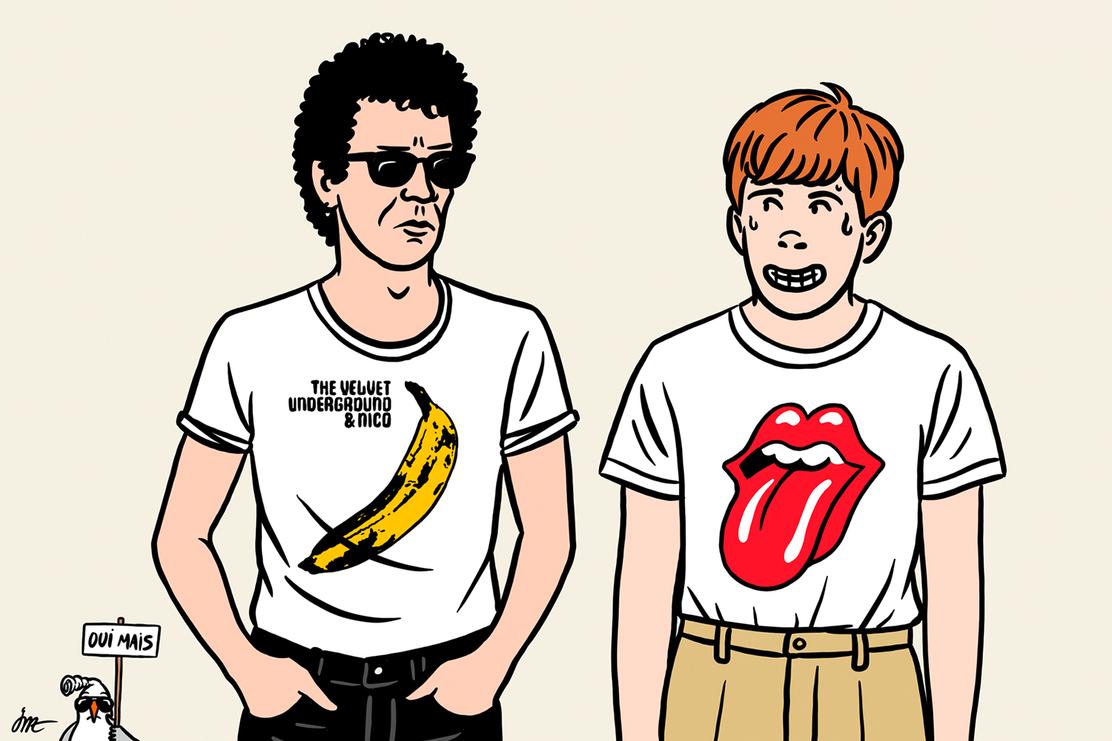« Je reprends les tournures de phrase qui ne sont pas naturelles » : les étudiants repassent derrière les IA pour humaniser leurs copies
Largement adoptée par les étudiants depuis 2022, l’intelligence artificielle générative brouille l’évaluation des examens, d’autant qu’ils affinent toujours plus leurs stratégies pour masquer son usage.

Ambre (le prénom a été modifié à sa demande) est étudiante à Sciences Po, et si ChatGPT est pour elle avant tout un assistant efficace pour structurer sa pensée ou pour créer des plans pour ses cours, il peut également devenir l’auteur de certains de ses travaux : « Quand je manque de temps, il m’arrive de lui faire rédiger une dissertation à faire à la maison. » Une fois le travail fait par la machine, elle « reprend les tournures de phrase qui ne sont pas naturelles, enlève les répétitions, adjectifs et superlatifs caractéristiques de ChatGPT » pour rendre son texte plus « humain ».
Les techniques des étudiants pour masquer le style « ChatGPT » se diversifient. Jeanne (qui souhaite également rester anonyme), par exemple, opte pour une autre stratégie. L’étudiante en master à l’Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers (Essca) fait écrire son texte en anglais à l’intelligence artificielle (IA) et le traduit ensuite manuellement.
Si l’usage des IA génératives a conquis la jeunesse – 80 % des 18-25 ans s’en servent au moins une fois par semaine, selon une étude de l’agence Heaven –, difficile de quantifier le recours aux IA des étudiants pour leurs travaux évalués par les enseignants. Les examens surveillés sur table existent toujours, mais les épreuves en classe sur ordinateurs personnels se développent et permettent un accès plus simple aux IA. Jeanne raconte ses examens de contrôle de gestion et de sciences de la décision : « Tout le monde trichait. Pendant les examens, on s’organisait en ouvrant un document partagé sur nos ordinateurs et chacun y ajoutait ses réponses générées par IA. »
« Obligée » d’utiliser ChatGPT
Dans les écoles d’ingénieurs, l’usage est différent. Pierre (le prénom a été modifié), étudiant à CentraleSupélec, s’en sert « pour les travaux de modélisation où on doit coder sur RStudio ou utiliser Matlab [deux outils de codage] : c’est bien plus simple d’utiliser ChatGPT que d’apprendre à coder ».
ChatGPT a d’ailleurs permis à Jeanne d’obtenir un 18/20 à l’examen de contrôle de gestion, mais elle regrette parfois de s’être sentie « obligée » de s’en servir pour se maintenir au niveau des autres. « J’ai été agacée de devoir l’utiliser car j’ai adoré le cours de sciences de la décision, mais comme tout le monde allait s’en servir, j’avais l’impression de prendre le risque de ne pas avoir de bonnes notes comme les autres », déplore-t-elle.
C’est ce sentiment d’injustice qui pousse des dizaines d’étudiants de la faculté des humanités de l’université de Lille dans le bureau de Paul Dirkx, directeur du département de lettres modernes : « De nombreux étudiants sont venus me voir tout au long de l’année pour se plaindre de l’usage frauduleux de l’IA par d’autres étudiants, qui, disent-ils, se retrouvent avec de bien meilleures notes que les élèves honnêtes. » Il témoigne d’un « mouvement de panique » chez de nombreux enseignants-chercheurs, qui découvrent peu à peu l’ampleur du problème.
Selon lui, les textes générés par IA sont facilement détectables : « Il n’y a aucune faute d’orthographe, les phrases sont très impersonnelles et générales, des paragraphes sont creux… » Un enseignant-chercheur (qui veut rester anonyme) évoque une copie reçue « d’une élève qui a rarement la moyenne » et pour laquelle il a immédiatement suspecté une rédaction à l’aide de l’IA : « J’ai mis une bonne note quand même, je ne pouvais rien prouver. A l’examen suivant, j’ai fait attention à elle et je l’ai surprise avec son téléphone. »
Revoir les méthodes d’évaluation
Si le corps enseignant a du mal à restreindre l’usage de l’IA, c’est notamment parce que certains étudiants savent très bien manipuler les outils à leur disposition afin de ne laisser planer aucun doute de nature à les démasquer formellement. C’est aussi, selon Paul Dirkx, du fait d’un manque de « méthode concertée pour prouver l’usage de l’IA ». En effet, son utilisation est encore peu réglementée dans les universités. Le « cadre d’usage de l’IA en éducation », publié en juin 2025 par le ministère, énonce des recommandations que les universités sont libres d’appliquer à leur règlement ou non.
« Les professeurs nous disent systématiquement qu’ils verront si on a écrit avec ChatGPT, mais vu le nombre de personnes autour de moi qui l’utilisent pour rédiger, il est évident que c’est très difficilement détectable », explique Ambre. Côté professeurs, Charlotte (le prénom a été modifié), enseignante-chercheuse en littérature dans une université publique, est convaincue : « Je suis bien plus confrontée que ce que je crois à l’usage de ces outils par les étudiants. »
Certains professeurs en viennent à revoir leurs méthodes d’évaluation pour éviter ces usages non contrôlés. Réjane Vallée, directrice de l’UFR des sciences de l’homme et de la société de l’université d’Evry-Paris-Saclay, partage un constat avec ses collègues : « Les rendus à faire à la maison sont beaucoup issus des IA. » Limiter ces rendus et mettre l’accent sur les examens sur table et les oraux sont des solutions mises en place dans son département : « L’oral, ça ne pardonne pas : on peut poser une question sur une référence ou une théorie évoquée, et on voit rapidement si l’étudiant a travaillé son sujet ou pas. »
L’utilisation des IA génératives par les étudiants pose d’importantes questions concernant le rôle de l’enseignement supérieur, selon Charlotte : « On valide des compétences qui ne sont pas celles des étudiants. En sortie d’études, ils auront leur diplôme mais n’auront pas vraiment été formés. » Des usages dont l’envergure interroge le lien entre diplôme et compétences, et finalement ce que viennent chercher les étudiants concernés dans l’enseignement supérieur.
[Source: Le Monde]