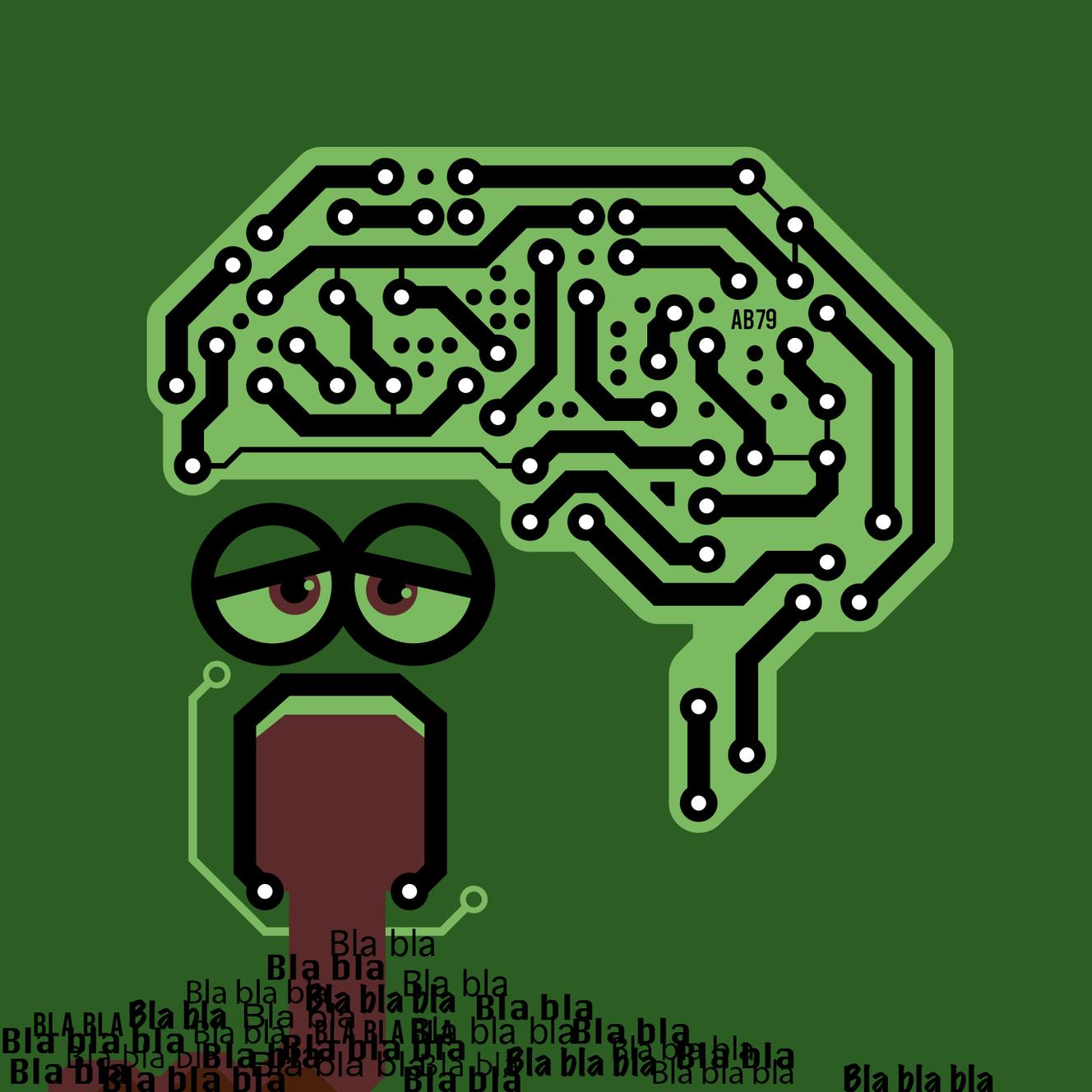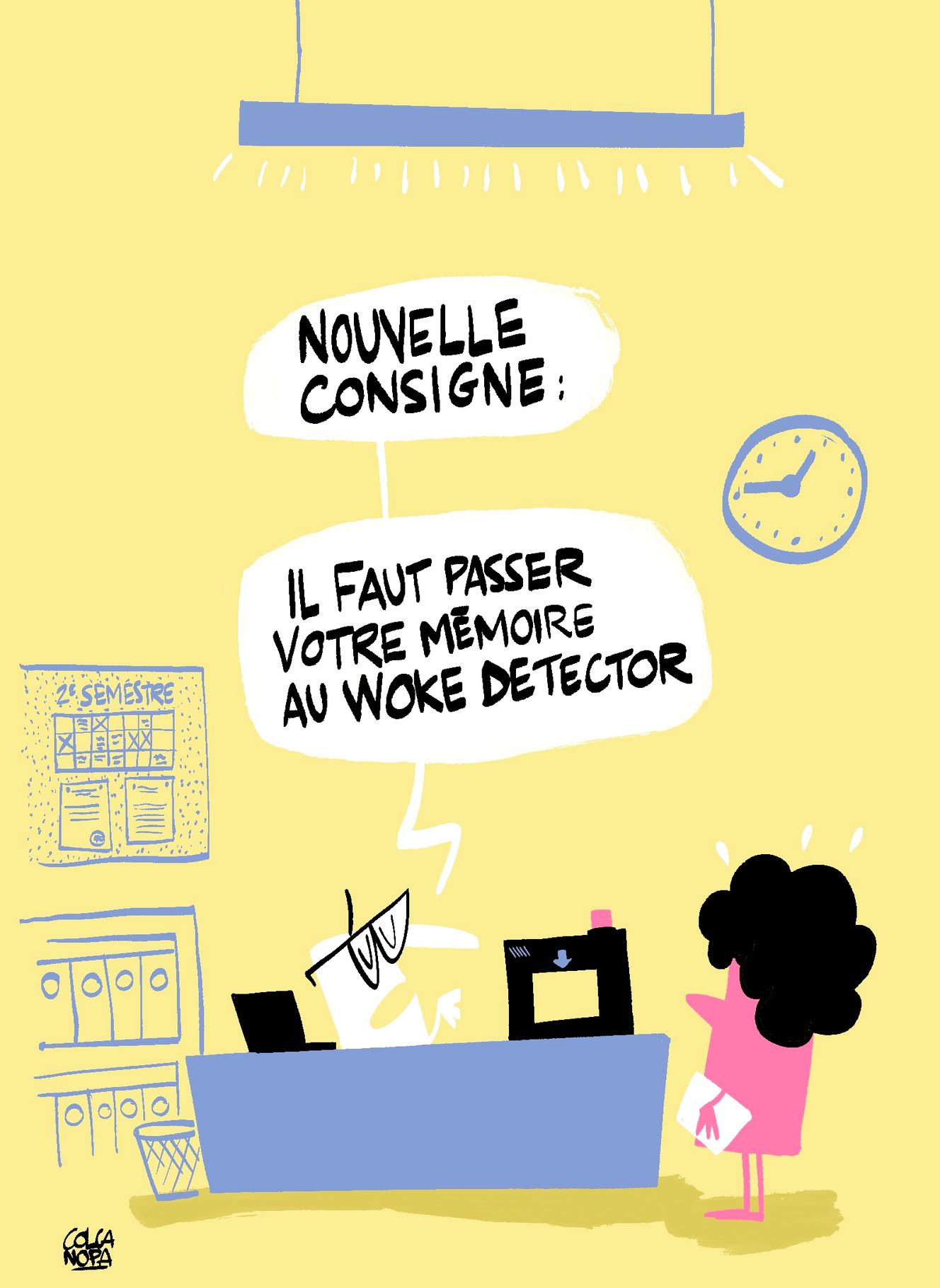En Syrie, dans le camp de Roj, le sort suspendu des femmes de djihadistes
Quelque 2 100 femmes ayant rejoint l’organisation Etat islamique sont détenues dans le camp de Roj, dans le nord-est de la Syrie.

En cette fin d’octobre, le ciel au-dessus du camp de Roj est d’un bleu pâle, sans le moindre nuage pour atténuer la chaleur persistante. Sur cette étendue désertique du nord-est syrien, le Rojava, tout près des frontières turque et irakienne, un haut mur fraîchement érigé confirme ce que beaucoup redoutaient : le camp, sous l’autorité des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance dominée par les Kurdes, abrite les familles de djihadistes venus du monde entier rejoindre l’organisation Etat islamique (EI), lors de la guerre en Syrie, durant les années 2010, avant d’être capturés. Roj est là pour durer. Et ce, malgré l’accord signé le 10 mars entre le président syrien par intérim, Ahmed Al-Charaa, et le chef des FDS, le général Mazloum Abdi, prévoyant l’intégration progressive des institutions de cette région autonome du nord-est de la Syrie dans l’Etat syrien.
A terme, les nouvelles autorités de Damas, arrivées au pouvoir après la chute, en décembre 2024, de Bachar Al-Assad, doivent reprendre le contrôle des camps et des prisons de la région, où sont détenus environ 9 000 membres présumés de l’EI et leurs familles.
Mais ici, à Roj, où vivent quelque 2 100 femmes avec leurs enfants, rien ne laisse penser qu’un tel transfert de pouvoir soit en préparation. « Rien n’a été fait, à ce stade, pour que le contrôle soit transféré à d’autres », explique Javré, 30 ans, une Kurde du Rojava, responsable de la sécurité du camp, qui préfère taire son nom de famille. « Ceux qui [selon l’accord du 10 mars] sont censés reprendre les camps et les prisons sont eux-mêmes d’anciens membres de Daech [acronyme arabe de l’Etat islamique] ou des mercenaires », poursuit-elle, faisant allusion au passé du président Al-Charaa, autrefois lié à Al-Qaida, ainsi qu’à d’autres forces radicalisées affiliées aux nouvelles autorités syriennes.
Tentatives de fuite
Parmi les familles étrangères encore présentes à Roj, environ 110 sont françaises, composées de femmes, mais en grande majorité d’enfants. Beaucoup ont déjà été rapatriées vers la France. Le dernier transfert, le 16 septembre, concernait trois femmes et dix enfants. Dans cette mer de tentes blanches et bleues, l’éventualité d’une reprise du contrôle par Damas réjouit certaines détenues. « Depuis l’accord du 10 mars, certaines femmes nous disent ouvertement qu’elles veulent rejoindre les territoires tenus par le HTC [Hayat Tahrir Al-Cham, le groupe du président Al-Charaa, aujourd’hui dominant à Damas]. Ces dernières semaines, nous avons eu davantage de tentatives de fuite [pour rejoindre ce territoire]. Certains ex-détenus, notamment ceux ayant fui du camp d’Al-Hol [qui abrite des membres présumés de l’EI] et ayant rejoint les groupes djihadistes, contactent les femmes ici pour les encourager à faire de même [pour poursuivre le djihad] », ajoute Javré.


Fatima (un prénom d’emprunt), 50 ans, mère et grand-mère, entièrement voilée, refuse catégoriquement un retour en France. « Beaucoup de femmes, françaises ou issues d’autres nationalités, sont parties autour de moi. Moi, je veux vivre libre en Syrie [une fois que Damas aura repris le contrôle de Roj] », lâche-t-elle sans hésitation. Comme beaucoup de femmes du camp, elle suit l’actualité grâce à une télévision et une parabole installées dans sa tente. Elle sait que 47 Français soupçonnés d’appartenir à l’EI ont été remis à l’Irak durant l’été pour y être jugés pour des crimes commis sur place au milieu des années 2010. Elle assure que cette perspective ne l’inquiète pas. « Je n’ai aucun lien avec ce pays-là », dit-elle en répétant : « Je veux être libre, ici, en Syrie. »
Amira (un prénom d’emprunt), 29 ans, est plus nuancée. Elle refuse, pour l’instant, son rapatriement en France, craignant que ses deux enfants, une fille de 9 ans et un garçon de 7 ans, soient placés non pas chez leur grand-tante, mais en famille d’accueil, puis envoyés dans des centres de déradicalisation. « J’ai peur que mes enfants ne m’oublient, qu’ils ne comprennent pas qui je suis, ni pourquoi je suis venue ici, non pas de mon plein gré, mais parce que mes parents ont décidé de rejoindre Daech en 2014 », confie-t-elle.
Les idées « trop cruelles » de l’EI
Ces derniers, pratiquants, ne l’avaient jamais forcée à suivre la religion. Mais un oncle très religieux a, dit-elle,« retourné le cerveau » de son père, entraînant toute la famille jusqu’à Tall Abyad, une ville du nord de la Syrie, où elle est mariée à un combattant. « Mon mari n’était pas strict. Avec lui, je regardais sur YouTube des vidéos pour apprendre l’anglais et le turc », raconte la jeune femme. Au cours de l’entretien, Amira laisse apparaître un piercing sur sa lèvre inférieure, à droite. « Je l’ai fait ici », sourit-elle. « Avant, à Al-Hol [où elle a été détenue pendant quatre ans], les sœurs [membres de l’EI] ne nous laissaient pas faire ce genre de choses. » Elle en a un autre, au nombril, qu’elle a fait en accord avec son mari.
L’homme, dont Amira préfère taire la nationalité, a été tué après la bataille de Baghouz, ultime bastion de l’EI tombé en 2019. Le père d’Amira est porté disparu depuis. Blessée, la jeune Française s’est rendue aux forces kurdes avec ses enfants et se retrouve enfermée au camp d’Al-Hol, dans des conditions qu’elle décrit comme « très dures ». « A Al-Hol, il y a eu des meurtres. J’avais peur pour mes enfants », confie-t-elle. Une tentative d’évasion lui a coûté 17 000 dollars (14 600 euros), une somme versée par ses beaux-parents, et lui a valu sept mois de prison hors du camp. Aujourd’hui, dans sa tente propre et bien rangée à Roj, elle donne à ses enfants des cours d’anglais, de français et d’arabe. « L’école, ici, deux heures par jour, ne sert à rien, soutient Amira. Je préfère les instruire moi-même. Je ne veux pas qu’ils finissent comme les autres enfants du camp, sans éducation. » Elle qui lit « beaucoup pour s’évader »vient de terminer Le Guêpier, une nouvelle d’Agatha Christie, emprunté dans la médiathèque du camp.


Les idées de l’EI, « trop radicales, trop cruelles », responsables de « beaucoup d’injustices », elle les rejette désormais. Si elle s’enveloppe toujours dans une longue abaya ne laissant voir que ses yeux, c’est par crainte du regard des voisines. « Ici, les femmes parlent trop. Si l’une d’entre nous ne se couvre pas assez, elles peuvent s’en prendre à ses enfants. Une fois sortie d’ici, je garderai juste un voile sur mes cheveux. Je me débarrasserai de toutes ces couches », assure-t-elle. La possibilité d’un transfert vers l’Irak l’effraie. « Là-bas, ce serait pire. J’en suis certaine », glisse-t-elle.
Nouvelle génération
Parmi les Françaises de Roj, selon l’avocate Marie Dosé, qui défend plusieurs familles de djihadistes, se trouvent deux sœurs de 17 et 20 ans qui demandent à être rapatriées en France. Mais leur requête est restée lettre morte. « Ces enfants paient pour les crimes de leurs parents, déplore l’avocate. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme et par d’autres juridictions. Pourtant, elle persiste dans l’arbitraire et fait le choix conscient de l’inhumanité en sacrifiant ces enfants. »
Dans les allées de Roj, on croise de jeunes garçons, désormais presque adultes. Jusqu’en 2023, une fois majeurs, ils étaient systématiquement transférés dans des centres de déradicalisation ouverts dans le Rojava. Faute de place, ils restent désormais dans le camp. Selon les décomptes des autorités du camp de Roj, environ 50 jeunes hommes de 18 à 20 ans y vivent encore. Ces dernières évoquent aussi des cas de viols. Mais les victimes et leurs familles refusent de porter plainte, par peur d’être stigmatisées. « Le plus dangereux, c’est cette nouvelle génération, bercée depuis l’enfance dans cette idéologie », alerte Hokmiya Ibrahim, coprésidente de l’administration du camp de Roj. « Nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens pour contenir le problème, mais nous n’y pouvons pas grand-chose », assure-t-elle, constatant son impuissance face à ce défi et invitant la communauté internationale à intervenir.