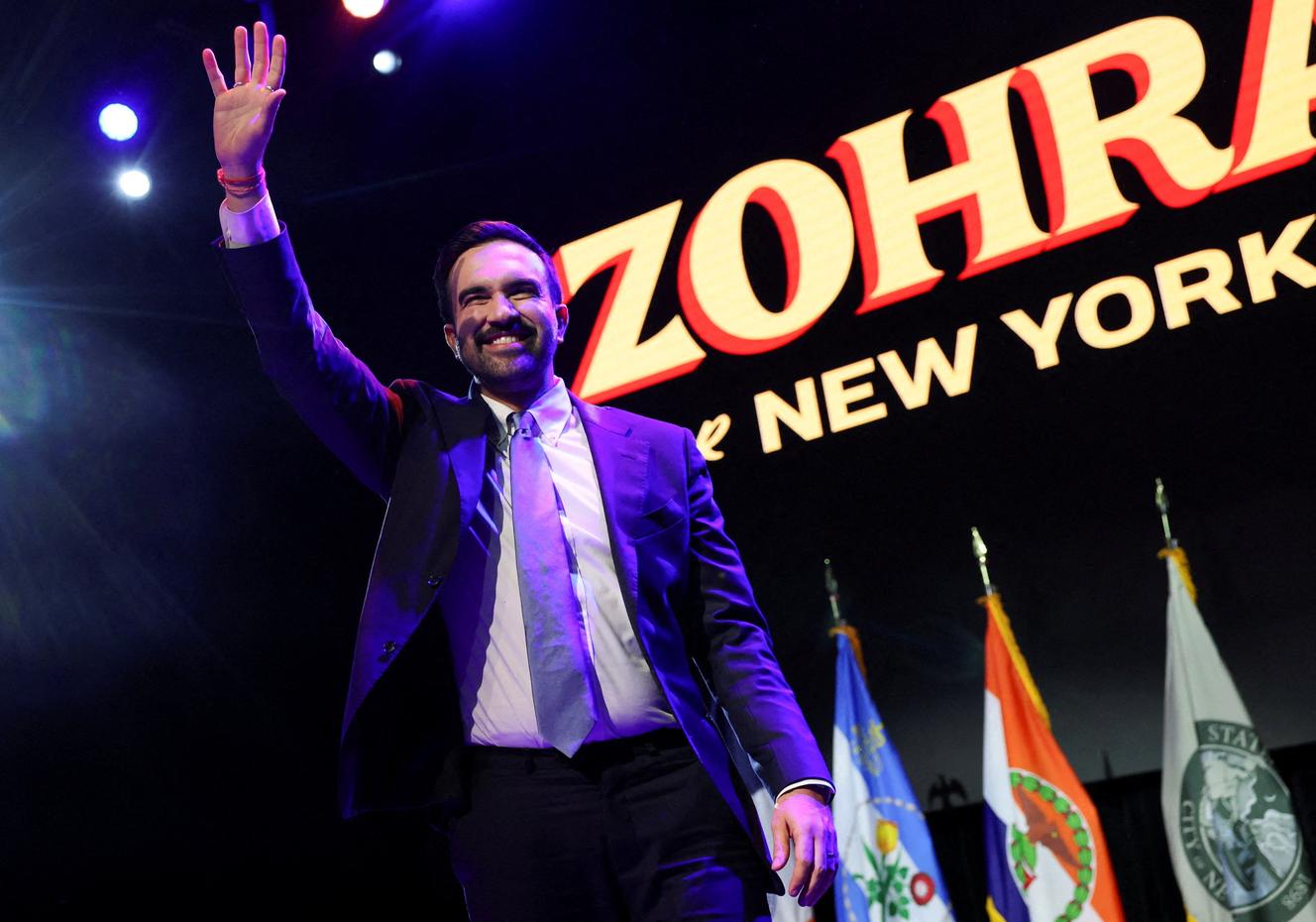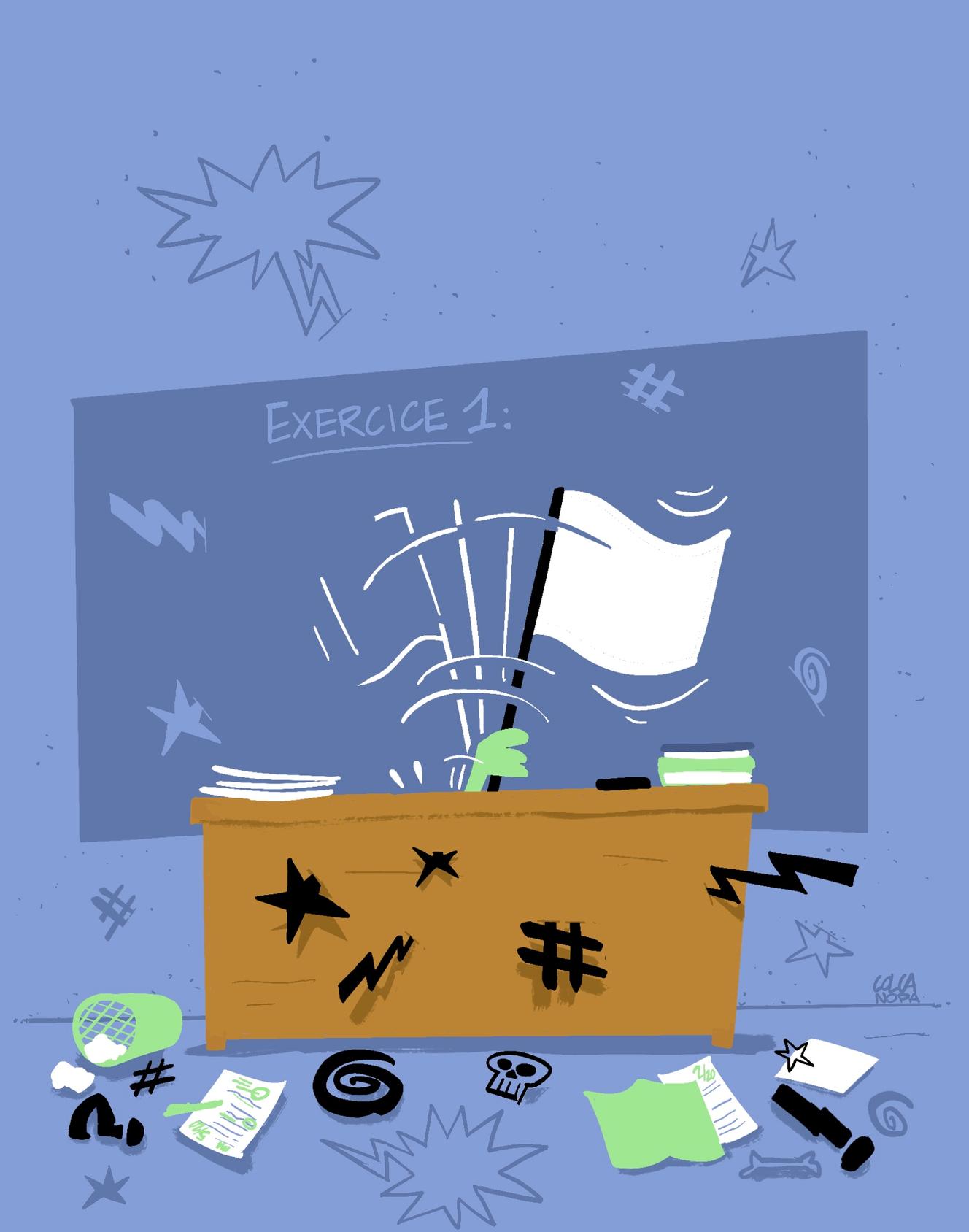Après la « guerre des douze jours » entre Israël et l’Iran, beaucoup de questions et peu de certitudes
« La poussière n’est pas encore retombée », résume en une image Yossi Shain, professeur à l’université de Tel-Aviv. La seule certitude : les effets tectoniques de cette guerre sont majeurs et ces derniers jours ont fait bouger en profondeur les lignes diplomatiques du Moyen-Orient.

Au bruit des sirènes et des explosions succède le brouillard des interrogations sur les conséquences de la « guerre des douze jours » entre Israël et l’Iran, la solidité du cessez-le-feu annoncé par Donald Trump, les conditions de son maintien, les garanties données aux belligérants, la place laissée à la diplomatie, les impacts potentiels sur la guerre à Gaza, et bien au-delà en réalité. « La poussière n’est pas encore retombée », résume en une image Yossi Shain, professeur à l’université de Tel-Aviv. Plus d’interrogations que de certitudes à ce stade dans les nouveaux équilibres du Moyen-Orient vus d’Israël ; mais la certitude que les effets tectoniques de cette guerre sont majeurs et que ces derniers jours font bouger en profondeur les lignes diplomatiques du Moyen-Orient.
A l’échelle de la région, l’Iran vient de connaître une défaite humiliante, le constat d’une erreur stratégique face à son ennemi historique et l’affaiblissement de ses capacités dissuasives. « Grâce à cette guerre, Israël a réussi à affaiblir le programme nucléaire de l’Iran, ses capacités de lancement mais aussi son industrie militaire et d’autres atouts stratégiques », constate Ram Yavne, brigadier général (réserve), ancien chef de la planification stratégique au sein de l’état-major. « La campagne contre l’Iran s’est achevée sans que le [mouvement chiite libanais] Hezbollah ne tire une seule roquette en direction d’Israël. Une réussite inimaginable », a pointé sur X le correspondant diplomatique de la chaîne 14, le cœur de cible de l’électorat du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, pour dire l’isolement de cet ennemi dont une partie de la dissuasion reposait sur la crainte de ripostes.
Le niveau réel des destructions opérées sur le programme nucléaire demeure difficile à évaluer. Plusieurs médias américains ont ainsi souligné, mardi soir, que la première évaluation des bombardements effectués par les B2 de l’US Air force ne laissait pas entrevoir de destruction du potentiel nucléaire de l’Iran, tout au plus un retard de quelques mois dans sa capacité à fabriquer des armes. L’impact des attaques israéliennes sur l’armement balistique est plus évident. La capacité du régime à se défendre s’en est trouvée rapidement amoindrie : entre le 13 et le 23 juin, l’Iran a tiré 591 missiles, dont près de 90 % ont été interceptés en vol ; sur ces tirs, plus de la moitié ont eu lieu les trois premiers jours. Ensuite, les vagues suivantes ont été de moins en moins intenses. Mardi, par exemple, dernier jour des affrontements, bien que sept alertes successives ont sonné dans tout le territoire israélien, seuls treize missiles ont été tirés en réalité. Un des signes de l’impuissance iranienne.
Interrogation sur les sanctions et leur mise en œuvre
La guerre frontale est suspendue. Mais comment Israël pourra vérifier, demain, si l’Iran ne cherche pas à reconstruire un programme nucléaire en s’appuyant sur ce que l’armée a pu sauver avant les bombardements, notamment de l’uranium et des centrifugeuses ? « Ce qu’Israël a réussi à obtenir en Iran sur le programme nucléaire et le programme de missiles balistiques doit être fermement appliqué en s’assurant que nous savons ce qu’ils font et s’ils essaient de reconstruire ces activités », souligne Yonatan Freeman, enseignant en relations internationales à l’université hébraïque de Jérusalem. « Le test-clé de l’administration [américaine], en supposant que le cessez-le-feu tienne, sera sa capacité à faire avancer un accord amélioré avec l’Iran qui comprenne un mécanisme de contrôle efficace », écrit le chercheur Eldad Shavit, sur le site de l’Institut pour les études sur la sécurité nationale (INSS).

D’où cette autre interrogation sur le type de sanctions et leur mise en œuvre : « Si l’Iran viole le cessez-le-feu, Israël devra prendre une décision. Répondons-nous à la violation du cessez-le-feu ? Risquons-nous des frictions avec l’administration Trump ? Et nous allons devoir peser les deux », explique Michael Oren, ancien ambassadeur de l’Etat hébreu aux Etats-Unis. Mardi soir, Benyamin Nétanyahou a prévenu de nouveau : « Si quelqu’un en Iran tente de reconstruire ce projet, nous agirons avec la même détermination et la même force pour mettre fin à toute tentative de ce type. Je le répète : l’Iran n’aura pas d’armes nucléaires. »
Malgré des turbulences ces derniers mois, la relation entre Trump et Nétanyahou est apparue solide. Le président américain s’est dit impressionné par l’armée de l’air israélienne et les résultats obtenus pour abattre les systèmes de défense aérienne comme les lanceurs de missiles. Surtout, le premier ministre l’a convaincu de passer à l’action militaire. Donald Trump a hésité, laissé passer quelques jours, puis ordonné de lancer les bombardiers B2 avec l’objectif de frapper trois sites, dont celui de Fordo, enterré plusieurs dizaines de mètres sous la terre. Leur proximité et l’intérêt du moment ont leur limite : face aux risques de représailles, Donald Trump a, plus tard, intimé l’ordre à Nétanyahou et à Israël de ne pas répliquer aux deux missiles iraniens tirés deux heures après le début officiel du cessez-le-feu.
« La possibilité d’un changement majeur »
Israël a le sentiment d’avoir restauré une large part de sa puissance abîmée par le 7 octobre 2023 puis, sur le plan de l’image, par les dégâts humanitaires de la guerre à Gaza et les accusations de crime de guerre contre l’armée. « Citoyens d’Israël, le 7-Octobre, nous étions au bord du gouffre. Nous avons subi la pire catastrophe de l’histoire de l’Etat. Mais grâce aux forces conjointes du gouvernement, des services de sécurité et de vous, le peuple, nous nous sommes relevés et avons riposté », a encore clamé Benyamin Nétanyahou. « Israël a rétabli sa dissuasion et a regagné une partie de sa légitimité internationale », relève pour sa part Daniel Wajner, chercheur à l’université hébraïque de Jérusalem, même si les images quotidiennes des morts à Gaza (plus de 56 000 au total) continuent de hanter une partie du monde, choquée par les conditions de vie dégradées des habitants et la destruction complète d’une partie de l’enclave.
Avec la guerre contre l’Iran, la question des otages avait été rétrogradée au second plan. Elle est immédiatement revenue dans le débat public. Devant la famille de Yonatan Samerano, otage de 21 ans enterré mardi après que sa dépouille a été retrouvée par l’armée à Gaza, le chef de l’Etat israélien, Isaac Herzog, habituellement assez timoré, s’est adressé au gouvernement à propos des 50 otages, dont une vingtaine seraient encore vivants, retenus dans l’enclave : « Nous sommes à un moment critique. Il est temps d’agir avec détermination, créativité et urgence – par tous les moyens et de toutes nos forces. » La défaite de l’Iran ouvre « une fenêtre d’opportunités », plaide le Forum des familles d’otages. « Comme l’a dit le chef d’état-major, nous devons maintenant nous concentrer sur Gaza pour nous assurer que les otages retrouvent leur liberté et que le régime du Hamas n’est plus au pouvoir », indique Yonatan Freeman avant de préciser : « Si le Hamas a vu ce qui se passe à Téhéran, il peut craindre que quelque chose de plus fort ne lui arrive dans la ville de Gaza. Ils pourraient donc être plus enclins à signer un accord. »
Grâce à son armée de l’air et au Mossad, Israël s’est ouvert le ciel iranien. Et comme au Liban et en Syrie, l’Etat hébreu pourrait être tenté d’en profiter pour asseoir sa domination. « Notre objectif ne devrait pas être seulement de refuser à l’Iran le droit d’enrichir et la capacité d’enrichir, mais de mettre fin au soutien de l’Iran au terrorisme et au rôle de l’Iran en tant que source majeure d’instabilité, de violence et de guerre au Moyen-Orient et ailleurs. Je ne sais pas si nous aurons à nouveau une telle occasion », note ainsi l’ex-ambassadeur Michael Oren. Daniel Wajner abonde dans le même sens : « C’est quelque chose qui se produit tous les quarante ou cinquante ans : la possibilité d’un changement majeur comme dans les années 1990 avec l’effondrement de l’Union soviétique, comme pour la guerre des Six-Jours en 1967 ou l’après-seconde guerre mondiale. Le chemin que nous allons emprunter maintenant peut déterminer les vingt prochaines années. »
[Source: Le Monde]