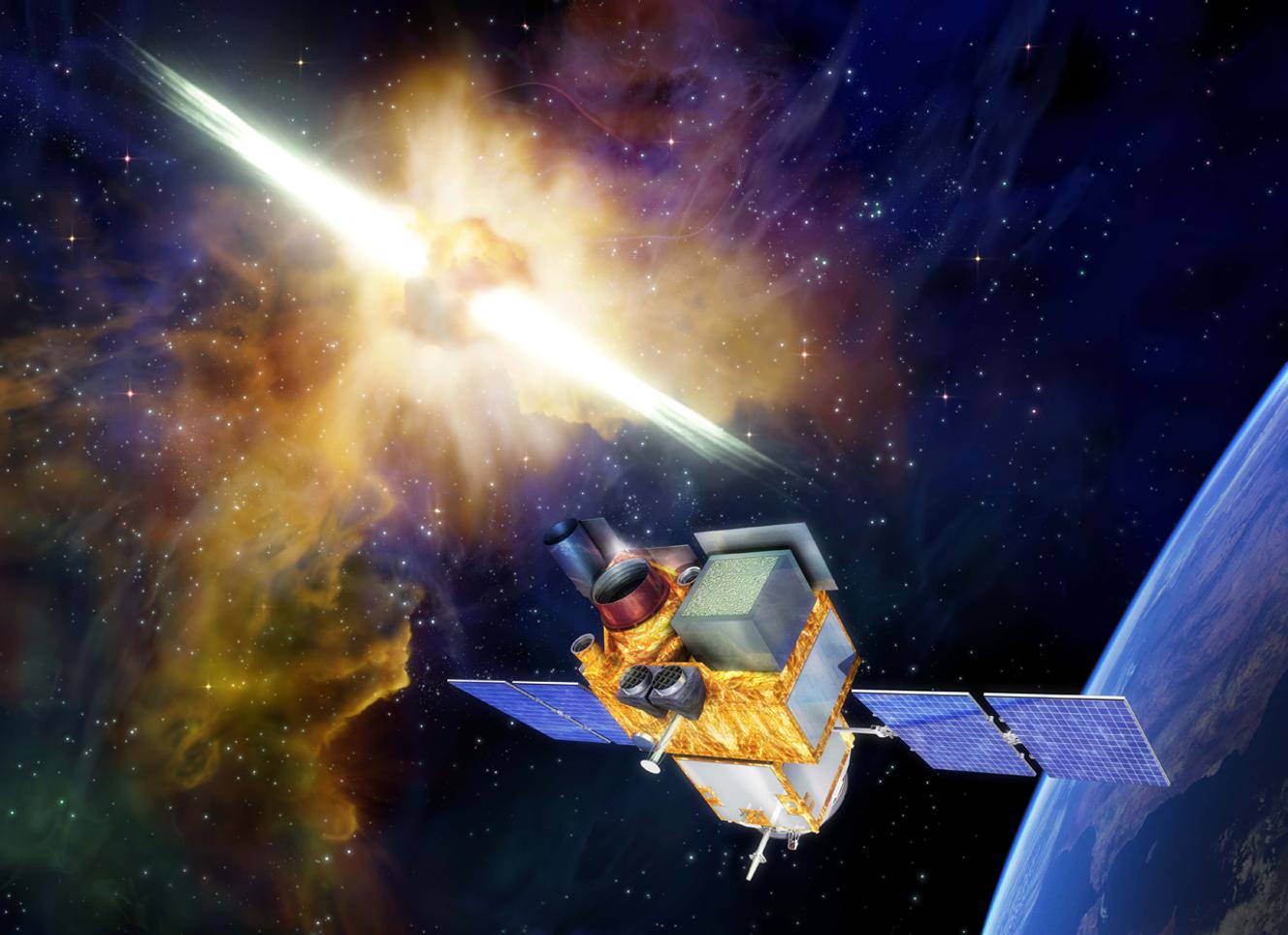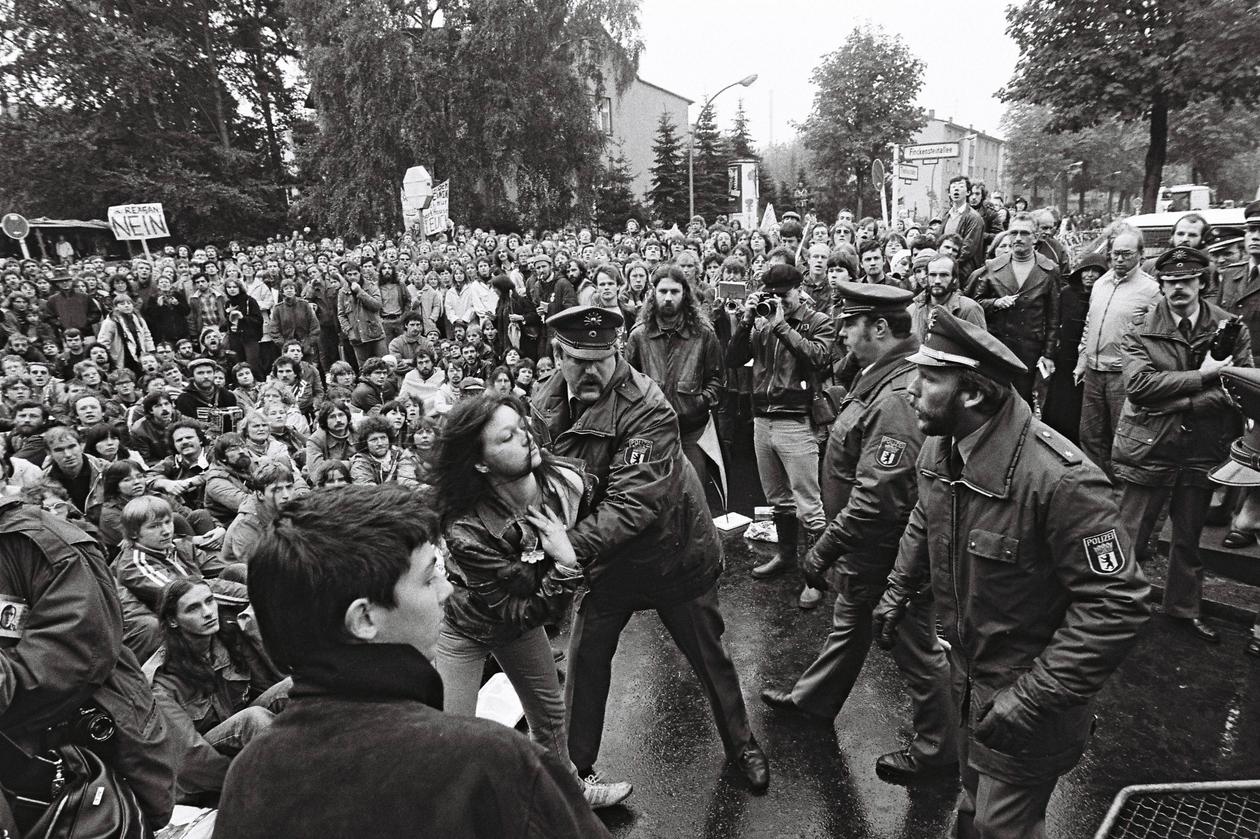« Les IA ne vont pas remplacer les juristes, elles vont seulement les “augmenter” » : les formations en droit face à l’essor de l’intelligence artificielle
Les métiers du droit sont contraints de s’adapter à l’intelligence artificielle (IA), de plus en plus performante, au point d’avoir réussi l’examen d’entrée au barreau américain en 2023. Dans les écoles et les universités, les programmes de formation se multiplient.

Ayline Bekar, 22 ans, a toujours voulu travailler dans le droit. Aujourd’hui étudiante en master 2 « justice, procès, procédures » à l’université Grenoble-Alpes, elle se souvient de son stage de 3e dans un cabinet d’avocats. « Il y avait des piles de dossiers et d’ouvrages juridiques un peu partout sur les bureaux, décrit-elle. Les avocats passaient un temps fou à chercher et à analyser des documents juridiques. »
Rien à voir avec ce qu’elle a trouvé lors de ses stages de troisième année de licence et de master, à peine dix ans plus tard. « La dématérialisation des actes juridiques s’est généralisée, raconte-t-elle. De nombreuses activités des avocats peuvent désormais être automatisées. » Une tendance qui s’est accélérée sans commune mesure ces dernières années avec l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) dans les métiers du droit. Ces derniers « sont en train d’évoluer profondément, et les futurs juristes doivent y être formés », résume Ayline Bekar, qui, lorsqu’on l’a contactée mi-septembre, sortait de l’IA Week, événement organisé par sa fac de droit.
Ce rendez-vous réunissait justement des professionnels du secteur, des éditeurs juridiques, des « legaltech » (entreprises proposant des solutions numériques aux juristes) et des enseignants et étudiants en droit, afin de réfléchir à l’impact des IA sur les formations et les métiers de la justice. L’année 2025 a vu se multiplier ce type de tables rondes et les rapports sur le sujet. Un intérêt à la mesure de la petite révolution que constitue l’arrivée des « IA juridiques » dans un monde souvent décrit comme assez conservateur.
« Ces IA permettent aux juristes d’effectuer en quelques minutes certaines tâches historiquement très chronophages,détaille Géraldine Vial, maîtresse de conférences en droit privé et coporteuse du projet Tédia (transformation des études de droit vers l’intelligence artificielle) à l’université Grenoble-Alpes. Ils peuvent faire des recherches de jurisprudence ou de textes réglementaires dans d’immenses bases de données, mais surtout les synthétiser ou les analyser, prérédiger des textes ou des contrats, faire de la veille ou encore des statistiques. »
Les formations ne peuvent pas faire comme si ces nouveaux outils n’existaient pas. Avant même l’arrivée des IA pour le grand public, fin 2022, « les juristes et chercheurs en droit s’étaient emparés du sujet, mais surtout comme objet d’étude, avec des questionnements autour du “droit de l’IA” [propriété intellectuelle, protection des données personnelles, etc.] », rappelle Géraldine Vial. Puis l’utilisation massive de ChatGPT par les étudiants a fini par questionner les enseignants sur la place à donner à ces outils dans les apprentissages et les examens.
Les facultés de droit sont loin d’avoir trouvé toutes les réponses à ces interrogations qui traversent l’ensemble de l’enseignement supérieur. Mais, pour elles, il y a urgence : les IA génératives ont bien démontré leurs capacités dans le domaine du droit. Il s’agit autant des outils généralistes (dont le célèbre ChatGPT d’OpenAI, qui avait même réussi l’examen d’entrée au barreau américain en 2023) que de ceux qui sont mis sur le marché par les éditeurs juridiques historiques (comme Lefebvre Dalloz et LexisNexis), ainsi que de multiples start-up.
Nécessité d’accélérer la formation
Dès 2023, outre-Atlantique, une étude de la banque Goldman Sachs pointait du doigt le secteur juridique comme étant particulièrement exposé à l’IA, avec 44 % des tâches des juristes potentiellement automatisables. Au printemps, dans un sondage réalisé par l’entreprise d’édition Thomson Reuters, les 2 200 professionnels du droit interrogés partout dans le monde estimaient pouvoir ainsi économiser cinq heures de travail par semaine et deux cent quarante heures par an grâce à l’IA.
« Ces promesses de gain de temps et de productivité, portées par les outils d’intelligence artificielle générative, ont trouvé un écho favorable auprès des professions réglementées du droit [avocats, notaires, etc.] et des juristes d’entreprise, qui y semblent plus sensibles que la magistrature », précisait, en décembre 2024, un rapport sénatorial sur le sujet. Avant d’insister sur la nécessité d’accélérer la formation des futurs juristes à ces outils.
Mais, dans les faits, les écoles de spécialisation (avocats, notaires, greffes, magistrature…), comme les facultés de droit qui y mènent, commencent tout juste à intégrer des modules sur l’IA dans leur programme. On compte, parmi elles, l’université de Grenoble, qui inaugurait en septembre un nouveau cours de sensibilisation aux IA juridiques pour les étudiants en deuxième année.
La faculté de droit de l’université Savoie-Mont-Blanc, à Chambéry, propose le même type de cours à ses L2 : « Les étudiants utilisent tous les jours ChatGPT, mais sans toujours comprendre son fonctionnement, commente Christophe Quézel-Ambrunaz, professeur de droit privé. On en profite donc pour reprendre les bases : qu’est-ce qu’un modèle de langage LLM [IA spécialisée dans la génération de texte en langage naturel] ? un “biais” ? une hallucination ? un bon prompt ? etc. » Avant de leur proposer une mise en pratique sur des IA généralistes et juridiques.
L’objectif est de leur apprendre à « faire faire à la machine », tout en leur faisant prendre conscience des capacités de ces nouveaux outils, mais aussi de leurs limites. Dans ce cadre, les récentes affaires médiatisées d’avocats, américains notamment, ayant cité lors de plaidoiries des jurisprudences complètement inventées par des IA qu’ils maîtrisaient mal servent de parfaits contre-exemples.
« Pour poser la bonne question à un outil d’IA et voir quand il se trompe, l’apprentissage et la maîtrise des connaissances et compétences juridiques fondamentales sont aussi plus importants qu’avant », prévient Jean-Christophe Saint-Pau, professeur de droit privé à l’université de Bordeaux et président de la Conférence des doyens de droit et science politique. Cette dernière a lancé, dès 2023, un groupe de travail sur les IA. Parmi les questions qu’il doit encore trancher figure celle de savoir en quelle année d’études il serait plus judicieux de placer une formation aux IA.« Vaut-il mieux sensibiliser et former les étudiants dès la licence, ou bien attendre le master pour qu’ils aient eu le temps de développer seuls leur esprit critique, le raisonnement juridique, les capacités d’analyse, de croisement des sources, etc. ? », s’interroge-t-il. Dans sa fac, il a pour l’instant choisi la seconde option.
Le professeur estime également que « les IA ne vont de toute façon pas remplacer les juristes, elles vont seulement les “augmenter” ». Cette affirmation fait écho à une crainte exprimée par plusieurs interlocuteurs : celle de l’impact de l’IA sur le schéma d’insertion professionnelle des jeunes juristes. « Les tâches traditionnellement confiées aux jeunes collaborateurs (recherches juridiques, synthèses, premières ébauches de documents) sont précisément celles que l’IA peut désormais prendre en charge », explique ainsi un rapport sur l’IA du Conseil national des barreaux, paru en mai. Plus de 60 % des avocats interrogés dans celui-ci imaginent une prochaine baisse des recrutements de stagiaires, jeunes avocats, secrétaires ou assistants juridiques.
Des raisons d’espérer
Enke Kebede, présidente du Magnum Legal Club, cabinet de conseil spécialisé dans le droit et l’IA, ne nie pas ce danger mais se veut optimiste. Pour elle, de la même manière que l’IA va faire évoluer le quotidien des avocats en leur permettant de se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée (analyse, relation avec le client, entre autres), « elle doit permettre une reconfiguration du rôle des juniors, désormais chargés de piloter, vérifier et contrôler ce que font les IA, le temps qu’ils montent en compétences et en responsabilités ».
Selon cette ancienne directrice de l’Ecole régionale des avocats du Grand-Est, les étudiants en droit, jusque-là, bénéficient d’« une chance incroyable qui ne durera pas » : celle de pouvoir justement maîtriser des outils auxquels leurs futurs employeurs ne sont pas encore accoutumés, et ainsi être recrutés pour faire un reverse mentoring(« mentorat inversé »). A condition qu’ils y aient bien été formés.
Mais, pour mettre toutes les chances de leur côté dans ce monde professionnel en mutation, les jeunes juristes « doivent aussi être encore plus pointus dans leur spécialité », souligne Enke Kebede, et mieux maîtriser les « soft skills » (compétences comportementales) qui ne peuvent être automatisées par l’IA : l’esprit critique, l’amabilité, le relationnel…
Dans son rapport de décembre 2024, le Sénat donnait une dernière raison d’espérer pour le futur des étudiants en droit : le fait que l’avènement de l’IA générative ait aussi pour conséquence d’accroître la judiciarisation de la société, et donc l’activité juridictionnelle, en facilitant l’accès à l’information juridique du grand public.
Une justice qui croule déjà sous les dossiers, tant du côté des avocats que des magistrats. Dans un entretien paru en juillet, Haffide Boulakras, directeur adjoint de l’Ecole nationale de la magistrature, concluait ainsi : « L’IA peut aider à rendre la justice plus rapide, accessible et cohérente, mais elle ne doit jamais remplacer le discernement, l’écoute et l’humanité des professionnels. » Qu’ils soient déjà en fonctions ou aux portes du métier.
[Source: Le Monde]