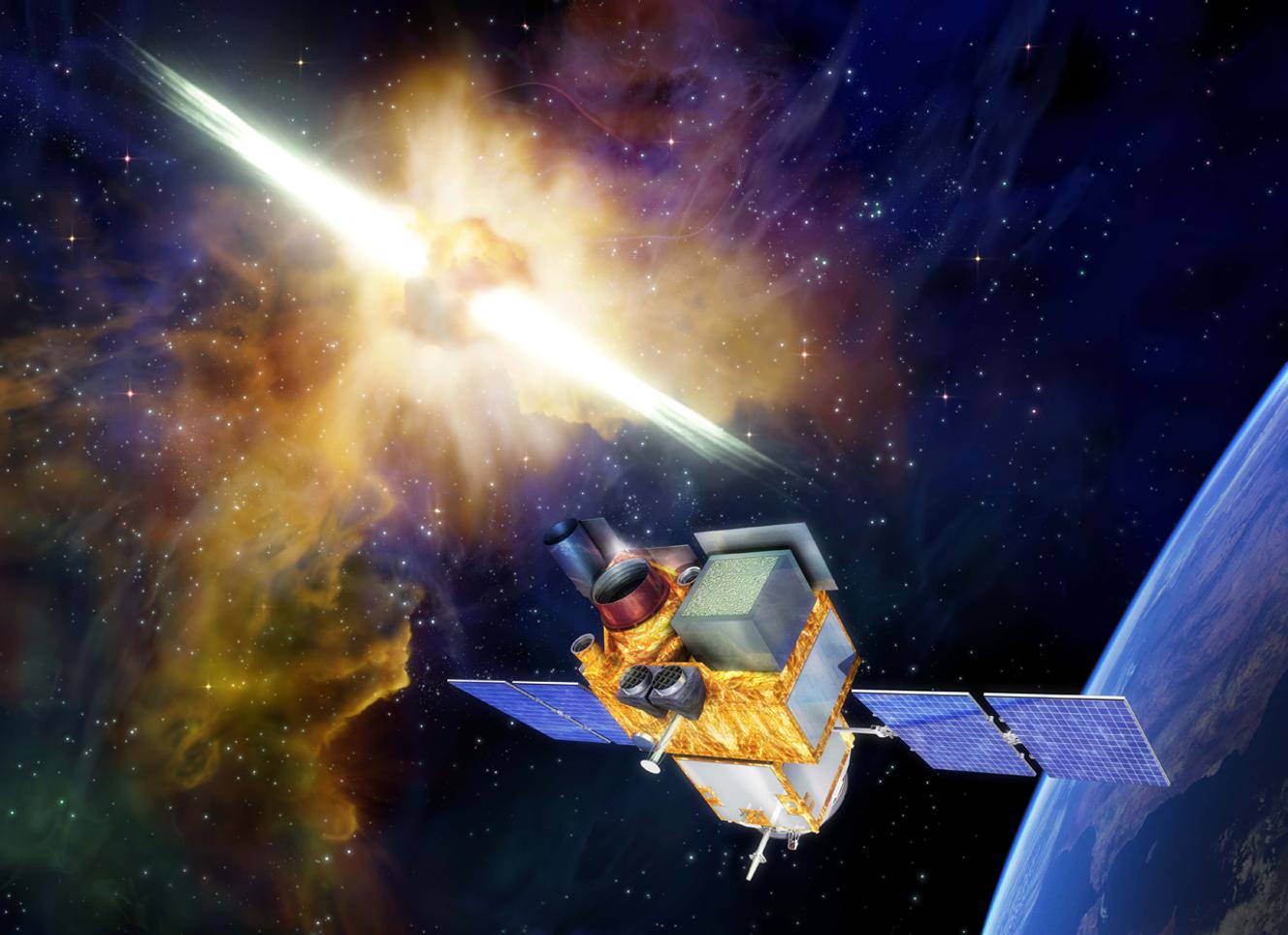En Anatolie, les sols s’effondrent sous l’effet de la sécheresse
Dans la région agricole de Konya, en Turquie, plusieurs centaines de cratères géants se sont formés en quelques années dans des sols calcaires du fait de l’épuisement des réserves souterraines en eau.

« Ce soir-là, nous avons entendu un bruit infernal. J’avais l’impression qu’un avion avait largué une bombe, que c’était la guerre », raconte Abdullah, quinquagénaire à la peau brûlée par le soleil, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille. L’agriculteur se tient au bord d’un cratère d’une vingtaine de mètres de diamètre qui défigure son champ de blé. Il y a un an, la terre s’est effondrée sur une quarantaine de mètres de profondeur en un gouffre parfaitement cylindrique. Les parois étonnamment lisses, au dégradé blanc et ocre, laissent deviner un millefeuille de couches calcaires.
Habitant d’un petit hameau de la ville de Karapinar, dans la région de Konya, en Anatolie centrale, Abdullah s’est habitué, dit-il, à la réalité des obruk (« dolines », en français). Ces affaissements du sol peuvent aller de quelques mètres à une centaine de mètres de diamètre et s’enfoncer sur une centaine de mètres de profondeur. De plus en plus fréquentes dans cette région aride, les dolines sont devenues le symbole de la sécheresse et de l’épuisement des ressources en eau qui concernent l’ensemble de la Turquie.
Trois dolines se sont formées ces dernières années sur l’exploitation de 10 hectares d’Abdullah. L’une d’entre elles a engouffré un tiers d’une parcelle où l’agriculteur faisait pousser de la betterave à sucre. La réduction des surfaces agricoles entraîne de facto un manque à gagner pour les exploitants, mais provoque aussi une augmentation du prix de la main-d’œuvre. « Au moment des récoltes, les travailleurs saisonniers qui utilisent des tracteurs demandent le double pour une surface à risque », explique l’agriculteur.
Le thermomètre avoisine les 40 °C en ce mois d’août. Une dizaine de tourterelles nichent dans les parois de la doline, rares espaces de fraîcheur dans cette steppe écrasée par le soleil. Nadi Ozdil et Veysel Can Zengin, employés de la chambre d’agriculture de Karapinar, sont venus visiter l’exploitation. Ils s’approchent prudemment du bord du gouffre pour en inspecter les contours, puis, pris de vertige, reculent de quelques pas. « L’érosion continue. Le diamètre de cette doline a augmenté depuis notre dernier passage, il y a cinq mois », constate Nadi Ozdil.
Sols fragiles
Le spécialiste, responsable du suivi de 13 000 exploitations agricoles dans la région, parvient désormais à repérer les signes avant-coureurs d’un effondrement. « La terre se tasse sur quelques mètres et des fissures peuvent apparaître », explique-t-il. Certaines dolines, à l’inverse, se forment soudainement. Les géologues recensent entre 2 000 et 3 000 cratères de ce type sur le plateau anatolien, et enregistrent une accélération des effondrements ces dernières années.
« La plus grande crainte des habitants des villages, c’est que cela arrive sur des lieux d’habitation », poursuit-il. C’est le cas dans le hameau d’Abdullah, où le sol s’est subitement affaissé sur plusieurs mètres au milieu d’un terrain vague, sans faire de victime.
Les dolines sont des dépressions caractéristiques des régions karstiques, certaines existant depuis plusieurs milliers d’années. On les trouve dans de nombreux pays, notamment en Europe centrale et aux Etats-Unis. Leur formation résulte d’une combinaison de facteurs liés à l’eau et à la géologie locale.
Ces cavités se situent généralement à quelques mètres seulement sous la surface. L’eau chargée en dioxyde de carbone (CO₂) forme un acide carbonique qui dissout la roche calcaire, creusant un peu plus la cavité sous la surface. Lorsque le volume d’eau souterraine diminue, le support qu’elle offre à la roche faiblit, fragilisant le sol. Selon les géologues, la formation et l’agrandissement des dolines s’accélèrent surtout au printemps et à l’automne, lorsque les fortes pluies alourdissent les sols déjà fragiles, provoquant parfois l’effondrement soudain du terrain.
La luzerne, « une aberration »
Avec des précipitations moyennes comprises entre 300 millimètres et 350 millimètres par an, la plaine de Konya arrive en tête des territoires les plus arides du pays. Mais la rareté de l’eau n’a pas empêché la région de se hisser au premier rang des zones agricoles les plus productives, et elle est souvent qualifiée de « grenier à blé » du pays. On y cultive aussi de l’orge, du maïs, des betteraves à sucre, ainsi que de la luzerne pour nourrir le bétail.
« La culture de la luzerne est une aberration !, reconnaît Durmus Uner, président de la chambre d’agriculture de Karapinar. C’est la plante qui consomme le plus d’eau. » Ce moustachu, lui-même agriculteur depuis près de quarante ans, dresse un tableau accablant des lacunes de gestion des exploitations agricoles dans la région.
« On ne peut pas attendre des agriculteurs qu’ils réorientent eux-mêmes leurs cultures. C’est à l’Etat et au ministère d’élaborer une planification efficace », insiste-t-il. Pour parer aux critiques de surexploitation des ressources en eau, il précise : « Tous les exploitants agricoles utilisent désormais des méthodes d’irrigation qui consomment le moins possible, telles que le goutte-à-goutte, ou le système par aspersion. Et puis après tout, l’accès à l’eau est un droit ! »
A quelques kilomètres de là, des têtes d’arroseurs apparaissent çà et là au-dessus des épis de maïs. L’aspersion, c’est aussi le type d’irrigation qu’a choisi Hasan Tasdemir pour ses parcelles. Une solution aussi écologique qu’économique, dans un contexte où les charges minent le budget des agriculteurs. Au volant de son pick-up, l’exploitant contourne prudemment le cratère qui barre le chemin vers son champ : une doline d’une quinzaine de mètres de diamètre, apparue en 2018.
Centrale solaire géante
« Ce que nous voulons est simple : c’est que l’Etat achève le projet d’acheminement des eaux du Göksu [au sud de Konya] pour soutenir les agriculteurs », affirme Hasan Tasdemir. Promis depuis plusieurs années, le projet est au point mort. Quant à la carte des risques de la région, ni Durmus Uner, ni Hasan Tasdemir n’ont eu vent d’une publication prochaine.
« Cela fait des années que les élus de l’AKP [Parti de la justice et du développement, au pouvoir] parlent du projet de reconduction des eaux dans la région, mais c’est une farce, s’agace Baris Bektas, député d’opposition élu à Konya.L’Etat doit encourager les cultures qui consomment moins d’eau, mais il n’a tout simplement pas de stratégie. »
Les récents investissements de l’Etat trahissent en effet d’autres ambitions pour la région. En 2020, Kalyon Enerji, une grande entreprise proche du pouvoir, a mis en service la plus grande centrale solaire d’Europe au nord de Karapinar. Etendue sur une surface de 20 kilomètres carrés, elle affiche une capacité de 1 300 mégawatts. Le projet est voué à s’agrandir sur des espaces de pâturage.
[Source: Le Monde]