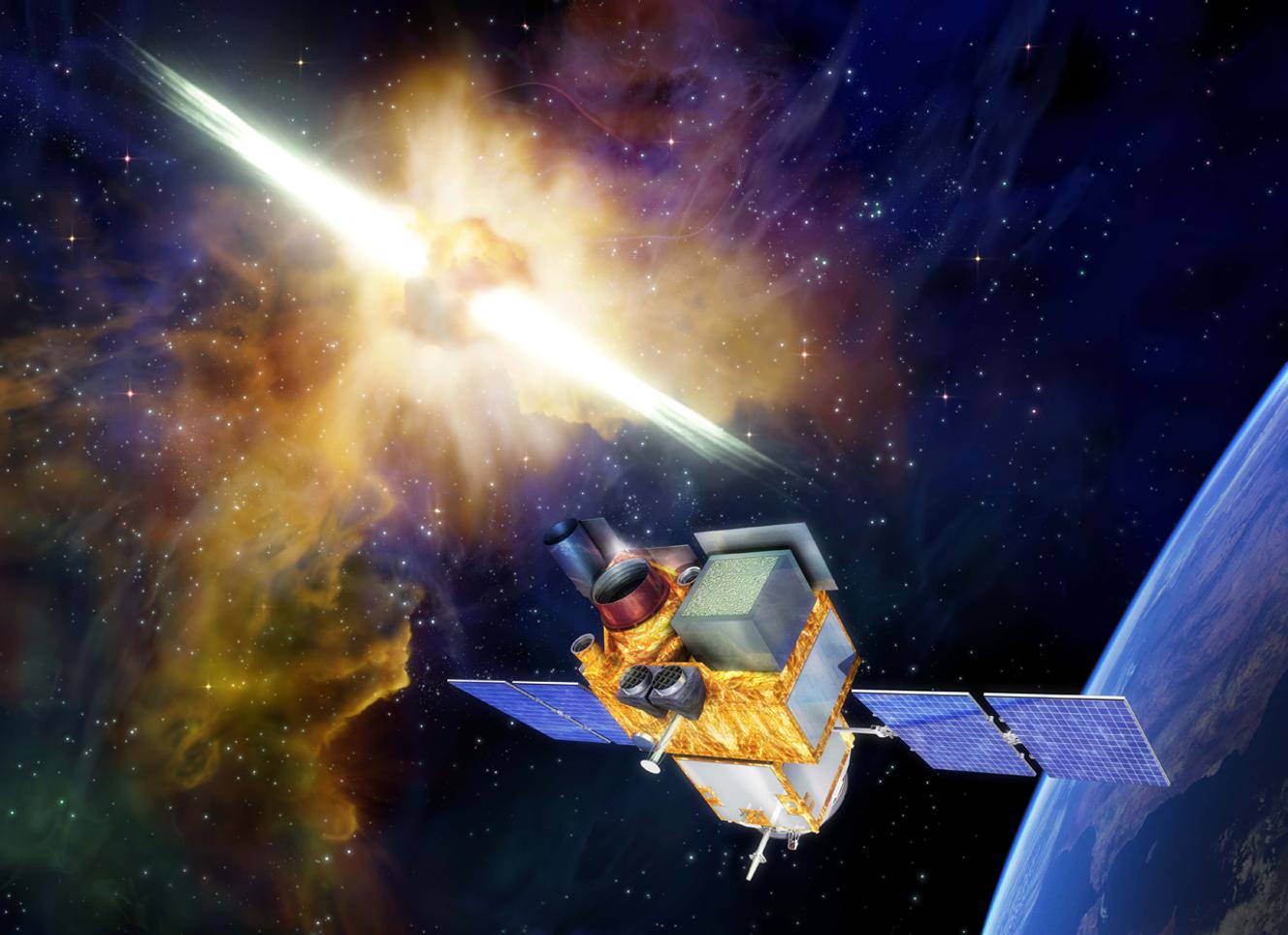Le football, une histoire d’enfance
On ne se remet jamais de son enfance footballistique, et c’est souvent elle que nous poursuivons dans notre passion pour ce sport. Comment tout cela a-t-il commencé ?

Tout le monde ne tombe pas dans le football au cours de son enfance, mais ce doit être le cas d’une majorité de ses passionnés. Le cliché de la transmission du père au fils perdure, mais peu importe quels adultes ont incité l’enfant à verser dans cette passion, d’autant qu’il n’y en a pas toujours : le football s’attrape aussi et se cultive surtout entre copains. On imagine mal une enfance de football sans copains de football.
On est en tout cas porté à regarder du football, et à y jouer, en raison de l’intensité de l’attention que l’entourage – famille ou pairs – lui porte. La proximité avec un grand club, le vécu d’une épopée européenne, l’attraction de l’équipe dominante du moment, un premier match au stade sont autant de circonstances favorables. Mais un simple hasard peut faire l’affaire.
Chacun sait quels instants vécus ont nourri sa propre fascination. Les buts, les victoires, mais aussi les défaites procurent ces pics émotionnels qui se gravent dans les jeunes esprits. Nous nous souvenons des matches qui nous ont bouleversés, des gestes qui nous ont renversés.
Notre passion s’ancre aussi dans un aspect essentiel de l’enfance : sa capacité à accorder une importance vitale à des choses absolument futiles. Quoi de plus important, au moment d’une Coupe du monde, que de remplir méticuleusement les tableaux de résultats ? Quelle attente fut plus impatiente que celle d’un grand match espéré, d’un quart de finale ou d’un match retour européen ?
Et aujourd’hui, cette passion reste profondément infantile, avec ses excès de joie, de tristesse ou de colère, ses polémiques dérisoires. L’image de « l’enfant qui est nous » est simpliste, mais il n’empêche : le football le convoque immanquablement. Sans quoi, franchement, nous nous consacrerions à des occupations plus sérieuses.
Apprendre le jeu
A quel moment comprend-on le jeu, à quel moment perd-il son étrangeté, devient-il autre chose qu’un étrange ballet de manchots qui passent beaucoup de temps à tomber ? Comment l’enfant passe-t-il du moment où il décroche des images au bout de quelques minutes à celui où il suit avidement ses héros disputer des combats aux enjeux titanesques ?
Aussi simple, universel et facile à appréhender soit le football, il faut quand même l’apprendre, apprendre à le lire pour savoir ce qu’est un beau geste, une action réussie, un but important. C’est-à-dire saisir ses difficultés, épouser les courses du ballon, discerner ce qui est possible. Savoir le regarder, en somme.
Une fois ce cap passé, c’est un jardin des plaisirs qui nous ouvre ses portes. Surtout si l’on a bien compris qu’ils sont encore plus délicieux (et douloureux aussi) quand on prend parti, quand on choisit son camp pour donner un enjeu à toute partie. Une morale un peu binaire, qui sied bien à l’enfance.
Ce basculement est forcément décisif : c’est le moment de l’imprégnation. Comme pour la musique, chacun va être marqué à vie par ses premières vraies émotions, celles qui s’impriment dans la chair et dans l’esprit, et dont nous cherchons encore les traces dans le football, une fois à l’âge adulte.
Certaines images séminales nous replongent dans ces émotions premières : le grain des photos d’une certaine époque, une page d’album Panini ou de magazine, une vidéo d’action, une voix de commentateur, un nom de joueur, etc.
L’enfant en découverte ne plonge pas seulement dans un univers esthétique et poétique : il y plonge à une époque particulière. Elle a toutes chances de définir ce qu’il aimera dans le football, à commencer par l’équipe qu’il aura choisi de soutenir – bien souvent celle qui domine à l’époque, parce que les enfants préfèrent ce qui brille. Pour vite connaître un passionné, peut-être faut-il lui demander quelle a été sa première Coupe du monde.
Le joueur préféré
Le temps de l’enfance est aussi celui des idoles. Elles nous permettent de nous distinguer de nos camarades, tout en leur ressemblant, d’affiner notre identité naissante. Ce temps des idoles finit-il vraiment ? Sommes-nous de moins mauvaise foi aujourd’hui quand il faut défendre un joueur cher à notre cœur ? Seuls les convenances et le bon goût nous empêchent de mettre un poster de lui dans la chambre.
Les vedettes – locales, nationales ou internationales – ont toujours existé, on a toujours voulu les approcher : les voir au stade, les attendre à la sortie de l’entraînement, porter leur maillot, au pire adopter leur coupe de cheveux. Le football contemporain a toutefois poussé le star-system à un extrême : on en arrive à aduler un joueur pour lui-même, et les très grands joueurs, devenus des marques mondiales, finissent par faire concurrence aux équipes.
Le culte des joueurs-phénomènes (Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé) témoigne de la disneylandisation du football et de l’attention croissante portée par l’industrie à des enfants qui sont des consommateurs compulsifs. Allez refuser à Timéo le maillot enfant du PSG qu’il réclame au motif qu’il est hors de prix (101,99 euros avec le flocage Dembélé) et pas franchement issu du commerce équitable…
C’est le problème, avec les enfants : ce sont de redoutables alliés du capitalisme. Les kids font aussi une bonne caution d’innocence pour le foot-business, qui les met constamment en scène : escortes, ramasseurs de balle, simples fans près des centres d’entraînement ou supporteurs filmés dans les tribunes. Le football recrute jeune, pas seulement pour ses centres de formation.
La nostalgie, fatalement
L’enracinement du jeu dans l’enfance explique qu’il a partie liée avec la nostalgie, une maladie que l’on contracte lorsque les années nous ont éloignés de la pureté des origines. L’adulte regrette d’avoir perdu une part de ce rapport enchanté avec le football.
Parfois, le lien peut même se rompre : on s’absente du football, on le met à distance parce qu’on poursuit d’autres chimères, ou parce que la vie que l’on a contractée ne lui laisse plus qu’une place réduite. Certains y reviennent, sont repris, d’autres le laisseront définitivement derrière eux.
À tous, il reste des souvenirs à (se) raconter. N’est-ce pas un élément essentiel du football, pourvoyeur infini d’histoires, de l’anecdote jusqu’à l’épopée ? N’a-t-il pas ce pouvoir de lier toutes les périodes, toutes les années de nos vies à des instants footballistiques – comme une chronologie parallèle ? Forcément, c’était mieux avant, puisque avant, c’était le temps de l’enfance et de sa ferveur illimitée.
Les bouleversements du football au cours des vingt ou trente dernières années ont marqué des ruptures générationnelles. On mesure l’éloignement entre, schématiquement, ceux qui ont connu un football plus égalitaire, plus incertain, plus national, plus rare, plus divers, et ceux qui n’ont connu que la révolution industrielle du football – élitiste, dérégulé, mondialisé, spectaculaire, omniprésent.
Ces derniers connaîtront-ils le même sentiment de décalage voire de déception dans deux ou trois décennies ? A toutes les époques, le football a significativement évolué, mais l’accélération récente n’a pas vraiment d’équivalent dans l’histoire. Quels enfants – c’est-à-dire, quels fans de demain – le football engendre-t-il aujourd’hui ?
Enfants de la balle
Le football de l’enfance, c’est aussi celui que l’on pratique, quelles que soient nos aptitudes. Notre sport baigne d’autant plus dans l’enfance que sa pratique primitive est précoce. Plus tard, on voudra aussi jouer un peu comme les grands, en portant un maillot de club (celui de l’équipe ou du joueur qu’on aime, ou celui du club dans lequel on est licencié).
Sur les nombreux terrains de la vraie vie – à l’école, au stade, dans le jardin, dans la rue, etc. –, on plonge avant tout dans le jeu lui-même, dans l’ivresse des matches joués jusqu’à épuisement. On poursuit le but, la victoire ou le joli geste, mais on s’adonne d’abord au plaisir collectif du football. Il est parfois empreint de frustration, de colère ou de tristesse, mais on apprend ainsi les sentiments négatifs et, au prochain match, tout recommence à 0-0.
Ce n’est pas la pire école de la vie, et c’est le temps des rêves. Nous en soulevons, des trophées, nous en mettons, des buts d’anthologie et de dernière minute. Vient toujours le moment où l’on comprend que le rêve le restera. Plus ce moment vient tôt, moins on en souffre, finalement : les joueurs brillants entretiendront plus longtemps leur illusion. C’est en tout cas un jalon symbolique, qui marque un passage dans la vie, de même que lorsqu’on se retrouve plus vieux que les footballeurs.
Mais l’enfance nous revient si nous faisons des enfants. Vient le temps de la transmission. Faut-il, d’ailleurs, transmettre cette passion porteuse de nombreuses calamités ? Ne risquons-nous pas d’être un peu trop insistants, anticipant de plusieurs années la petite larme quand on emmènera son fils ou sa fille au stade ?
Alors qu’il suffit de laisser faire : les enfants continuent de tomber dans le football, y compris quand leurs parents n’ont aucun intérêt pour lui. Ce doit vraiment être une affaire de copains, en définitive.
[Source: Le Monde]