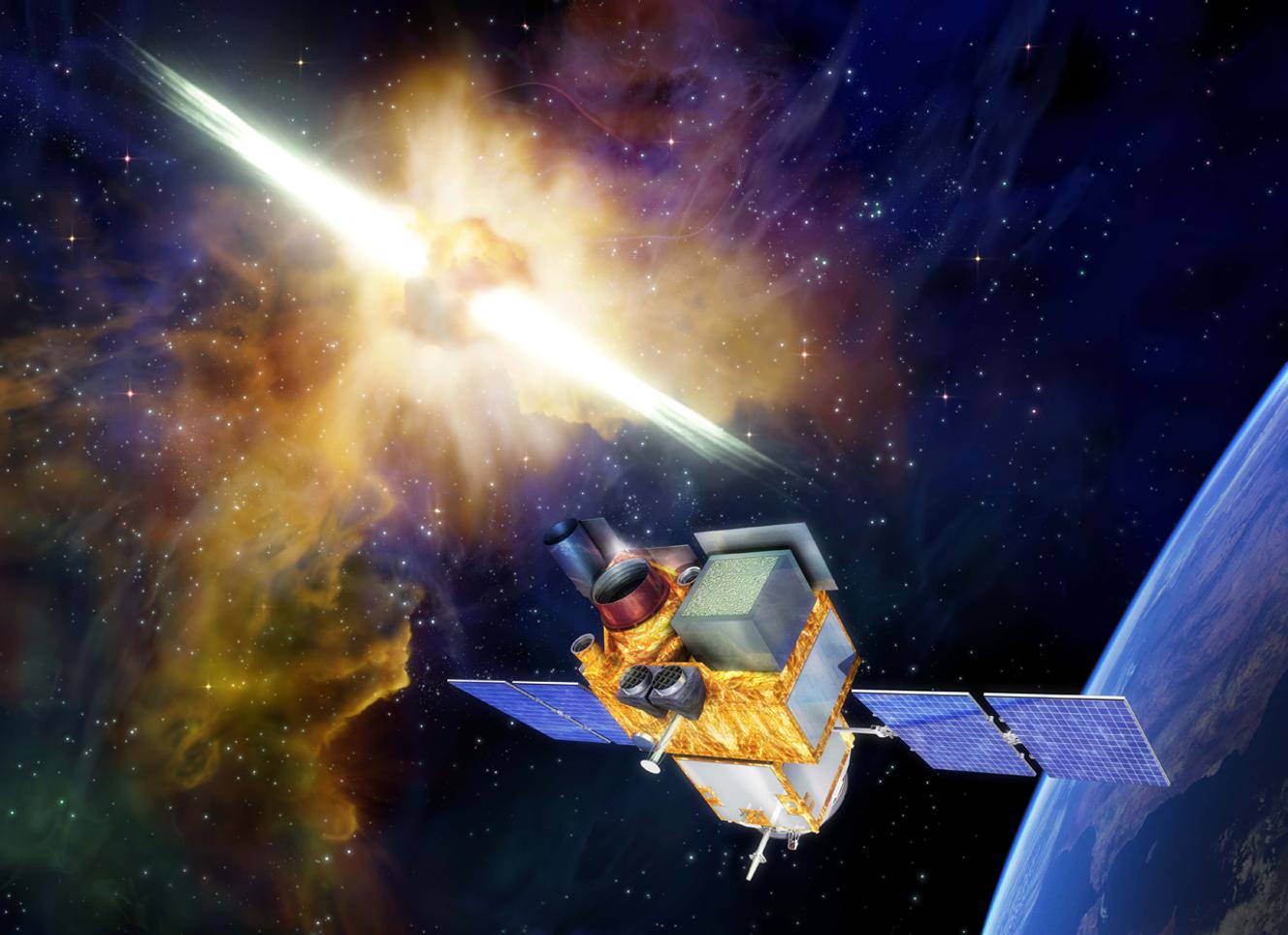Jane Goodall, la primatologue qui a révolutionné le regard porté sur les chimpanzés, est morte
Pionnière de l’éthologie moderne, devenue ambassadrice de la protection de la faune sauvage, la chercheuse britannique est morte à 91 ans.

Petite fille, c’était en homme que, en songe, elle se voyait. Elle qui aspirait à travailler avec des animaux dans un pays lointain l’avait déjà compris : cette liberté-là n’était pas une affaire de femmes. Comment aurait-elle pu deviner que la primatologie, grâce à elle, allait justement le devenir ? Que ses observations en Tanzanie allaient révolutionner le regard que nous portons sur les chimpanzés et, par là même, sur notre humanité ? Pionnière de l’éthologie moderne et ambassadrice inlassable de la protection de la faune sauvage, la chercheuse britannique Jane Goodall est morte à l’âge de 91 ans, a annoncé, mercredi 1er octobre, sur Facebook, l’institut qui porte son nom.
La première chance qu’elle eut fut sans doute sa mère, une femme qui « ne se fâchait jamais sans raison » et qui ne lui disait pas qu’elle n’était « qu’une fille » lorsque Jane Goodall lui confiait ses ambitions. La seconde fut de ne pas être allée à l’université au sortir du lycée. Née à Londres le 3 avril 1934, fille d’un ingénieur et d’une mère au foyer (puis romancière), elle n’a pas les moyens de suivre de longues études. Son diplôme de secrétaire en poche, elle enchaîne les petits boulots. En 1957, une amie l’invite au Kenya, où elle rencontre le paléontologue kényan et britannique Louis Leakey, chercheur de renom qui effectue des fouilles dans la Corne de l’Afrique. Il l’embauche comme secrétaire et ainsi change le cours de sa vie.
Leakey, qui n’a pas encore mis au jour notre ancêtre préhumain Homo habilis, cherche alors à obtenir une subvention pour étudier les chimpanzés sauvages. Persuadé que ces derniers peuvent nous éclairer sur le comportement des premiers hommes, il se méfie des idées reçues et souhaite envoyer sur le terrain un esprit vierge de toute théorie scientifique – de préférence une femme, qu’il pense plus attentive aux détails et plus empathique. Impressionné par la capacité d’observation de son assistante, dont il connaît la passion pour les animaux, il lui propose cette mission inédite. En juillet 1960, Jane débarque donc avec sa mère sur le site tanzanien de Gombe, aux abords du lac Tanganyika. Elle a 26 ans.
« Je n’aspirais pas du tout à me marier ni à avoir des enfants. Ça n’entrait pas dans ma façon de penser », raconte-t-elle dans Jane, le film que lui a consacré, en 2017, le réalisateur Brett Morgen. A l’époque, on ne savait rien ou presque des chimpanzés sauvages. « Ma mission était de m’approcher d’eux. De vivre parmi eux. De m’en faire accepter. » Sempiternellement vêtue de toile kaki afin de se fondre dans la forêt, ses yeux verts braqués derrière une paire de jumelles, la jeune femme observe, encore et encore.
Dans un premier temps, elle voit surtout des singes qui partent en courant. Mais elle finit par être tolérée et de plus en plus près (« Le mieux, c’est quand ils savent que vous êtes là, mais vous ignorent »). Elle note à loisir leurs us et coutumes, leurs interminables séances d’épouillage, leur organisation familiale, leurs gestes d’affection et leurs rixes : en quelques mois, la moisson est exceptionnelle. « Plus j’en apprenais, plus je me rendais compte de combien ils nous ressemblaient », résume-t-elle. Un constat tout d’abord fraîchement accueilli par la communauté scientifique, qui se fait fort de lui reprocher son absence de diplômes.
Des singes capables d’émotions ? Impensable pour ceux qui ne les étudient alors qu’en laboratoire ou au zoo. Quant à cette manie de leur donner des prénoms… comme si les chimpanzés avaient une personnalité ! Le premier article qu’elle envoie à une revue scientifique lui revient truffé de corrections. « Tous les “il” et “elle” ont été remplacés par le pronom neutre, et “qui” a été remplacé par “quoi” », précise l’essayiste dano-néerlandaise Stine Jensen (Les femmes préfèrent les singes, Seuil, 2006). La primatologue en herbe comprend la leçon et adopte le conseil, soufflé par un zoologiste, d’« entourer ses idées les plus séditieuses d’un ruban scientifique ». Elle n’en reste pas moins convaincue : les animaux dont elle partage le quotidien connaissent eux aussi la joie, la peur, la peine et la jalousie.
Découverte majeure
En novembre 1960, sa découverte majeure la prend par surprise. Elle observe que les chimpanzés de Gombe, pour attraper les termites dont ils sont friands, effeuillent de longues tiges qu’ils enfoncent ensuite délicatement dans le terrier de leurs proies. Non seulement ils savent mettre des outils à leur service, mais ils les fabriquent. Du jamais-vu chez d’autres que nous-mêmes. « Il faut désormais redéfinir l’homme ou accepter le chimpanzé comme humain », lui répond Leakey, auquel elle a immédiatement télégraphié ses obesrvations.
La nouvelle fait les gros titres des journaux britanniques et le célèbre paléontologue obtient des fonds de la National Geographic Society pour que Jane Goodall poursuive ses recherches en Tanzanie. Elle y gagne au passage d’être acceptée à l’université de Cambridge, qui lui délivrera en 1965 un doctorat en éthologie. Mais aussi d’accueillir à Gombe un photographe-cinéaste, le baron Hugo van Lawick, qui deviendra son mari en 1964 et le père de son fils en 1967. Et enfin la création, à Gombe, d’un centre de recherche en bonne et due forme, dont les travaux sur les chimpanzés se poursuivent encore aujourd’hui.

En quelques années, grâce à sa patience et à son sens aigu de l’observation, la primatologie devient une discipline à part entière. « Son apport majeur est d’avoir porté sur le devant de la scène le fait que les grands singes et nous faisons partie de la même famille. Il y a deux grandes étapes dans cette reconnaissance : la bataille d’Oxford et les découvertes des années 1960 », résume la primatologue Emmanuelle Grundmann, qui a présidé l’Institut Jane Goodall France dans les années 2000. Le débat d’Oxford, féroce joute verbale conduite en juin 1860 par le paléontologue Thomas Huxley (1825-1895) et l’évêque d’Oxford Samuel Wilberforce (1805-1873), portait sur l’ouvrage de Charles Darwin, L’Origine des espèces (1859). Il avait pour objet de décider si, oui ou non, le singe était notre aïeul. Depuis les travaux entrepris par Jane Goodall et par le Japonais Toshisada Nishida, on sait désormais qu’il est notre cousin sur l’échelle de l’évolution.
Dans cette discipline naissante, les femmes sont omniprésentes. En 1963, l’Américaine Dian Fossey commence à étudier le comportement des gorilles dans les montagnes des Virunga, au Rwanda. En 1971, la Canadienne Biruté Galdikas s’installe à Bornéo (Indonésie) pour y étudier les orangs-outans. Tout comme Jane Goodall et Dian Fossey, elle a démarré sa carrière sous la direction de Louis Leakey.
Baptisée « angels » ou « trimates » par leur mentor, ces trois chercheuses, par leur approche méthodologique inédite, révolutionnent nos connaissances sur les grands singes et la science du comportement animal. « Etudier une société animale donnée pendant de nombreuses années en adoptant une attitude quasi ethnographique (« quasi » parce qu’il est naturellement impossible d’interroger les autochtones en question) s’est révélé bouleversant par la qualité des informations obtenues et leur nouveauté radicale, précise le philosophe Dominique Lestel (Nous sommes les autres animaux, Fayard, 2019). Je crois qu’il n’est pas exagéré de dire que notre regard sur l’animalité, et donc sur nous, s’en est trouvé littéralement bouleversé. »
Le mythe de la Belle et la Bête
En 1966, Jane est devenue célèbre dans le monde entier. Jeune, blonde, seule dans la jungle au milieu des grands singes : les images prises à Gombe par Hugo van Lawick ont été habilement exploitées par la revue National Geographic, qui ne cessera par la suite de modeler ce que Stine Jensen appelle « l’industrie de la représentation »autour des rencontres entre chercheuses blanches et grands singes sauvages. « Le mythe de la Belle et la Bête a été joué à fond et c’est le point de départ de l’image iconique », affirme Emmanuelle Grundmann. « Une baronne raconte l’histoire des chimpanzés », titre The Evening Star de Washington en février 1966. Jane Goodall saisit la balle au vol. Dès cette époque, elle comprend la menace pesant sur l’habitat de ces grands singes et la nécessité de les protéger. Elle sait que, pour atteindre le public et lever des fonds, il faut toucher le cœur – et quoi de mieux pour cela que son histoire aux allures de conte de fées ?
« J’ai fini par accepter le fait qu’il y avait deux Jane : celle qui vous parle et l’icône qui a été créée », disait-elle. Elle ne cessera plus de cohabiter avec ces deux facettes d’elle-même. Quand nous l’avions rencontrée par une froide soirée de décembre 2018, à 84 ans, elle venait d’enchaîner plusieurs conférences dans diverses villes européennes. Son avion avait eu du retard, son taxi s’était englué dans les embouteillages, elle était visiblement épuisée. Mais elle n’avait pas dérogé à l’exercice, proposant même d’immortaliser ce moment commun par une photo. Plaidoyer oblige.
En 1986, celle qui a créé neuf ans plus tôt l’Institut Jane Goodall afin de gérer des réserves naturelles et de créer des refuges en Afrique prend un nouveau départ. Lors d’une conférence d’éthologues à Chicago, où elle présente son livre-phare, The Chimpanzees of Gombe : Patterns of Behaviour (non traduit), la chercheuse prend conscience des ravages que subissent les forêts tropicales et les animaux qui s’y abritent. Elle qui leur avait jusqu’alors tout sacrifié – y compris sa propre famille – décide alors de quitter ses chers chimpanzés. « Je me suis rendue à cette conférence en tant que scientifique, j’en suis repartie en tant qu’activiste », résumait-elle.

Dès lors, elle ne cessera plus d’arpenter le monde avec son éternel chimpanzé en peluche, multipliant conférences et entretiens pour sensibiliser à la défense de la planète et de sa biodiversité. Soutenant que « nos actes individuels peuvent aider à changer le monde », elle avait publié dans nos colonnes au printemps 2020, alors que la toute nouvelle pandémie de Covid-19 faisait rage, une tribune pour nous mettre en garde : si l’humanité continue d’ignorer les causes des zoonoses, en tolérant notamment le trafic d’animaux sauvages et la commercialisation de leurs produits, elle risque à l’avenir d’être infectée par des virus plus redoutables encore.
[Source: Le Monde]