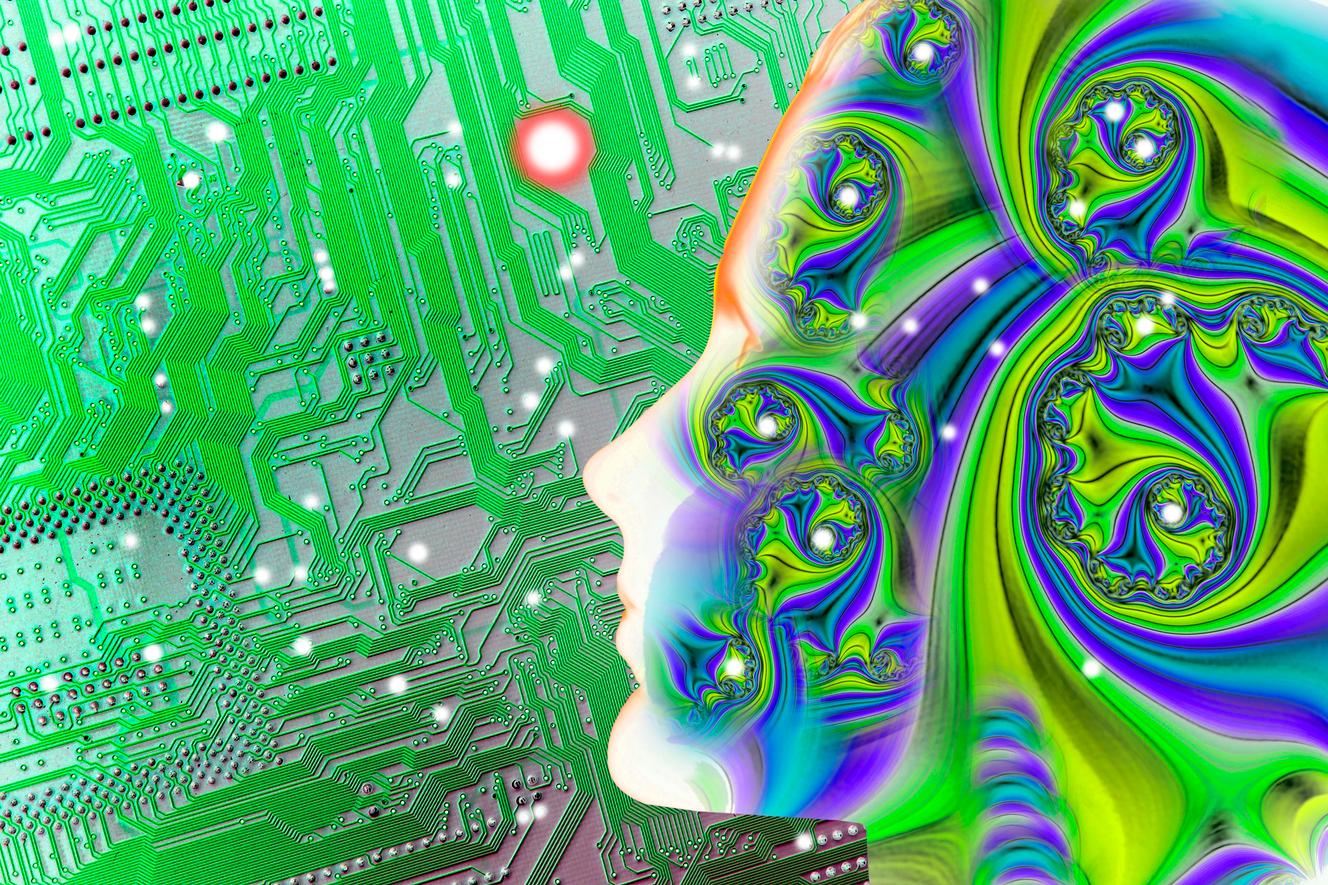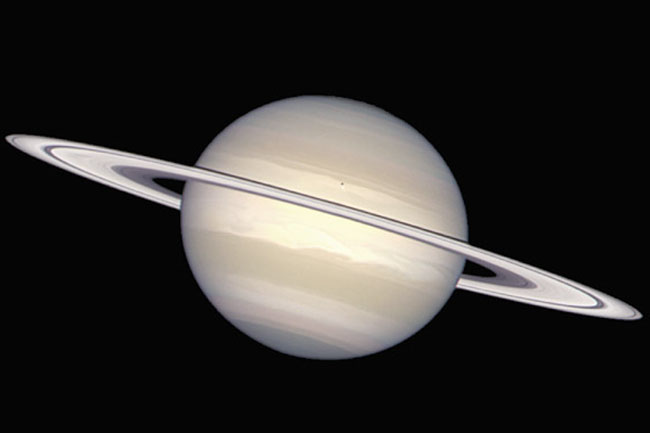Entre le Venezuela et les Etats-Unis, cent ans d’une histoire pétrolière tourmentée
Au cœur d’un partenariat énergétique puis d’un affrontement idéologique, le pétrole a fait du Venezuela un allié stratégique de Washington, avant de devenir la cible des ambitions de Donald Trump.

Des Etats-Unis victimes de « vol », d’« expropriation », de « confiscation ». A Washington, la rhétorique de la spoliation se décline sur tous les tons à propos d’un Venezuela immensément riche en pétrole, où les plus grandes compagnies américaines ont bâti, puis en partie perdu, des fortunes au fil des décennies. « Ils ont volé nos biens comme si nous étions des bébés », s’indignait le président américain, Donald Trump, en recevant, le 9 janvier, les représentants des majors américaines. Une allusion aux différentes nationalisations qui ont jalonné l’histoire de l’industrie des hydrocarbures au Venezuela, « l’un des plus grands vols de propriété américaine », selon le locataire de la Maison Blanche, justifiant d’aller « récupérer » ces ressources au bénéfice des Etats-Unis.
Mais le passé pèse lourd. Après l’enlèvement du président vénézuélien, Nicolas Maduro, par l’armée américaine, le 3 janvier, les groupes pétroliers de l’Oncle Sam sont-ils prêts à réinjecter massivement des capitaux dans le pays ? « Nos actifs y ont été saisis à deux reprises, et vous imaginez bien que pour y retourner une troisième fois, il faudrait des changements assez importants », a rappelé Darren Woods, PDG d’ExxonMobil, la plus grosse major américaine.
Ces réserves, comme les déclarations de Donald Trump, soulignent à quel point l’or noir est au cœur des relations tumultueuses entre les Etats-Unis et le Venezuela depuis un siècle. Ce sont pourtant « d’abord les Anglais qui ont donné le coup d’envoi de cette industrie [dans le pays] », souligne l’économiste Arnoldo Pirela, spécialiste du pétrole, professeur émérite à l’université centrale du Venezuela et chercheur associé, en France, au Centre population et développement.
Le tournant du 50/50
Au commencement se trouve une compagnie anglo-néerlandaise, la Royal Dutch Shell. Le 2 décembre 1922, l’un de ses puits d’exploration, dans le bassin de Maracaibo (nord-ouest), se met à cracher un puissant jet de pétrole. L’équivalent de 100 000 barils par jour jaillit à l’air libre pendant plus d’une semaine, comme en attestent les photographies publiées dans la presse mondiale de l’époque. L’eldorado pétrolier vénézuélien vient de naître, et les compagnies occidentales accourent.
Elles ne seront pas déçues. Moins d’une décennie après l’éruption de ce stupéfiant geyser, le pays est devenu le premier exportateur mondial de brut et le deuxième producteur, derrière les Etats-Unis. Dans les années 1930, le marché est dominé par trois sociétés étrangères : la Royal Dutch Shell et, du côté américain, la Standard Oil of New Jersey et la Gulf Oil, ancêtres des géants ExxonMobil et Chevron.
Si le régime autocratique de Juan Vicente Gomez (1908-1935) a réservé le meilleur accueil à ces groupes internationaux, Caracas tente progressivement de renforcer le contrôle national sur les richesses de son sous-sol. Un premier tournant intervient dans les années 1940 : un nouveau cadre juridique impose aux opérateurs pétroliers de partager leurs bénéfices à parts égales avec l’Etat. Cette loi dite « du fifty-fifty » (« 50/50 ») est restée comme un « événement marquant dans l’histoire de l’industrie pétrolière », souligne l’historien de l’énergie Daniel Yergin dans son ouvrage Les Hommes du pétrole. Les fondateurs 1859-1945 (Stock, 1991). Dans le même temps, un terme est fixé aux concessions, avec une date butoir : 1983.
Le Venezuela n’est pas une exception. A l’époque, un même nationalisme des ressources se diffuse dans la plupart des pays pétroliers, alors que les deux guerres mondiales ont confirmé l’importance stratégique de l’énergie. Pour mieux contrôler la rente et les prix, cinq producteurs créent, en 1960, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, la fameuse OPEP, parmi lesquels le Venezuela et l’Arabie saoudite. Tous les ingrédients sont réunis pour une nationalisation du secteur, que précipite le boom des prix du pétrole consécutif à l’embargo arabe de 1973.

Caracas fonde, en 1975, sa compagnie nationale, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) et met fin à un demi-siècle de suprématie étrangère dans l’industrie pétrolière. La rupture se fait à l’amiable, du moins sans grande friction. « Dès les années 1960, les compagnies étrangères avaient cessé d’investir, en raison de l’absence de renouvellement des concessions et de l’augmentation des impôts, explique Francisco Monaldi, directeur du programme énergétique latino-américain à l’Institut Baker de l’université Rice, à Houston (Texas). La nationalisation a presque été un fait accompli, gérée de manière relativement ordonnée, avec le versement d’indemnisations. »
Du côté américain, la priorité est ailleurs : « Il fallait s’assurer que le pétrole continue d’arriver », résume Diego Rivera Rivota, du Center on Global Energy Policy de l’université Columbia, à New York. Le choc de 1973 a laissé des traces. « Les Etats-Unis étaient alors importateur net ; si le pétrole venait à manquer, le risque était de voir le pays paralysé », rappelle le chercheur.
L’objectif devient donc de préserver de bonnes relations avec PDVSA. Rien d’insurmontable, tant la nouvelle entreprise se structure comme une réplique des majors internationales, reprenant leurs pratiques et leurs compétences. « Une bonne partie des cadres techniques et administratifs a été intégrée par PDVSA, qui s’est construite comme une holding d’entreprises étrangères », résume M. Pirela.
Sous-investissement massif
Jusqu’à la fin des années 1990, dans un pays surnommé « Venezuela saudita », en référence à « saoudite » et au rôle central de la rente pétrolière, PDVSA jouit d’une réputation de compagnie publique modèle, prospère et bien gérée. Preuve de la solidité de ses liens avec les Etats-Unis, elle investit dans des capacités de raffinage américaines, en partie grâce à l’achat de la société pétrolière Citgo, dont les installations sont adaptées pour traiter le brut lourd vénézuélien. De quoi sécuriser durablement ses débouchés sur le marché américain.
Les relations sont donc au beau fixe quand Caracas lance, en 1992, l’apertura petrolera. Cette politique d’« ouverture pétrolière » vise à enrayer la baisse de la production après des années de chute des prix du pétrole. Les régimes fiscaux sont révisés en faveur des majors étrangères, auxquelles sont proposées des « associations stratégiques » pour exploiter le brut extralourd de la ceinture de l’Orénoque.
« On a vu les compagnies arriver massivement et de partout », se souvient l’homme d’affaires français Henri-Jacques Citroën, qui a passé trente ans au Venezuela et conseillé de nombreuses entreprises françaises, dont Total. « Tout se faisait en bonne intelligence avec PDVSA, qui était une entreprise top niveau. Cela a entraîné un boom incroyable de l’activité. Même [Hugo] Chavez, au début, était épaté par les résultats. » L’histoire bascule toutefois peu après l’arrivée sur le devant de la scène de cet ancien lieutenant-colonel, élu en 1998 sur un programme de lutte contre les inégalités – une feuille de route qui repose largement sur la redistribution des dividendes pétroliers. Les velléités du nouveau président de replacer l’Etat au centre de l’industrie braquent PDVSA, dont une majorité du personnel entame une longue grève. Celle-ci se solde par le licenciement de 18 000 employés – ingénieurs, cadres et techniciens –, soit près de la moitié des effectifs, affaiblissant durablement les capacités opérationnelles de la compagnie.
La flambée des cours du baril, à partir de 2004, masque un temps cette fragilisation. Elle encourage aussi Hugo Chavez à renforcer sa mainmise sur le secteur. En 2006, les multinationales étrangères sont sommées de renégocier leurs contrats et d’intégrer des coentreprises contrôlées par PDVSA. Ce changement brutal des règles du jeu est jugé inacceptable par les américaines ConocoPhillips et ExxonMobil. Les deux majors quittent le Venezuela et engagent des procédures d’arbitrage international pour obtenir une indemnisation de la saisie de leurs actifs, pour un préjudice estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars – sans succès.
D’autres choisissent de rester, comme l’américaine Chevron, l’espagnole Repsol ou encore la française Total (devenue TotalEnergies), qui se retirera finalement en 2022. Entre-temps, l’industrie s’est délitée. Le sous-investissement massif, la captation des revenus pétroliers au profit des proches du pouvoir et les sanctions imposées par les Etats-Unis contre le régime de Nicolas Maduro, successeur d’Hugo Chavez, ont profondément affaibli le secteur. Malgré des réserves extraordinaires – autour de 300 milliards de barils selon les estimations –, le Venezuela n’est plus que l’ombre de lui-même. Sa production, qui atteignait 3,5 millions de barils par jour à la fin des années 1990 stagnait autour de 900 000 barils quotidiens en 2025, soit moins de 1 % de l’offre mondiale.
Donald Trump promet aujourd’hui de ressusciter le secteur à coups de dizaines de milliards de dollars d’investissements. Mais les principales intéressées, les compagnies américaines, ne paraissent guère enthousiastes. « Même si les ressources sont très abondantes, l’exploitation de celles-ci nécessite un minimum de stabilité, de règles de gouvernance et de certitude, explique M. Rivera Rivota. Or, la succession des cycles passés a montré comment un environnement en apparence sûr et prometteur peut basculer de façon spectaculaire. »
[Source: Le Monde]