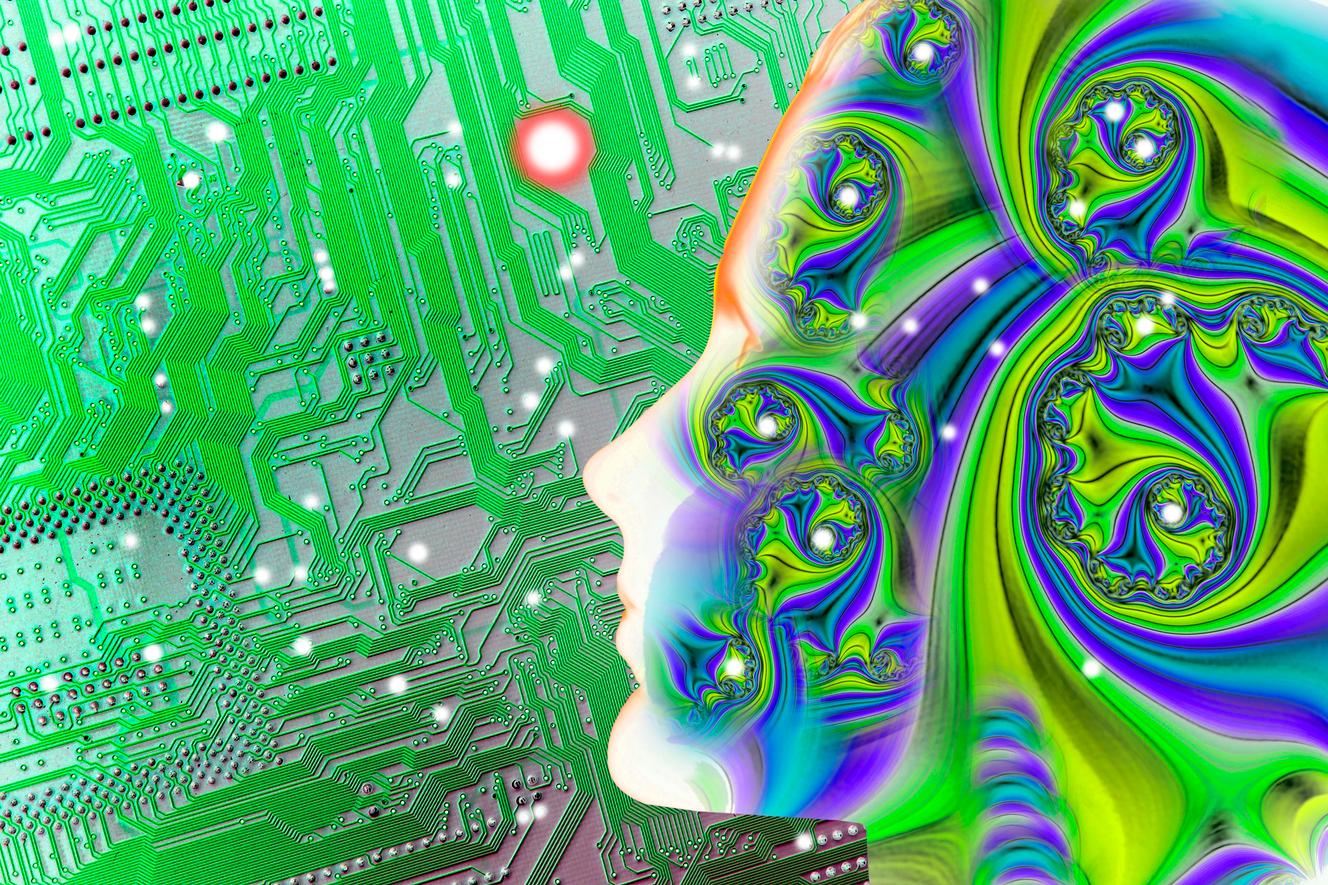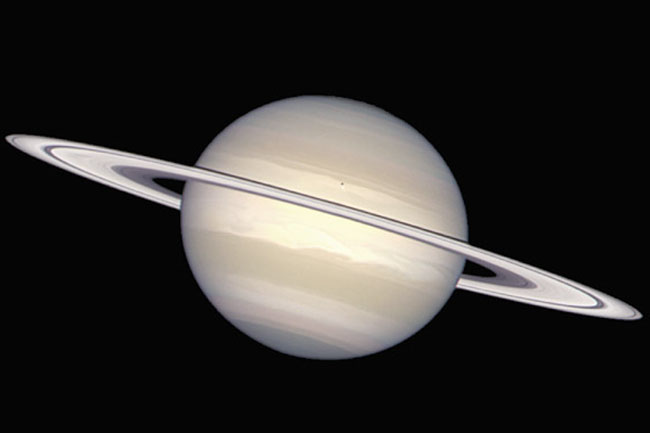Au festival PhotoBrussels, Lee Shulman livre un hymne à l’intimité
Une exposition consacrée à l’artiste britannique et baptisée « The House » réunit des diapositives Kodachrome d’anonymes glanées à travers le monde.

« Je me dis parfois que j’ai la plus grande famille du monde », s’amuse Lee Shulman. Impossible, en effet, d’en dénombrer les membres : il y a la petite qui louche derrière ses lunettes papillon, la mamie au fourneau, la belle de sortie en jupe crayon, le père assoupi dans le salon… Et des dizaines de milliers d’autres, aussi anonymes, aussi singuliers. Depuis 2017, l’artiste Lee Shulman s’est lancé dans une drôle de collection, baptisée « The Anonymous Project » : il amasse les diapositives de photographes amateurs après-guerre. Et met en scène cet album de famille démesuré dans des installations.
Le festival PhotoBrussels ne pouvait trouver meilleur ambassadeur pour célébrer ses dix ans. De la cinquantaine d’expositions proposées, qui investissent galeries, hôtels particuliers, lieux alternatifs, « The House », de Lee Shulman, déployée au Hangar, est la plus riche. Et la plus représentative sans doute de l’esprit de l’événement, qui propose un paysage extrêmement varié de la photographie : le collectif de photojournalistes Géopolis met en lumière l’Ukrainien Oleksandr Glyadyelov, l’atelier de portrait vintage Studio Baxton célèbre Dolorès Marat, l’association d’artistes La Nombreuse dévoile l’atelier participatif mené avec des adolescents placés dans des institutions judiciaires.

« Comme veut l’être cette maison qu’est le Hangar, comme ce festival qui cherche à rassembler la scène photographique belge, “The House” est une célébration de la joie d’être ensemble, un hymne à l’amour, à l’intimité », clame Delphine Dumont, initiatrice de ce Mois de la photo version belge, et directrice du Hangar qui en est le cœur battant. Famille, je vous aime, je vous hais… Les expositions à l’étage de ce centre dévolu à la photographie dévoilent leur lot de drames, de deuils et de traumas sous l’œil d’une jeune génération d’artistes venus du Mexique, du Brésil ou d’Allemagne.
Mais celle de Lee Shulman tient plutôt du « coin de cheminée » réconfortant où l’on se love, avec ses étincelles. « Pour moi, tout a commencé avec les soirées diapo de mon enfance, se souvient l’artiste britannique, installé à Paris depuis vingt ans. Mon père plongeait le salon dans le noir, il mettait de la musique : un home cinéma avant l’heure. »
Fasciné par « la relation intime, intense, que le photographe amateur entretient avec son sujet », l’artiste restreint sa passion à un type d’images : les diapositives Kodachrome, qui ont connu leur âge d’or durant les « trente glorieuses », « ces petits carrés aux couleurs extraordinaires, très stables grâce aux 14 bains qu’exigeait leur développement, décrit-il. A l’époque, il fallait envoyer les bobines dans les laboratoires de Rochester, aux Etats-Unis. On attendait parfois trois mois qu’elles reviennent ! »


Certaines, mal acheminées, ne parvenaient jamais au destinataire. Des orphelines qui atterrissent désormais parfois dans l’atelier de Lee Shulman, autour de qui un réseau de dénicheurs s’est constitué. « Les gens qui aiment le projet font maintenant famille, et m’envoient leurs trouvailles », venues essentiellement des Etats-Unis et du Royaume-Uni, parfois de France.
Il les met en scène dans le décor d’un foyer 100 % fifties-sixties, truffé de mobilier vintage. A l’instar de cette caravane qu’il trimballe d’exposition en exposition, « sans doute le mobil-home qui a le plus voyagé sans rouler », déclare-t-il, amusé. Il avait dévoilé une première version de cette maison qui fait machine à remonter le temps aux Rencontres de la photographie d’Arles en 2019. Celle-ci est plus vaste, enrichie de nouvelles pièces. Dans la cuisine de lino jaune, des photos surgissent du four, du frigo, rétroéclairées. Sur des assiettes, des bouilles d’anniversaire sont imprimées, joues gonflées devant les bougies.
Dans la chambre, des dormeurs vulnérables se succèdent, projetés. Dans la salle à manger, un lot dont il a récemment hérité, composé d’une série de prises de vues rituelles : toujours la même table, le même point de vue ; au premier plan, le même bambin au sourire trop grand. Et les années qui passent. « Ce genre de routine familiale me fascine, on en a tous. Tout le monde se reconnaît dans ces images. Moi, j’ai grandi dans une maison avec du papier peint aussi flashy. Cet enfant qui écoute la radio près de sa mère, ça pourrait être moi. Ou vous ? »

En huit ans, 1 million de photographies sont passées entre ses mains. Il en exploite environ 50 000. Pourquoi choisir certaines, en rejeter d’autres ? « Je suis aussi documentariste, et je regarde ces diapos avec mon cerveau de réalisateur : je vois l’histoire derrière, les scènes coupées. J’ai une relation cinématique, instinctive, très émotionnelle à l’image. J’aime les imperfections dans la composition, ce qui fait que la vie semble vraie. »
Qu’est-ce que la « belle image » ? C’est une question qu’il s’est beaucoup posée avec le photographe Martin Parr, mort en décembre 2025, dont il était proche et à qui il dédie « The House ». « La réponse s’imposait à nous : la belle image, c’est un acte d’amour. »
[Source: Le Monde]