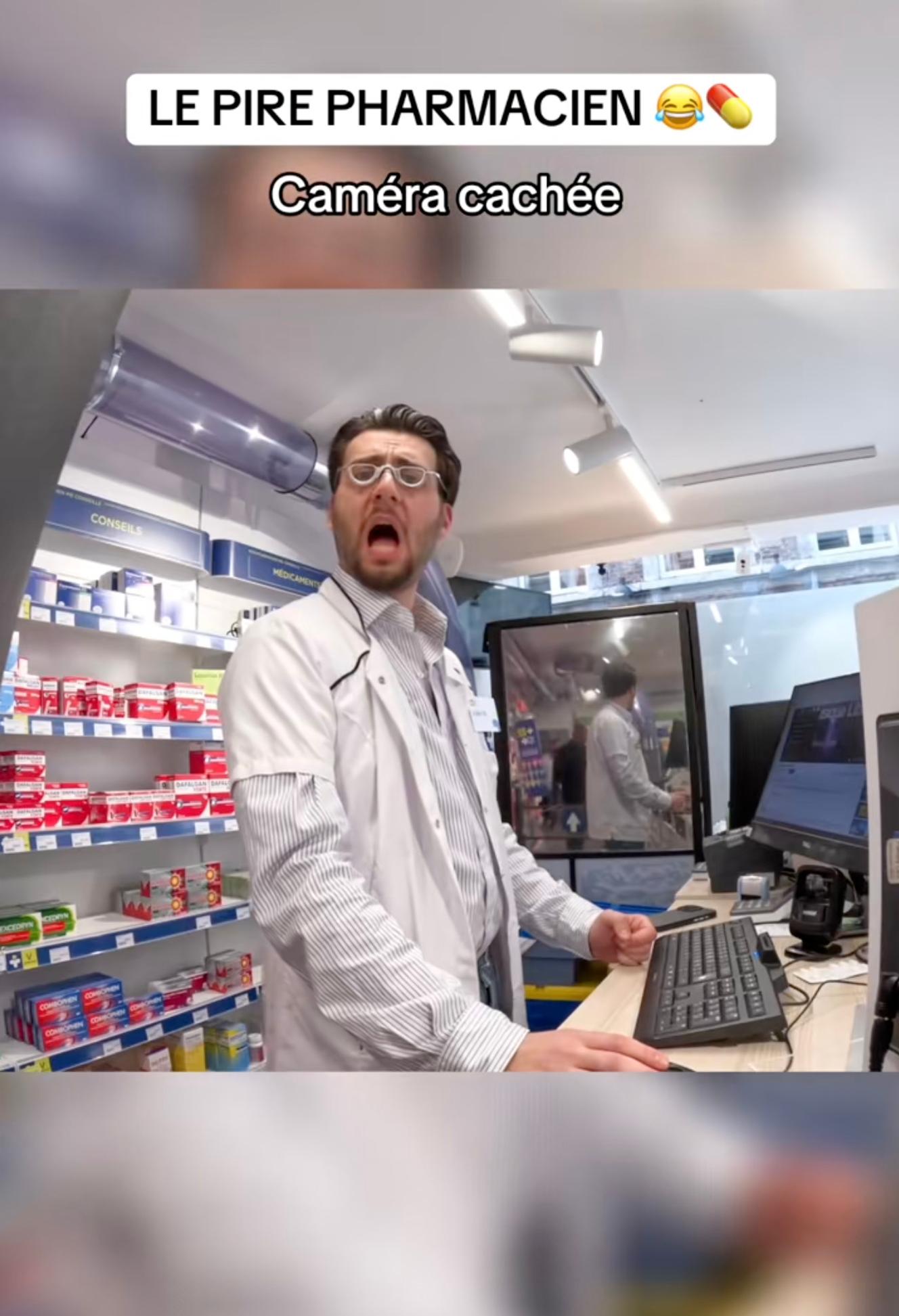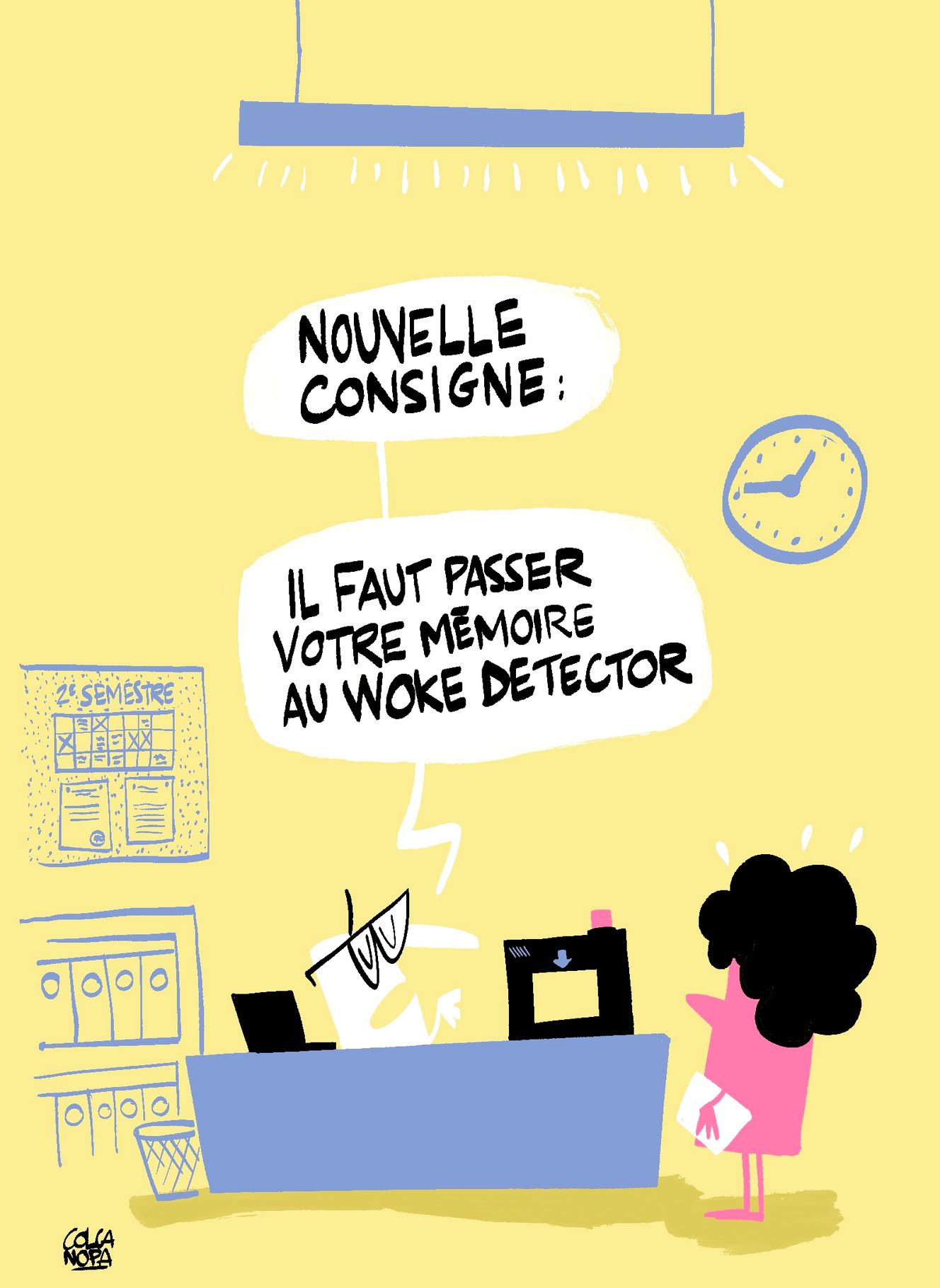Les drones, nouvelle arme des djihadistes au Sahel
La filiale sahélienne d’Al-Qaida, essentiellement active au Mali et au Burkina Faso, a acquis la capacité d’armer des appareils à bas coût. Une récente expertise qui a causé de lourdes pertes au sein des armées nationales.

Au Sahel, la guerre des drones prend une ampleur sans précédent. Un rapport du Policy Center for the New South, un institut de recherche marocain, publié le 14 juillet, met en lumière l’intensification des attaques de ces engins menées par les groupes armés de la région, notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).
L’institut recense plus de 30 attaques confirmées impliquant des drones depuis septembre 2023, dont 82 % (soit 24 attaques) ont été concentrées entre mars et juin 2025. Parmi elles, l’assaut contre la base militaire malienne de Boulikessi, le 1er juin, où le GSIM a utilisé des drones pour larguer des explosifs et a revendiqué avoir tué plus de 100 soldats maliens.
Ces appareils, dont l’usage était jusque-là limité à la surveillance, à la reconnaissance et au renseignement, ont évolué pour devenir des armes capables de mener des frappes directes. En septembre 2023, le rapport indique que « le GSIM a conduit sa première attaque armée par drone, larguant deux engins explosifs improvisés sur des positions de Dan Na Ambassagou [une milice dogon qui combat les groupes djihadistes], à Bandiagara », dans la région de Mopti, au centre du Mali.
Le GSIM utilise des drones commerciaux à bas coût, tels que ceux de la marque chinoise DJI, et les transforme en armes létales. Ils sont vendus entre 300 et 500 euros sur Internet et dans les magasins à Bamako et à Ouagadougou. « Il ne s’agit pas de drones armés sophistiqués, mais de drones civils, utilisés, par exemple, par des photographes ou par le grand public. Ils sont facilement accessibles sur le marché, dans n’importe quel commerce. On y attache des grenades artisanales, c’est-à-dire des explosifs improvisés. Pour les déclencher, il suffit d’utiliser un téléphone portable connecté au réseau mobile pour activer le mécanisme », explique Rida Lyammouri, chercheur et coauteur du rapport.
Filière ukrainienne
L’intelligence artificielle joue aussi un rôle-clé et facilite ces attaques, en permettant à des non-spécialistes de modifier les logiciels, d’optimiser les trajectoires de vol et de résoudre des problèmes matériels. « Ces outils, transférables via une simple clé USB, facilitent l’adaptation des drones pour transporter des charges lourdes, comme des mortiers », précise Niccola Milnes, analyste et coautrice.
Le GSIM a ainsi affiné ses capacités en peu de temps, utilisant cette technologie aérienne en parallèle de ses opérations terrestres, selon Rida Lyammouri. « Cette progression s’inspire notamment du modèle de guerre par drones à faible coût observé en Ukraine », poursuit-il. Indirectement, la filière ukrainienne n’est pas étrangère à la nouvelle expertise du groupe djihadiste. En effet, depuis au moins un an, Kiev collabore avec les rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA), en guerre contre l’armée malienne et ses alliés russes d’Africa Corps (ex-Wagner).
Après la bataille de Tin Zaouatine, en juillet 2024, lors de laquelle l’armée malienne et ses supplétifs russes avaient subi une lourde défaite, Andri Ioussov, le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien, avait déclaré que les rebelles avaient « reçu les données nécessaires qui leur ont permis de mener à bien une opération militaire contre les criminels de guerre russes ». Or, le GSIM et le FLA entretiennent depuis toujours des liens étroits. Certains anciens hauts responsables de la rébellion, comme l’ancien colonel Hussein Ghulam, ont récemment rejoint le GSIM, transférant également leurs compétences techniques.
Levier psychologique
Au-delà de leur impact tactique, les drones servent de levier psychologique. Ces dernières années, les gouvernements du Mali et du Burkina Faso se sont, eux aussi, équipés de drones pour combattre les groupes armés qui opèrent sur leurs sols. Eux ont acheté du matériel militaire, comme des Bayraktar TB2, à 4,6 millions d’euros l’unité, produits par la société turque Baykar. Mais ils n’en ont que de petites quantités. « En tout, les deux pays n’ont pas plus de 20 drones Bayraktar TB2 », explique une source militaire malienne, sous couvert d’anonymat.
Ces engins sont capables de surveiller, repérer et frapper avec précision. Après chaque opération, des images de frappes sont diffusées par les télévisions nationales pour montrer leur efficacité. En réponse, les groupes armés imitent cette stratégie en publiant sur les réseaux sociaux leurs propres vidéos d’attaques de drones, cherchant à démontrer leur puissance.
Selon Rida Lyammouri, il faut s’attendre à une expansion de l’utilisation de ces appareils par les groupes armés sahéliens, qui pourraient partager leurs techniques de modification et d’usage des engins. « La menace est réelle pour les trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel, mais aussi pour les pays côtiers comme le Bénin et le Togo, où le GSIM est actif », conclut le chercheur.
[Source: Le Monde]