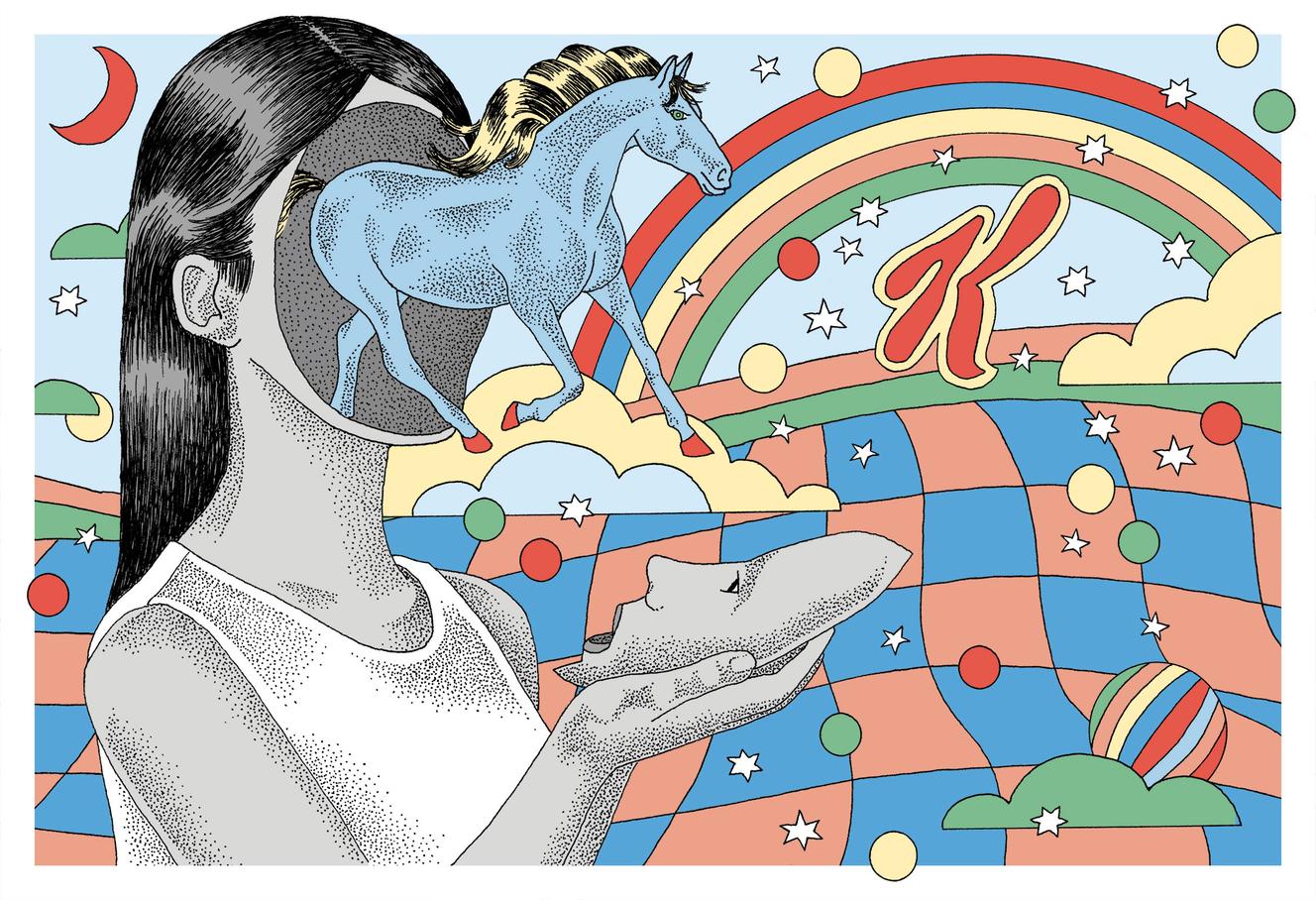Pollution aux plastiques : négociations de la dernière chance à Genève pour aboutir à un premier traité mondial
Une centaine de pays souhaitent fixer, dans un traité international, un objectif de baisse de la production à la source de plastiques, mais les pays producteurs de pétrole et de gaz s’y opposent.

Les négociations pour aboutir à un traité mondial contre la pollution aux plastiques jouent les prolongations. En pleine torpeur estivale, plusieurs centaines de délégués représentant 176 pays membres des Nations unies, les organisations non gouvernementales (ONG), la communauté scientifique, mais aussi l’industrie pétrochimique se retrouvent à Genève du 5 au 14 août pour une sixième et en théorie ultime session. La précédente, organisée à Pusan, en Corée du Sud, en décembre 2024, était déjà censée être la dernière. Las. Faute d’un accord, une date supplémentaire a été ajoutée au calendrier déjà très chargé de la diplomatie environnementale (Conférences climat, biodiversité, océan…).
Organisée dans un contexte géopolitique tendu, elle apparaît comme la réunion de la dernière chance pour parvenir à un accord entre deux blocs dont les positions n’ont jamais paru aussi éloignées : d’un côté une centaine de pays, dont ceux de l’Union européenne, poussent pour un traité ambitieux qui s’attaque au problème à la source en fermant le robinet d’une production de plastiques aujourd’hui hors de contrôle ; de l’autre un petit groupe de pays producteurs de pétrole et de gaz emmenés par l’Arabie saoudite, l’Iran et la Russie et soutenus par la Chine et les Etats-Unis s’y oppose fermement et veut cantonner le périmètre du traité à la question de la gestion des déchets et du recyclage.
Les chefs des délégations se sont retrouvés début juillet à Nairobi au siège du Programme des Nations unies pour l’environnement pour préparer le rendez-vous suisse. « Les pays gros producteurs de plastiques vont arriver à Genève avec l’intention qu’il n’y ait pas d’accord du tout, ou alors le moins ambitieux possible », avertit une sourcediplomatique qui participe aux pourparlers pour la France. La ministre française de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a prévu de se rendre à Genève du 11 au 14 août. Au cabinet de la ministre, on veut toujours croire à « un accord », même si on reconnaît que la mission s’annonce « difficile ». En cas de nouvel échec, la possibilité d’un retour à la case départ n’est plus exclue : voter une nouvelle résolution lors de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement à Nairobi.
C’est là que tout a démarré en mars 2022. Cent soixante-quinze pays adoptent alors une résolution qualifiée d’« historique » : elle fixe pour objectif d’aboutir d’ici à la fin 2024 à un texte juridiquement contraignant visant à mettre fin à la pollution aux plastiques et à la menace protéiforme qu’elle représente pour l’environnement, le climat et la santé humaine.
« Le plastique est une arme de destruction massive. Ici, on ne négocie pas n’importe quel traité, mais le traité le plus important pour la survie de l’humanité depuis l’accord de Paris », rappelle, ulcéré par l’échec de Pusan, le chef de la délégation du Panama, Juan Carlos Monterrey Gomez. « L’histoire ne nous pardonnera pas si nous ne parvenons pas à un accord. Chaque jour de retard est un jour contre l’humanité », avertit celui qui s’est imposé comme l’un des leaders des pays qui militent pour un texte ambitieux avec des objectifs de réduction de la production de plastiques.
Poison pour les écosystèmes et la santé humaine
Au rythme actuel, celle-ci devrait doubler pour atteindre le milliard de tonnes par an avant 2050. Elle s’accompagne d’une explosion comparable des déchets de plastiques, qui pourraient dépasser les 600 millions de tonnes par an à l’horizon 2040. A l’échelle planétaire, moins de 10 % sont recyclés, près de la moitié sont enfouis dans des décharges et 19 % sont incinérés. Le reste (22 %) se retrouve dans l’environnement et notamment dans les océans. Poison pour les écosystèmes et la santé humaine, le plastique est également un danger pour le climat. Selon les estimations du programme des Nations unies pour l’environnement, la part des émissions liées à la seule production de plastiques, qui repose sur l’extraction et la transformation d’énergie fossile, devrait quasiment quadrupler d’ici à 2050, pour représenter 15 % des émissions globales de gaz à effet de serre.
Les négociations achoppent précisément sur la question de la production. Une majorité de pays emmenés par la « coalition de haute ambition » et soutenus par les ONG et la communauté scientifique défend un texte qui grave dans le marbre des objectifs globaux de réduction. Le Rwanda et le Pérou, deux pays moteurs de la coalition, ont proposé, sans succès, d’inscrire dans le texte une baisse de 40 % entre 2025 et 2040. L’Arabie saoudite et les Etats pétrogaziers ne veulent pas en entendre parler : pas question, pour eux, de se priver de la manne que représente l’industrie du plastique et en particulier des emballages.
Premier producteur mondial de plastiques, la Chine soutient, dans l’ombre, la position de ces pays, tout comme l’Inde et le Brésil. En visite en Chine le 29 et le 30 mai, la ministre de la transition écologique française n’est pas parvenue à convaincre son homologue.
« Mettre un terme à la tyrannie du consensus »
Lors de la Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC) organisée du 9 au 13 juin sous l’impulsion de la France, 95 pays ont signé l’« appel de Nice » pour exiger « l’adoption d’un objectif mondial visant à réduire la production et la consommation de polymères plastiques primaires à des niveaux durables ». Une manière, avant le rendez-vous crucial de Genève, de renforcer la pression sur la Chine et les Etats-Unis : les deux plus gros consommateurs de plastiques freinent les négociations depuis le début en s’opposant à toute forme d’obligation juridique globale au profit d’engagements volontaires au niveau national.
Juriste au Centre pour le droit international de l’environnement, Andres Del Castillo estime que la déclaration de Nice, au-delà du signal politique, peut « mettre un terme à la tyrannie du consensus qui empêche tout progrès depuis des décennies dans les discussions multilatérales sur l’environnement ». En d’autres termes, aboutir à Genève à un traité ambitieux par un vote sans les Etats qui veulent l’affaiblir et utilisent la règle onusienne du consensus comme un droit de veto. C’est l’option défendue par le Pérou, moteur depuis le début des négociations : aboutir à « un traité des consommateurs » qui s’imposeraient aux « producteurs ».
Du côté de la diplomatie française, on reconnaît que « la possibilité du vote est une option sur la table », mais que l’objectif reste de « parvenir à un accord ambitieux par consensus ». Et la France compte sur une inflexion de la Chine pour y parvenir. « Il faut faire basculer les pays producteurs, qu’ils trouvent aussi leur intérêt dans l’accord, sinon sa portée sera amoindrie, confiait au Monde Agnès Pannier-Runacher après l’UNOC. Il faut faire miroiter à la Chine qu’elle peut devenir la championne des alternatives au plastique ; elle a déjà la chaîne de production du bambou. » Ce sera plus compliqué avec l’Arabie saoudite ou l’Iran.
[Source: Le Monde]