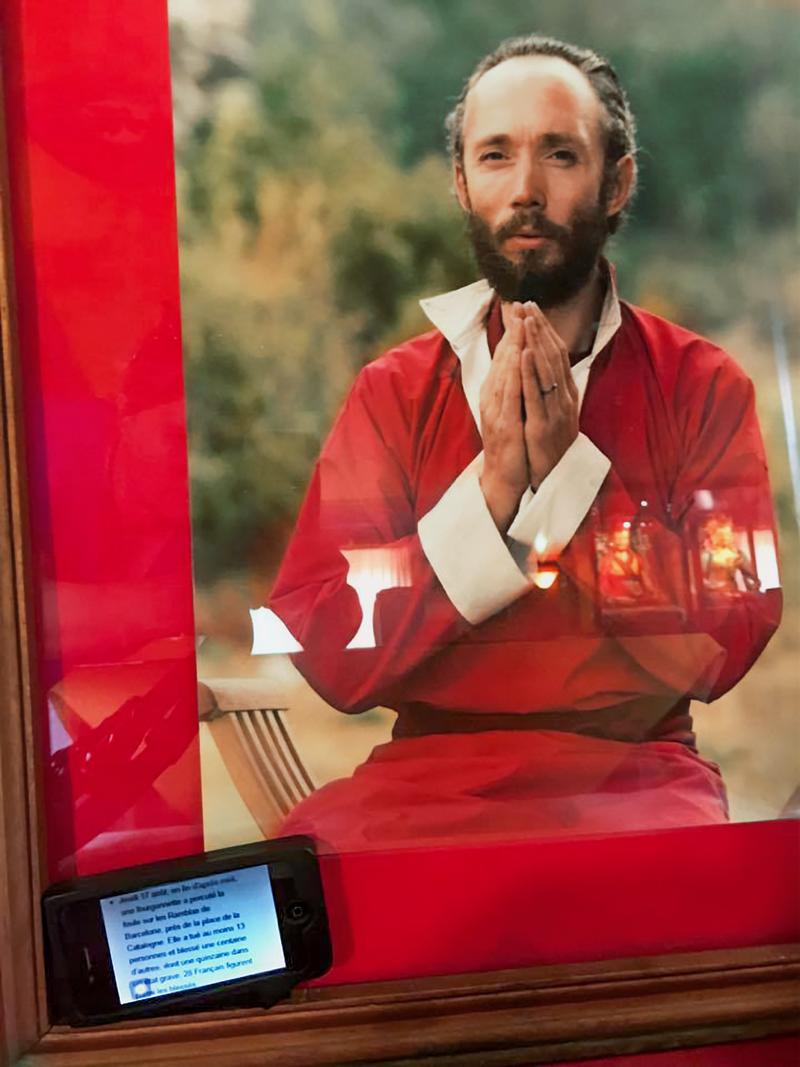La banalisation du forfait jours menace les salariés de surcharge de travail
Le décompte du temps de travail en jours, initialement réservé aux cadres autonomes, concerne désormais 18 % des salariés. Mais rares sont les entreprises à contrôler effectivement le temps et la charge de travail, alors que les employeurs y sont tenus.

« Dans 90 % des contentieux de cadres, le forfait jours est abordé. Quasi systématiquement, les entreprises n’ont pas mis en place le cadre pour contrôler son usage, constate Cyrille Catoire, avocat en droit social, qui défend aussi bien des entreprises que des salariés. Tout le monde sait ce qu’il faut faire, mais personne ne met en place les mesures simples pour éviter d’être condamné. » Vingt-cinq ans après sa naissance, le forfait jours fait toujours débat.
Ce régime dérogatoire unique en Europe, né en 2000 de la loi Aubry 2, permet de décompter le temps de travail non plus en heures, mais en jours (218 par an au maximum), pour mieux s’adapter à la discontinuité de l’activité des cadres autonomes.
A l’origine destiné aux cadres supérieurs, il est applicable, depuis 2005, à tous les salariés « autonomes » pour organiser leur travail. La part de l’effectif à temps complet en forfait jours, dans les entreprises d’au moins dix salariés du secteur privé non agricole, est passée de 11,8 % en 2010 à 18,3 % en juin 2025, selon les chiffres du ministère du travail. Dans les entreprises de plus de 500 personnes, un salarié sur quatre est désormais au forfait.
Pour l’employeur, cette modalité présente l’avantage de ne pas avoir à compter ni à payer d’heures supplémentaires. Côté salarié, outre la possibilité de s’organiser à sa guise, le forfait vient normalement en échange d’une augmentation de salaire, et de jours de repos complémentaires. Le salarié peut le refuser. « Le fait de ne pas badger et de ne pas rendre des comptes aussi souvent plaît massivement, c’est la face dorée de la médaille », reconnaît Jean-François Foucard, secrétaire national de la CFE-CGC.
Taux horaire proche du smic
Dans les faits, cette autonomie cache souvent des conditions de travail difficiles. Selon un baromètre publié en juin par l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (Ugict)-CGT, 37 % des cadres au forfait jours déclarent travailler plus de quarante-cinq heures par semaine, contre 28 % pour l’ensemble des cadres.
Dans certains cas, où des professions intermédiaires ou des cadres débutants atteignent de tels horaires, il n’est pas rare que le taux horaire se rapproche en réalité du smic. « Hormis certaines conventions collectives, il n’y a pas de salaire minimal associé au forfait jours, explique Félix Guinebretière, avocat en droit social. Or, quand une entreprise propose de passer de trente-neuf heures à un forfait sans augmentation, il y a souvent des chances qu’il travaille plus sans gagner plus. »
« Ce que l’on voit dans les entreprises, ce sont des passages au forfait de façon insidieuse, qui conditionne les promotions futures à son acceptation, constate Agathe Le Berder, secrétaire générale adjointe de l’Ugict-CGT. Et c’est devenu la norme pour les jeunes salariés qui signent un premier contrat, alors que c’est censé être un acte volontaire et concerner des postes réellement autonomes. »
« Il y a un fossé entre la volonté initiale et ce qu’est devenu le dispositif. Initialement, la CFDT avait soutenu sa mise en place, car il répondait aux réalités de l’activité des cadres, rappelle Delphine Meyer, juriste à la confédération. Mais plusieurs assouplissements, comme l’ouverture aux non-cadres ou le fait, depuis 2008, que les salariés puissent renoncer à une partie de leurs jours de repos, ont contribué aux dérives des employeurs. »
En 2011, la Cour de cassation a affirmé le manque de garanties suffisantes pour protéger la santé des salariés dans les conventions collectives de forfait, ce qui a forcé plusieurs branches à les revoir, pour inclure les modalités du suivi de la charge de travail par l’employeur. Malgré ces évolutions de la jurisprudence, rares sont encore les entreprises à respecter leur obligation. Les seules limites légales sont celles du repos minimal de onze heures entre deux journées de travail et de trente-cinq heures consécutives une fois par semaine.
Un vrai droit à la déconnexion
Si, en justice, un employeur n’arrive pas à prouver qu’il a mis en place les mesures suffisantes, les tribunaux peuvent déclarer la convention de forfait jours « inopposable », ce qui ouvre la porte au paiement de toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de trente-cinq heures, sur les trois dernières années du contrat de salarié. Des sommes pouvant atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers d’euros.
Pourtant, les investissements à effectuer ne sont pas énormes. « On doit avoir un contrôle du temps de travail : soit un suivi papier, soit une badgeuse, mais on doit s’assurer des temps de repos, renchérit Laurence Breton-Kueny, vice-présidente déléguée de l’Association nationale des DRH et DRH du groupe Afnor. Il faut aussi veiller à ce que les personnes n’envoient pas de mails le soir, et à ce qu’une partie de l’entretien annuel soit consacrée à la charge de travail. »
Pour Jean-François Foucard, l’instauration d’un vrai droit à la déconnexion est essentielle. « Avec toutes les réunions, les mails à gérer, il y a davantage de temps contraints, et les gens ont du mal à maîtriser leur temps de travail productif, ce qui fait qu’il déborde. » Il faut aussi veiller à ce que le salarié n’ait pas de contraintes horaires. « Dans la grande distribution, des directeurs de magasin sont au forfait, alors qu’ils doivent respecter les horaires d’ouverture, ce qui devrait suffire à leur interdire d’en bénéficier », constate-t-il.
Proposer le forfait à tout salarié est un mauvais réflexe. « Je remarque toujours l’appétence de cadres qui exigent d’être recrutés au forfait jours. Or, il est conditionné à l’emploi exercé, qui doit être autonome, rappelle Mme Breton-Kueny. Il y a l’opportunité du forfait heures plus sécurisant pour l’employeur et qui permet aussi une autonomie. En dix ans, à l’Afnor, nous sommes passés de 19 % à 48 % des cadres en forfait heures. »
La convention collective Syntec (bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils…) prévoit que seuls les salariés ayant atteint un certain niveau de classification et de salaire sont éligibles au forfait, et devront bénéficier d’une rémunération minimale de 3 905 euros brut mensuels. « Mais les branches veulent toujours élargir le champ des salariés éligibles aux techniciens et aux agents de maîtrise. On le voit côté Syntec comme ailleurs, s’inquiète Mme Le Berder. Ce mouvement de fond, c’est un grand risque pour la santé des salariés. »
[Source: Le Monde]