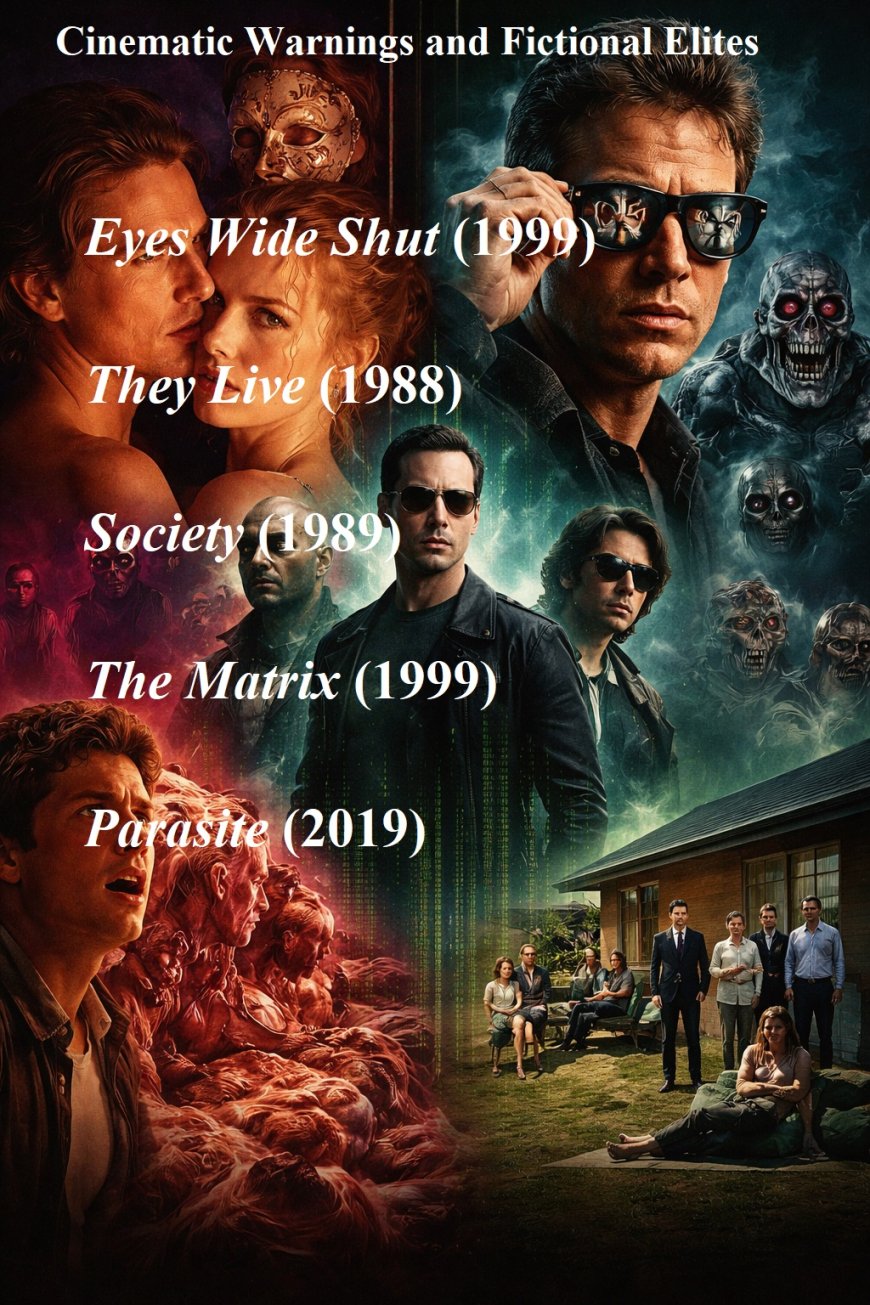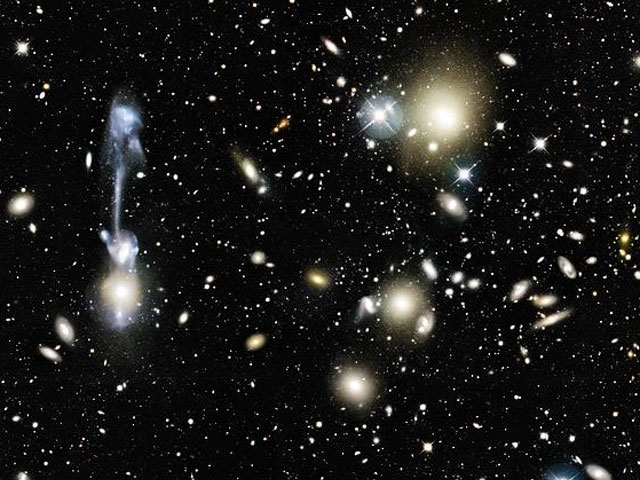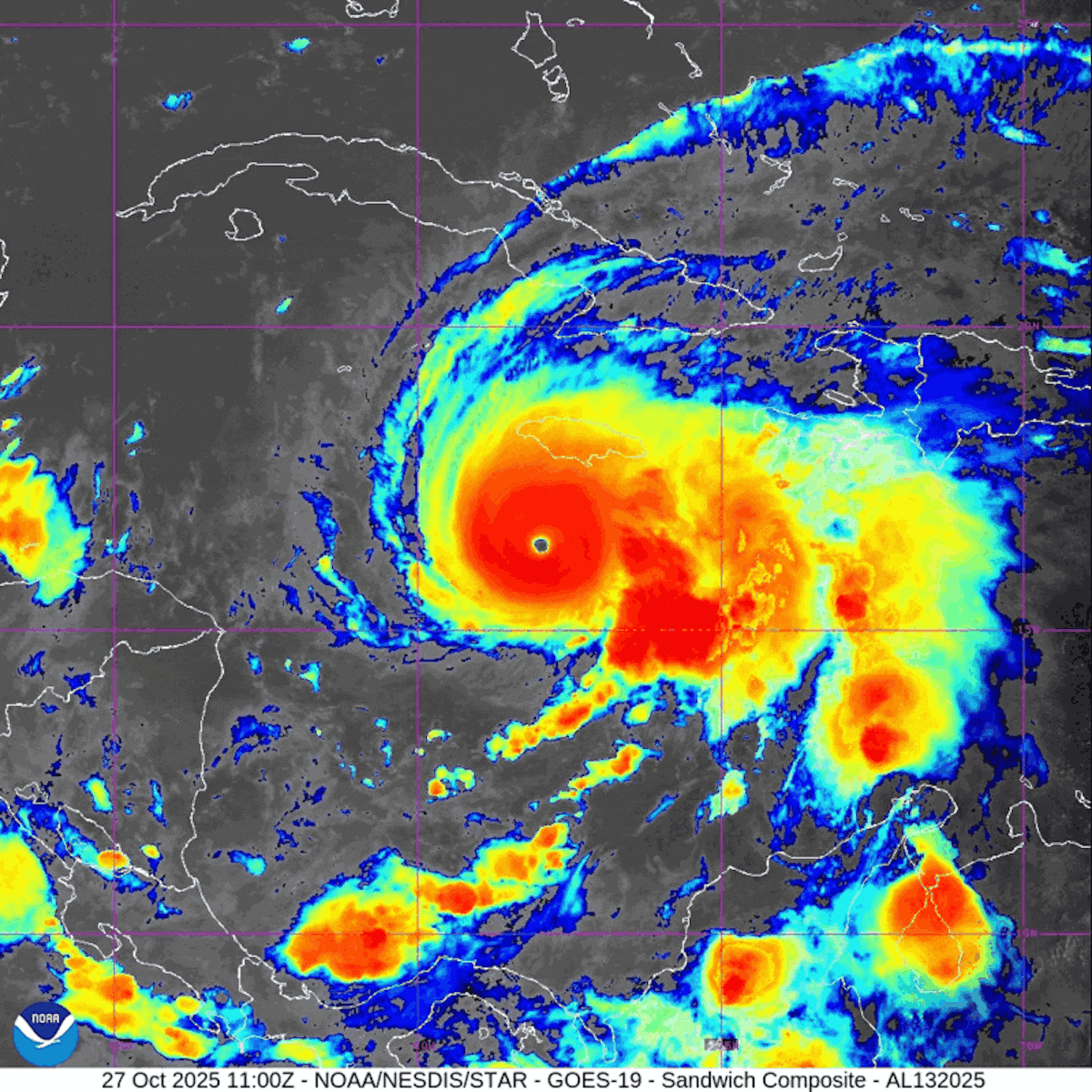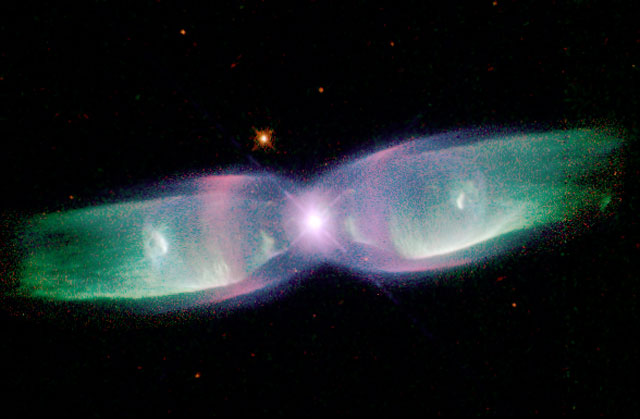A la COP30 de Belem, la lutte contre la faim se heurte à un agenda très favorable à l’agro-industrie
Le Brésil a présenté deux engagements lors du sommet des chefs d’Etat : l’un, consensuel, sur la lutte contre la faim et la pauvreté, et l’autre, plus controversé, qui entraînerait une hausse du recours aux agrocarburants. Deux textes perçus comme contradictoires.

A quelques heures d’écart, lors du sommet des chefs d’Etat pour le climat, préambule à la 30e conférence des parties pour le climat (COP30), qui se tenait jeudi 6 et vendredi 7 novembre à Belem (Brésil), deux engagements internationaux ont illustré certaines des contradictions qui parcourent ce grand rendez-vous en faveur de l’habitabilité de la planète.
En toute fin de sommet, vendredi, quarante-trois pays ainsi que l’Union européenne ont signé la « déclaration de Belem sur la faim, la pauvreté et l’action climatique centrée sur les humains », qui appelle à un « changement radical dans notre approche de l’action climatique ». Avec ce texte – non contraignant –, les Etats s’engagent à faire de la protection sociale le pilier de l’adaptation et à soutenir les petits producteurs agricoles comme « agents de résilience » – les petites fermes assurent de 35 % à 50 % de la production alimentaire mondiale, selon les seuils retenus. La « transition juste » y est érigée comme un enjeu central.
Cette déclaration s’inscrit dans la droite ligne de l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, lancée fin 2024 dans le cadre du G20 par le Brésil, qui a fait du droit à l’alimentation une priorité politique.
« En liant protection sociale, résilience des petits producteurs et finance pour le climat, cette déclaration remplit des manques criants dans l’action climatique, souligne Ismahane Elouafi, directrice exécutive du Partenariat mondial de recherche agricole. Mais le succès de cette déclaration dépendra de la capacité à transformer ces engagements en actions concrètes. » Le secteur agricole, qui pèse pour près d’un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ne perçoit toujours qu’une part très marginale de la finance pour le climat.
« Cette déclaration porte un discours fort sur la participation sociale et la transition juste. C’est ce que l’on attendait du Brésil, se félicite Marie Cosquer, analyste à l’organisation non gouvernementale (ONG) Action contre la faim. Les précédentes déclarations sur la faim étaient plus désincarnées, alors que ce texte plaide pour donner du pouvoir aux paysans, les plaçant au centre du jeu. C’est nouveau dans les enceintes sur le climat. »
Doublement de la production d’agrocarburants
Mais plusieurs spécialistes s’inquiètent d’un autre engagement porté par le Brésil, conjointement avec l’Inde, le Japon et l’Italie. Lui aussi présenté vendredi à Belem, et endossé par une vingtaine d’Etats, il vise à quadrupler au niveau mondial, d’ici à 2035, la production de carburants dits « durables », incluant l’hydrogène, le biogaz, les carburants de synthèse et les biocarburants. De nombreux travaux ont pourtant montré que ces derniers, incluant les bioéthanols et les biodiesels, augmentent la pression sur les terres, renforçant la destruction de milieux naturels et entrant en concurrence avec les cultures pour la production alimentaire. Or, avec une population mondiale qui doit croître jusqu’à près de 10 milliards d’individus, d’ici à 2050, la compétition pour l’usage des terres va se faire de plus en plus criante.
L’engagement pris à Belem vise à développer les alternatives aux énergies fossiles, dont la sortie est une priorité de l’action climatique, et s’appuie sur un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Selon le scénario de l’AIE, l’objectif de quadruplement des carburants durables passerait notamment par un doublement de la production d’agrocarburants.
« Si les Etats ont raison de sortir des énergies fossiles, ils doivent s’assurer que leurs plans n’entraînent pas des effets collatéraux, comme plus de déforestation, avertit Janet Ranganathan, directrice générale du World Resources Institute. Le doublement de la production d’agrocarburants aura des effets considérables sur l’usage des terres mondiales. »
Mais là où l’AIE précise que d’importants garde-fous doivent être pris sur le type de terres consacrées à ces agrocarburants et sur la biomasse utilisée, l’engagement de Belem reste flou. « Le texte indique simplement que ces carburants doivent être socialement et environnementalement responsables, sans précision, s’inquiète Marie Cosquer. Et même si l’on met des garde-fous environnementaux, c’est une manière de pousser pour des exploitations agricoles plus grandes, ce qui va à rebours de la déclaration sur la faim et la pauvreté. »
Deux visages du Brésil
Ces deux engagements, sur la faim et la pauvreté et sur les carburants, illustrent les deux visages du Brésil : depuis le retour de Luiz Inacio Lula da Silva à la présidence, début 2023, le pays mène une politique sociale active pour soutenir les ménages les plus modestes et les petits paysans, qui produisent les deux tiers de l’alimentation consommée dans le pays. En juillet, le Brésil est officiellement sorti de la carte mondiale de la faim.
Mais le pays est aussi un géant de l’agronégoce, le premier exportateur mondial de bœuf et le premier utilisateur de pesticides au monde. Une étude de l’association Changing Markets Foundation, publiée le 5 novembre, documente l’entrisme des géants de l’agro-industrie dans l’agenda de la COP30. A Belem, l’AgriZone sera la vitrine de ces industriels, qui y présenteront leurs solutions technologiques et plaideront pour « l’exceptionnalisme agricole » afin d’éviter des régulations trop contraignantes.
Ce gigantesque pavillon organisé par l’Embrapa, l’institut de recherche agronomique brésilien, est notamment sponsorisé par Bayer et Nestlé. Bien que situé à deux kilomètres de l’enceinte où se déroulent les négociations politiques, le risque de perméabilité est fort. L’ONG cite un exemple préoccupant : malgré ses ambitions, le plan climat du Brésil ne se fixe pas d’objectif de réduction du méthane agricole, bien que les trois quarts des émissions de ce puissant gaz à effet de serre proviennent de l’agriculture, particulièrement de l’élevage.
[Source: Le Monde]