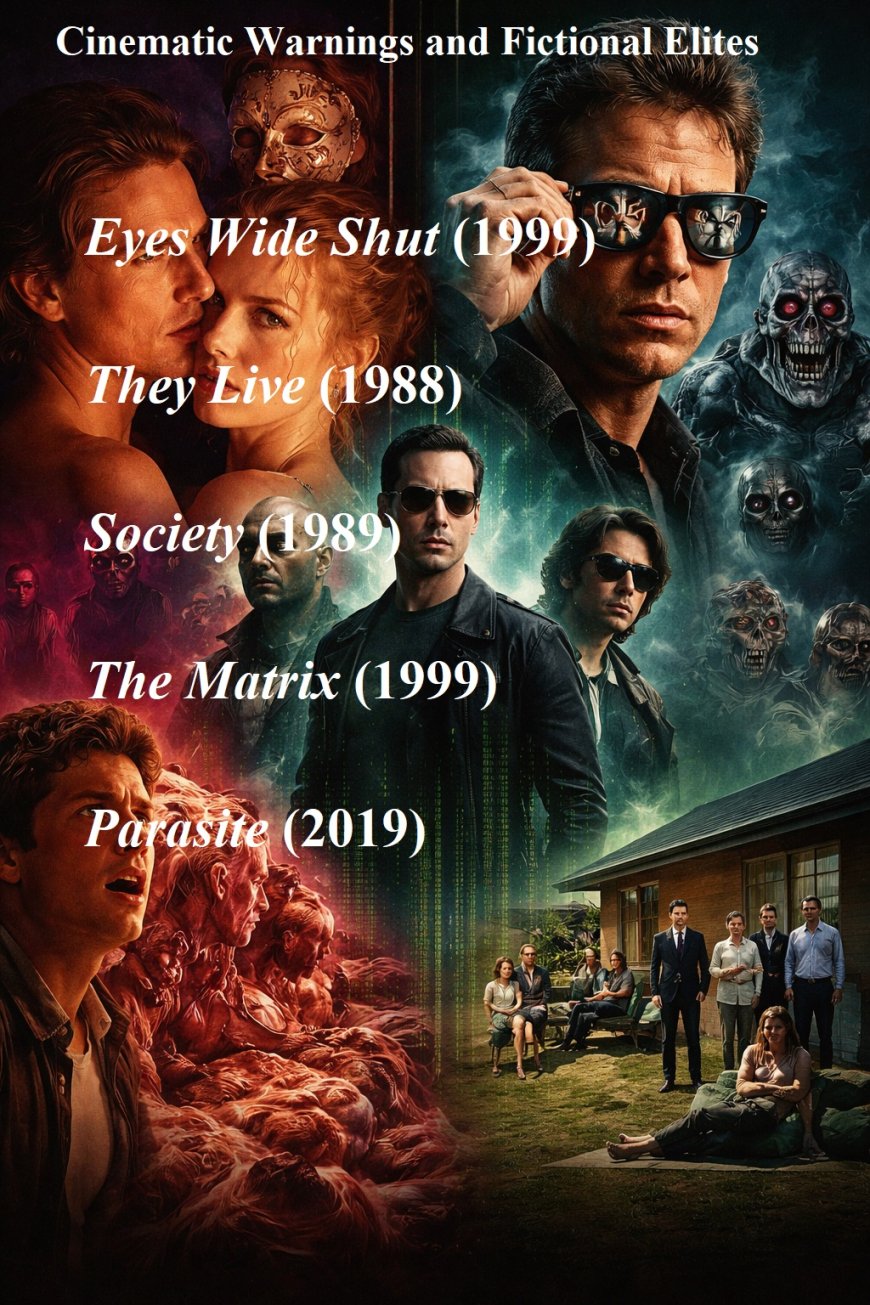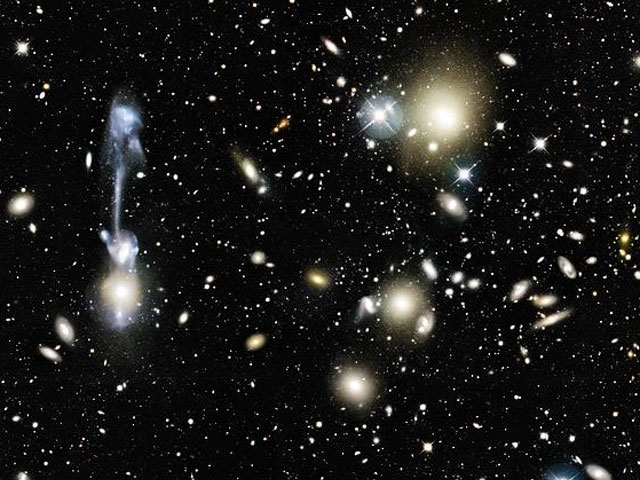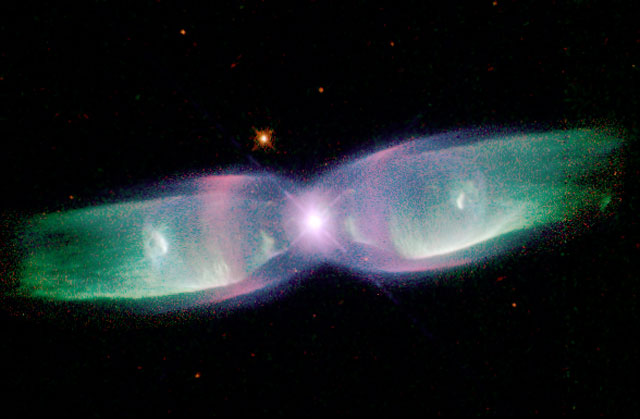Qui se cache derrière les arnaques sentimentales qui se multiplient en France ?
Des milliers de Français tombent chaque année dans le piège de ces escroqueries, orchestrées dans de gigantesques centres à l’étranger. Les arnaqueurs, souvent contraints, utilisent des technologies sophistiquées, ce qui rend leur arrestation presque impossible.

Tomber amoureux au point de vider son compte bancaire : c’est le mécanisme bien rodé des escroqueries sentimentales (ou « romance scams ») dont sont victimes des milliers de Français chaque année. Cartes cadeaux, virements bancaires et cryptomonnaies sont prisés par les « brouteurs », ces fraudeurs qui amadouent leurs cibles à distance, avant de les dépouiller.
Si l’Afrique de l’Ouest demeure un foyer majeur en raison de son importante population francophone, le regard des autorités se tourne désormais vers l’Asie du Sud-Est. Depuis la pandémie de Covid-19, des complexes géants s’y sont installés, exploitant des centaines de milliers de travailleurs d’une cinquantaine de nationalités pour industrialiser les romance scams. Leur spécialité : le « pig butchering » (littéralement « arnaque à l’abattage du cochon »), qui consiste à privilégier l’exploitation des victimes à long terme, généralement par le biais d’investissements fictifs, plutôt que de multiplier les petites arnaques.
Entre janvier 2020 et février 2024, ces réseaux criminels asiatiques ont extorqué 75 milliards de dollars (65 milliards d’euros) à leurs victimes à travers le monde, selon une étude de l’université du Texas. Mais comment ces usines à fraudes fonctionnent-elles ? Pourquoi restent-elles si difficiles à démanteler, alors que leur localisation est connue de tous ? Décryptage.
Des milliers de victimes françaises
Catherine (pseudonyme) était persuadée d’avoir rencontré l’homme de sa vie : un soldat ukrainien, représentant une occasion rêvée de se rapprocher de ce pays. Au début de 2024, leur premier contact sur le réseau social X se transforme rapidement en relation amoureuse et aboutit à un mariage civil à distance, sept mois plus tard. Pourtant, pendant près de deux ans, jusqu’au 6 octobre 2025, la Parisienne de 44 ans conversait en réalité avec un brouteur établi loin des tranchées ukrainiennes, au Nigeria.
Au fil des mois, elle lui envoie plus de 17 000 euros en cryptomonnaies, cédant aux urgences de « sécurité » qu’il invente : achat d’un gilet pare-balles, ravitaillement bloqué, puis une prétendue septicémie nécessitant une opération. Le contrat de mariage aussi était faux et lui aura coûté 450 euros. « J’ai eu des moments de doute, mais ce sont les appels vidéo qui m’ont fait rester », confie la travailleuse handicapée, qui gagne 1 500 euros par mois et s’est endettée pour l’aider. En réalité, le brouteur utilise des photos d’un mercenaire biélorusse pour générer, grâce à des outils d’intelligence artificielle (IA), des vidéos d’un réalisme saisissant.
En France, les victimes d’escroqueries sentimentales se comptent « au moins par milliers », estime Matthieu Rousseau, chef d’escadron du commandement du ministère de l’intérieur dans le cyberespace (COMCYBER-MI), bien qu’aucune étude ne permette de fournir de chiffres précis. L’unité nationale cyber de la gendarmerie nationale (UNCyber) assure au Monde que les cibles de ces arnaques sont surtout des « hommes résidant dans des pays occidentaux, avec de nombreux cas français relevés en 2024 et 2025, par exemple en Bretagne ou en région parisienne ».
Le nombre de romance scams progresse chaque année. Les signalements ont augmenté de 6 % en 2024 par rapport à l’année précédente, d’après le dernier rapport d’activité de la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, paru en mars 2025.
Thierry Baut, administrateur depuis « une dizaine d’années » du groupe Facebook « Assistance aux victimes d’arnaqueurs sentimentaux », reçoit quotidiennement « deux ou trois témoignages » de victimes ou de leurs proches. Passionné d’informatique, il consacre jusqu’à douze heures par jour à traquer les brouteurs et à fournir des preuves concrètes à leurs victimes. C’est lui qui a permis de remonter jusqu’au pays d’origine du soi-disant militaire ukrainien de Catherine.
Une véritable industrie de la manipulation sentimentale
Derrière ces fraudes, il faut imaginer de véritables entreprises criminelles installées dans des sites parfois aussi vastes que trente fois le Louvre, recouverts de bâtiments abritant la même activité : séduire et arnaquer des victimes partout dans le monde. A l’intérieur, des open spaces remplis de bureaux individuels avec ordinateur et téléphone, des « dortoirs à lits superposés », mais aussi des pièces « dévolues à la torture, plongées dans le noir », énumère Kristina Amerhauser, analyste à l’Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale.
En effet, ces écosystèmes clos et autonomes, « souvent camouflés sous la forme de complexes hôteliers ou de casinos », relève l’UNCyber, se concentrent par dizaines au Cambodge, au Laos et en Birmanie, le long de leurs frontières poreuses avec la Thaïlande, la Chine et le Vietnam. Si une partie des escrocs agissent de leur plein gré, ces centres reposent sur un « grand nombre de travailleurs forcés venus du monde entier, victimes de trafic humain », assure Mme Amerhauser.
Souvent attirées par de fausses offres d’emploi dans l’informatique, ces personnes se retrouvent séquestrées – leurs passeport et téléphone étant confisqués –, puis contraintes à rembourser une dette fictive en travaillant à piéger des internautes. Si elles n’atteignent pas les objectifs fixés, elles sont passées à tabac ou torturées par les dirigeants du centre. « Des décès ont été constatés », rapporte l’UNCyber.
Chaque jour, les arnaqueurs travaillent de 15 heures à 6 heures du matin, s’alignant sur les heures d’ensoleillement des pays occidentaux, où vivent la majeure partie de leurs cibles.
Ce n’est jamais un seul escroc qui parle à une victime, mais une équipe qui se relaie : l’un amorce le contact, un autre prend la conversation, d’autres gèrent les transferts d’argent ou les rendez-vous vidéo grâce à sa maîtrise de l’IA. Tout est guidé par des scripts avec les sujets à aborder et les émotions qu’il faut déclencher chez la victime : la confiance, l’inquiétude, l’empathie… « Ce qui fait peur, c’est que les réseaux africains s’inspirent désormais des modèles asiatiques pour développer leurs arnaques », note Mme Amerhauser.
Une riposte internationale limitée
Face à cette industrie criminelle transnationale, la riposte reste balbutiante. Les centres d’escroquerie prospèrent dans des zones frontalières où l’Etat n’exerce qu’un contrôle limité : en Birmanie, plongée dans la guerre civile depuis 2021, des groupes armés liés au crime organisé dominent certaines régions qui échappent à l’autorité de la junte militaire au pouvoir. Les usines à fraudes sont « principalement dirigées par des groupes criminels sinophones », affirme Mme Amerhauser. Elles utilisent des infrastructures Internet autonomes, comme des antennes Starlink (réseau satellitaire de SpaceX), pour fonctionner dans des zones hors de tout contrôle.
Les autorités françaises, qui disposent de « peu d’informations », peinent à agir. « On a des enquêtes qui n’aboutissent pas, car il est impossible d’aller chercher le suspect », regrette Matthieu Rousseau. La coopération internationale est entravée par l’instabilité politique et la complicité de certaines autorités locales. Le gouvernement cambodgien, par exemple, a été accusé, dans un rapport d’Amnesty International publié en juin, de fermer délibérément les yeux sur « l’esclavage, la traite des êtres humains, le travail des enfants et la torture » perpétrés dans plus de cinquante centres à travers le pays.

Toutefois, certains Etats de la région ont réagi. Au cours des derniers mois, la Thaïlande a libéré plus de 600 personnes en octobre dans un raid près de sa frontière avec la Birmanie, l’Inde a rapatrié 300 de ses ressortissants exploités dans la région, Singapour a saisi des millions d’euros issus de ces escroqueries et la Chine a condamné à mort cinq membres d’un gang d’arnaques en ligne. SpaceX, de son côté, a annoncé avoir désactivé 2 500 récepteurs Starlink dans les centres birmans de cyberfraude. Malgré ces interventions, « les opérateurs s’adaptent, se déplacent et continuent leurs activités », ralentissant considérablement la lutte internationale, conclut Mme Amerhauser.
[Source: Le Monde]