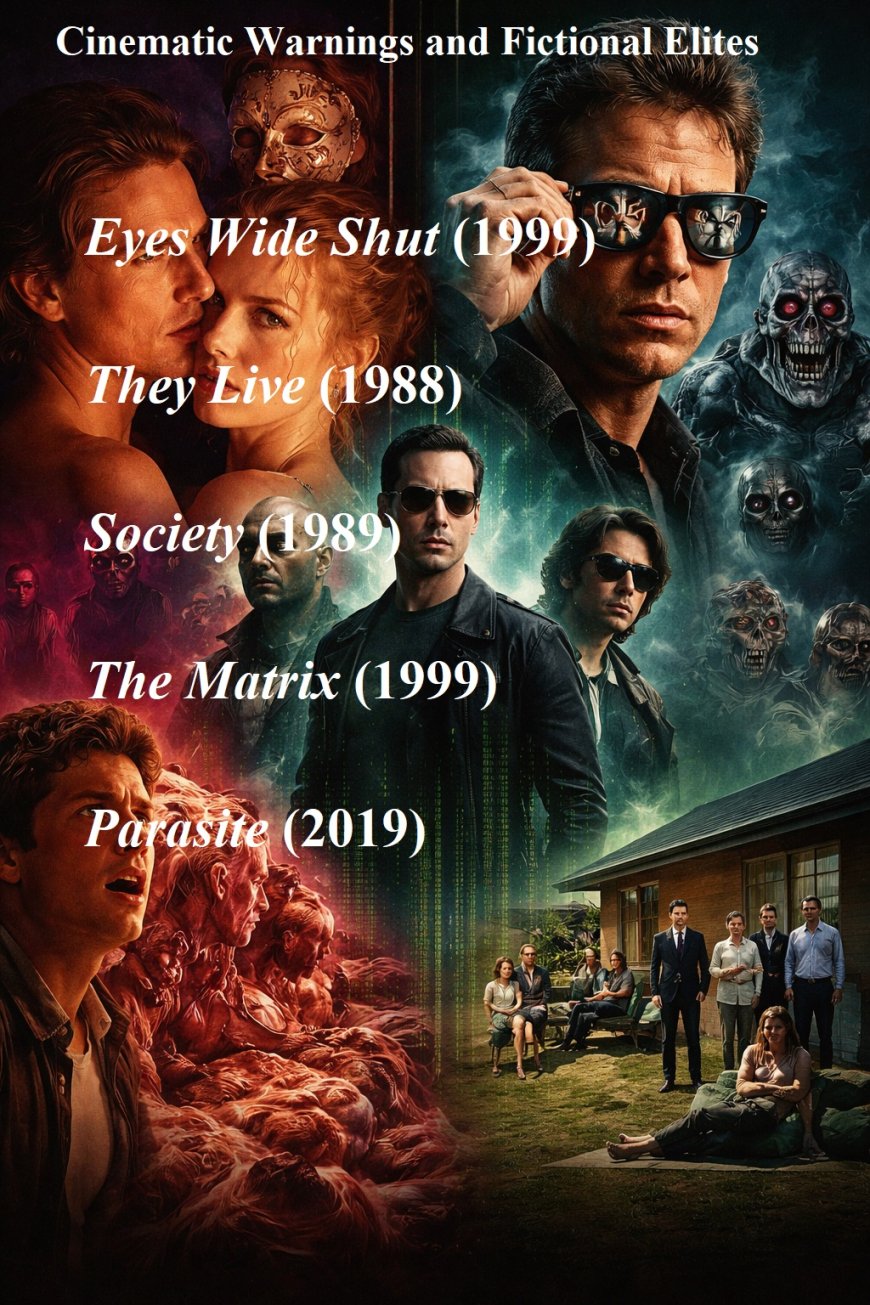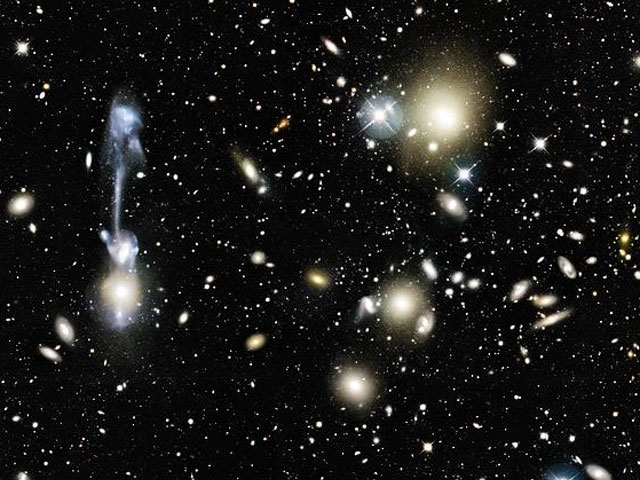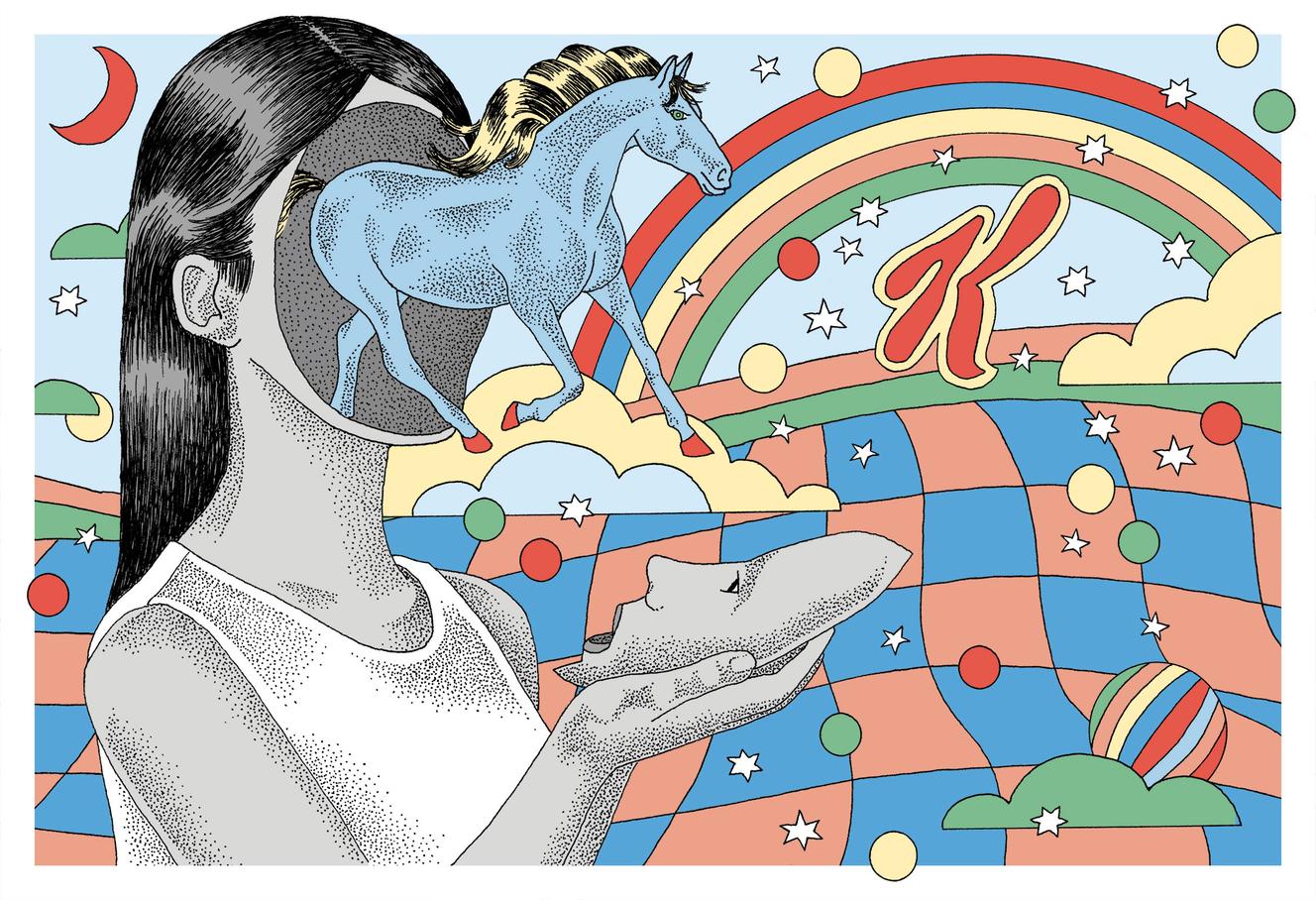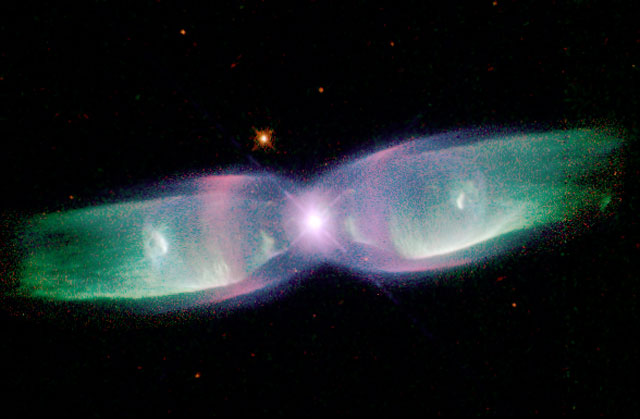Le Sud global aux prises avec l’internationale « gen Z »
Du Népal au Pérou en passant par Madagascar, la révolte de la jeunesse portée par des revendications socio-économiques a désarçonné les Etats. Mais son mode de mobilisation horizontal, issu de la culture numérique, handicape aujourd’hui ses débouchés politiques.

La jeunesse n’a pas attendu la génération Z pour descendre dans la rue. De Mai 68 aux « printemps arabes » de 2011, elle n’a pas cessé de fournir le gros des bataillons des soulèvements populaires et des révoltes.
Alors pourquoi la récente focalisation sur cette fameuse « gen Z » – née entre la fin des années 1990 et le début des années 2010 –, dont les mobilisations en cascade secouent ou ébranlent les pouvoirs depuis 2024, avec un effet accélérateur ces derniers mois ? Du Bangladesh à Madagascar, en passant par le Maroc, le Népal, l’Indonésie, le Kenya ou le Pérou, une sorte d’internationale juvénile est entrée dans l’arène contestataire. Ce surgissement a pris de vitesse les Etats et laissé à l’écart des classes politiques souvent discréditées.
Chaque mobilisation s’inscrit dans un contexte national singulier. Pourtant, bien des similitudes rassemblent ces indignés du Sud global. Au-delà de leur jeunesse, ils brandissent les mêmes mots d’ordre contre la corruption, le népotisme, les inégalités, le chômage, la dégradation des services publics, etc. Leurs doléances sont surtout socio-économiques, ce qui les distingue de leurs aînés dont les aspirations étaient plus expressément politiques (nationalisme, socialisme, démocratie…). Par cette orientation pragmatique, ils ont suscité une sympathie dans la population, allant très au-delà de leur tranche d’âge, les élevant à leur insu au rang de gardiens de l’intérêt général – voire de vigies morales – dans des pays ravagés par le cynisme et la trahison des élites.
Un autre trait commun s’observe dans leur mode de mobilisation. Ces primo-manifestants sont d’ores et déjà des vétérans des réseaux sociaux. Ils sont nés et ont grandi avec la culture digitale, dont ils partagent les codes, le langage, l’esthétique – jusqu’au drapeau du manga One Piece (un crâne hilare coiffé d’un chapeau de paille), devenu l’emblème de cette « gen Z ». Cette praxis du numérique a favorisé la contagion par-delà les frontières, dans une sorte d’émulation universelle du défi à l’ordre injuste. Elle a aussi, et surtout, permis un anonymat dans les anfractuosités de plateformes comme Discord, où les mots d’ordre ont mûri au nez et à la barbe des services de renseignement.
Le flux, l’état liquide : la génération Z ruse à merveille avec les outils coercitifs des Etats. Déjà, les manifestations prodémocratiques de Hongkong, en 2019, avaient théorisé l’esquive : « Be water » (« Soyez de l’eau »). « [Les militants de la génération Z] ont compris qu’il fallait opérer de façon décentralisée pour éviter la répression : cela donne des mouvements sans figure, sans leader », souligne Payal Arora, anthropologue, professeure d’intelligence artificielle inclusive à l’université d’Utrecht (Pays-Bas). A l’heure où se multiplient les flashmobs (« foule éclair ») susceptibles d’allumer la mèche d’incendies plus vastes, certains Etats préfèrent fermer les réseaux sociaux. Le gouvernement du Népal avait ainsi décidé, fin août, de bloquer vingt-six plateformes (Discord, Facebook, YouTube, LinkedIn, X, Instagram…) avec pour seul résultat d’enflammer davantage les esprits.
Cet « horizontalisme aqueux » est le grand atout de la « gen Z » dans sa séquence protestataire. Mais il devient sa principale faiblesse dans la phase suivante, celle du débouché politique. Comment un mouvement privé de leadership et allergique aux logiques verticales peut-il imposer son programme ?
Le handicap avait été fatal au Hirak (« mouvement ») algérien qui, à force de s’empêcher toute représentation, s’était trouvé désarmé lors du retour de bâton répressif du régime à partir de 2020. Au Maroc, où l’institution monarchique continue d’être respectée, la contestation s’est étiolée dès l’instant où le roi Mohammed VI a comme sifflé la fin de la récréation. Il lui aura suffi d’évoquer, dans un discours, la nécessité de « justice sociale ». Les turbulences de l’automne l’auront paradoxalement conforté dans son rôle d’arbitre ultime.

Et quand bien même la colère s’emballe, attisée par la répression, jusqu’à renverser le clan au pouvoir comme au Népal et à Madagascar – ou au Sri Lanka, en 2022, et au Bangladesh, en 2024 –, les protestataires doivent ensuite sous-traiter à d’autres acteurs la transition qui s’annonce. Trop jeunes et inexpérimentés, ils n’ont pas les moyens d’assumer la gouvernance. Discord est une plateforme d’agitation, pas une école d’administration.
Aussi doivent-ils déléguer à des figures plus conventionnelles – mais « Z-compatibles », en raison de leur profil a priori vertueux – la mission de liquider l’ancien régime honni. Ainsi ont surgi aux responsabilités le Prix Nobel de la paix 2006, Muhammad Yunus, au Bangladesh, l’ancien marxiste Anura Kumara Dissanayake, au Sri Lanka, la magistrate à la réputation d’intégrité Sushila Karki, au Népal, ou le colonel Michaël Randrianirina, à Madagascar, inspirateur du coup de force contre le président Rajoelina, forcé à l’exil.
La prise en charge des idéaux originels par ces nouvelles équipes virera-t-elle au marché de dupes ? Les réseaux des oligarchies apparemment défaites ne vont-ils pas insidieusement se reconstituer ? La « gen Z » reste sur ses gardes et veut surveiller le processus de rénovation, afin d’éviter son dévoiement. Faute de quoi, le drapeau de One Piece pourrait de nouveau claquer dans les agoras.
Népal : Sudan Gurung, le profil intransigeant d’un ancien DJ décidé à « sauver son pays »

Sudan Gurung a surgi au cœur d’un mouvement acéphale, incarnant en quelques heures la révolte d’une génération. A 36 ans, il n’appartient pourtant plus à la « gen Z » népalaise dont il est devenu une figure de proue. Ce n’est pas le moindre paradoxe de la contestation qui, les 8 et 9 septembre, a précipité la chute du gouvernement du premier ministre communiste, Khadga Prasad Sharma Oli. En deux jours d’émeutes d’une rare violence, 73 personnes ont été tuées, 1 300 blessées, et la plupart des institutions – Parlement, Cour suprême, bâtiments de l’exécutif – ont été réduites en cendres. Les dégâts sont estimés à environ 18,2 milliards d’euros.
Inconnu jusqu’alors, le jeune homme s’est imposé comme chef de file d’un soulèvement largement spontané, né sur les réseaux sociaux. Parti du hashtag #nepokids, le mouvement s’est enflammé après la suspension d’une vingtaine d’applications.
Sudan Gurung a raconté s’être inspiré des manifestations prodémocratiques de 2019 à Hongkong pour contourner l’interdiction de WhatsApp et de Facebook en migrant vers le serveur Discord, et ainsi assurer la coordination numérique de la mobilisation des jeunes. Après la chute du gouvernement Oli, il s’est improvisé médiateur, dialoguant avec le président, le chef des armées et les contestataires.
Ancien DJ aux allures de dandy, portant lunettes noires et vestes occidentales, Sudan Gurung est aussi le fondateur de Hami Nepal, une organisation caritative née après le tremblement de terre qui avait ravagé, en 2015, l’ancien royaume himalayen. Sa devise : « Pour le peuple, par le peuple. » A la suite des émeutes des 8 et 9 septembre, des rumeurs l’ont dépeint en agent d’intérêts étrangers ou encore en activiste pour le Tibet libre. Placé sous surveillance par la police, il dément vigoureusement ces accusations, destinées, selon lui, à le discréditer pour affaiblir le mouvement. « Ils me traitent d’agent de la CIA, de l’Inde, voire de la Thaïlande – c’est leur stratégie pour nous diviser », a-t-il déclaré devant des militants.
Dans un rare entretien, accordé le 27 septembre à Al-Jazira, il a annoncé sa candidature aux élections générales prévues en mars 2026, et n’a pas exclu de briguer la fonction de premier ministre, « si les Népalais [le] choisissent ». « Je dois sauver mon pays », a-t-il encore affirmé, vêtu d’un gilet maculé du sang de jeunes tombés sous les balles de la police, le 8 septembre. Son mouvement cherche désormais à mobiliser et à « unifier la “gen Z” » pour bâtir un « courant de changement » plutôt qu’un parti politique traditionnel. « Ils nous ont poussés dans la politique », a-t-il déclaré à propos de l’ancien gouvernement, composé, selon lui, d’hommes politiques « égoïstes » et « corrompus », avant de prévenir que les jeunes n’accepteront pas leur retour.
L’homme est intransigeant. Après avoir soutenu, à travers un vote organisé sur Discord, la nomination de Sushila Karki à la tête du gouvernement intérimaire, et assisté à sa prestation de serment le 12 septembre, il a rapidement réclamé sa démission. Un revirement lié à l’attribution du ministère de l’intérieur à Om Prakash Aryal, qu’il accuse de vouloir s’emparer illégalement du pouvoir. Le 15 septembre, entouré de familles de manifestants tués, il scandait : « Le peuple détient le véritable pouvoir ! », devant la résidence de la première ministre, à Katmandou. Peu après, il a déclaré avoir été victime d’une tentative d’agression.
Soucieuse de maintenir un lien avec la « gen Z », Sushila Karki a nommé Bablu Gupta, 28 ans, au poste de ministre de la jeunesse et des sports. Activiste engagé et figure majeure de la contestation, ce dernier affiche un profil similaire à celui de Sudan Gurung. Après avoir fondé et dirigé le Groupe des 100, une organisation de soutien aux populations défavorisées, il est aujourd’hui le plus jeune ministre de l’histoire du Népal.
Indonésie : Cania Citta, une ambassadrice de la « pensée critique »

Cania Citta, 30 ans, est l’une des figures féminines du Malaka Project, cofondé en 2023 par neuf personnalités du Web en Indonésie. Leur chaîne YouTube, qui rassemble aujourd’hui plus d’un million d’abonnés, s’est donné pour objectif de « former une société intelligente, critique et pleine d’empathie ». Leur projet est un hommage à Tan Malaka, penseur politique et héros de la révolution indonésienne, exécuté en 1949.
Ce collectif s’est mis au service des manifestants d’août 2025, en formalisant, au sein d’une coalition d’organisations civiles et étudiantes, un ensemble des revendications regroupées sous l’appellation « 17 + 8 demandes ». Figurent parmi elles le retrait de l’armée des affaires civiles et la libération des manifestants arrêtés – la plupart n’ont pas été satisfaites.
Cania Citta se consacre aux questions politiques et anime la nouvelle plateforme de diffusion de livres en ligne de Malaka. En janvier, elle y a publié un best-seller, écrit avec Abigail Limuria, intitulé Makanya, Mikir ! (« Alors, réfléchissez ! », Pear Press, non traduit).
Rencontrée dans un café de Djakarta où elle a ses habitudes, elle s’inquiète de la consommation instantanée des savoirs à l’ère des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle. « Les jeunes se forgent une opinion après avoir passé quelques secondes sur TikTok, ou en regardant sur YouTube une vidéo censée expliquer la microbiologie en deux minutes, déplore-t-elle. Ce n’est tout simplement pas possible ! » Face à ces dérives, elle prône la « pensée critique » et la « connaissance fondée sur les faits ».
Née dans l’ouest de Java, la jeune femme, qui porte ses cheveux mi-longs sans hidjab, est diplômée de sciences politiques de l’université d’Indonésie à Djakarta, l’une des plus prestigieuses du pays. Elle a travaillé comme experte au Parlement, puis rejoint un média en ligne, avant de s’épanouir en tant que créatrice de contenus indépendante.
A la suite des manifestations du mois d’août, le commandant des opérations cyber de l’armée indonésienne avait annoncé, le 8 septembre, envisager des poursuites contre Ferry Irwandi, l’un des animateurs phares du Malaka Project,pour diffamation. Mal lui en a pris. « En Indonésie, une institution comme l’armée ne peut pas porter plainte pour diffamation, explique Cania Citta. Nous l’avons expliqué sur Malaka et sur nos réseaux sociaux. La police l’a confirmé et l’armée a subi le contrecoup : beaucoup de gens ont alors considéré que nos droits civils et le système démocratique lui-même étaient menacés par l’armée. »
En Indonésie, Internet est devenu un champ de bataille où pullulent les buzzers, ces trolls rémunérés par des politiciens ou des hommes d’affaires, souvent des étudiants en quête de revenus supplémentaires. Un « phénomène [qui] tend à nuire à la démocratie, en créant un environnement politique manipulé par les intérêts des riches et des puissants », note l’Institut Iseas-Yusof Ishak de Singapour dans une étude parue en septembre 2024.
Un autre animateur de Malaka, Jerome Polin, a révélé s’être vu offrir 150 millions de roupies (7 800 euros) pour poster, au plus fort des manifestations, une vidéo sur Instagram sur le thème « l’Indonésie veut la paix ».
Madagascar : Yuu, le « frontiste » blessé en première ligne

Yuu saute avec agilité de son scooter au Custom Café, un bar de motards discret du centre-ville d’Antananarivo. Ce lieu avait servi de repaire secret aux manifestants de la génération Z, dont il a été l’un des leaders, durant les trois semaines de contestation, de violences et de répression qui ont précipité la chute du pouvoir à Madagascar, le 14 octobre.
En cette fin d’octobre, l’étudiant en droit de 21 ans n’est pas là pour assister à une réunion clandestine. Pourtant, organiser cette rencontre a été presque aussi difficile qu’au temps où il était traqué par les forces de sécurité.
Depuis que le président Andry Rajoelina a été renversé, remplacé par une structure de transition dirigée par le colonel Michaël Randrianirina, l’incertitude règne. Qui détient réellement le pouvoir, et avec quelles intentions ?
Dans ce climat instable, la « gen Z » reste sur ses gardes, décidée à défendre les idéaux de la « révolution » – notamment une justice sociale difficile à mettre en œuvre. Le pays n’est pas apaisé, alors Yuu continue de vivre sous la protection précaire de son pseudonyme et ne reste jamais longtemps au même endroit.
Il semble encore surpris par la rapidité et la violence des événements. Jusqu’alors, il menait ses études de droit, tout en développant une petite société d’audiovisuel institutionnel pour subvenir à ses besoins. Mais il faisait face à un fléau répandu à Madagascar : un proche du pouvoir cherchait à s’approprier son entreprise, selon une méthode bien rodée. Un redressement fiscal absurde, monté de toutes pièces, puis un intermédiaire proposant un « arrangement » – à condition de lui céder la société.
Pris dans cet engrenage, Yuu découvre un serveur Discord où des étudiants expriment leur colère contre les coupures d’électricité et d’eau, de plus en plus fréquentes. Cette contestation naissante est alimentée par des influenceurs basés à l’étranger, relayant des vidéos montrant l’opulence choquante des enfants de la nomenklatura malgache. Yuu rejoint le groupe « presque par curiosité ». En septembre, un mouvement embryonnaire se forme autour de ce serveur. La plupart des membres ne se sont jamais rencontrés physiquement. Quand le mot d’ordre est donné, le 25 septembre, de descendre dans la rue, Yuu répond présent. Au point de rendez-vous, il se retrouve à crier des slogans au côté de « parfaits inconnus », heureux de partager leurs frustrations.
Mais, très vite, tout bascule. « On voulait présenter nos revendications poliment et gentiment, mais les gendarmes se sont tout de suite déchaînés », raconte-t-il. Sans sommation, les forces de l’ordre font pleuvoir lacrymogènes, coups, grenades et balles en caoutchouc. Une erreur tactique : cette tentative d’écraser le mouvement le radicalise. « C’était le chaos, ça explosait partout, il y avait des blessés, du sang, souligne Yuu. Avec les nouveaux potes, on a pris le lead, par instinct. » Devenus « frontistes », ils sont en première ligne face aux forces antiémeute, qui n’hésitent pas à tirer sur les manifestants à hauteur de la tête. Un jour, une grenade assourdissante explose à ses pieds, et Yuu perd connaissance. Alors qu’il peine à reprendre ses esprits, la charge se poursuit. « Des gens ont ouvert leur porte, nous ont cachés, nous ont sauvé la vie, précise-t-il. On pensait que les Malgaches étaient passifs, mais non, on était unis contre ce pouvoir assassin. » Peu après, Yuu intègre la « team Phenix », une cellule de la « gen Z » chargée d’élaborer les tactiques des manifestations et de contenir les éléments les plus radicaux pour éviter l’escalade de la violence.
Puis le président Rajoelina a pris la fuite, et le pouvoir s’est effondré aussi vite qu’il avait choisi de frapper la jeunesse. Yuu, pourtant, n’est pas soulagé : « Je crois que j’ai un TSPT [trouble de stress post-traumatique]. Dès que je vois de la fumée ou que j’entends un bruit fort, j’ai envie de fuir. Je fais des crises d’anxiété, j’ai des problèmes de mémoire, je ne dors plus. » Il n’est pas le seul. Beaucoup ont eu peur de mourir.
Au début des manifestations, il avait été convié à une réunion secrète de médiation avec les autorités. Il a découvert qu’il avait été photographié. Son portrait avait été ensuite diffusé au sein des unités chargées de traquer les leaders du mouvement. « Ils voulaient notre peau », murmure-t-il. Il avait alors commencé une vie de clandestinité, avec la peur constante de figurer au nombre des morts : vingt-deux en trois semaines, environ un par jour, selon des estimations basses.
Aujourd’hui, Yuu doute : « Parfois je me demande ce que je fais dans la “gen Z”. J’étais là depuis le début, mais[existent] des tensions, des divisions internes que je ne comprends plus. » Puis il reprend : « Pourtant, il faut à tout prix que ce mouvement survive. C’est notre contribution à l’avenir du pays. »
Pérou : Leandro Pacheco, un primo-manifestant accompagné par ses parents

Quand il descend manifester dans les rues de Lima, à la mi-septembre, Leandro Pacheco n’a que 17 ans. La génération Z péruvienne proteste alors contre une réforme du système des retraites. Cette loi, qui imposait une affiliation obligatoire dès 18 ans à un système de pension, a agi comme un « détonateur », explique-t-il, mais « le ras-le-bol va bien au-delà ». La colère ne cesse de grandir face à « l’insécurité et à la corruption » endémiques au Pérou.
La mobilisation de la jeunesse, qui a précipité la chute du gouvernement du Népal, à des milliers de kilomètres de là, est dans toutes les têtes : « Cela a été une source d’inspiration, confie Leandro. J’ai compris que l’indignation pouvait se transformer en une force positive et que, unis, nous pourrions obtenir de grandes choses. »
Avant cela, cet étudiant en psychologie à la prestigieuse université Cayetano-Heredia, à Lima, n’avait pas une grande expérience de l’activisme. Calme et réservé, portant lunettes rectangulaires et vêtements noirs, il n’avait manifesté qu’occasionnellement, notamment lors de la Journée des droits des femmes, le 8 mars. Il est devenu en quelques semaines l’une des figures emblématiques de la « gen Z » péruvienne et coordonne le collectif Jovenes Lideres por el Peru (« Jeunes leaders pour le Pérou »).
« Je manifeste pour que, dans notre pays, les gens puissent vivre dignement », résume Leandro Pacheco. La crise de l’insécurité affecte chaque aspect du quotidien : explosion du nombre d’homicides, recrudescence des actes de délinquance, mais aussi précarité du monde du travail, des études et faiblesse des institutions, alimentent un climat de grande défiance.
Ses parents comprennent son engagement, mais sa mère, femme au foyer, s’inquiète pour lui. Alors elle l’accompagne dans les cortèges. Le jeune homme participe aux marches contre l’insécurité, aux côtés des chauffeurs de bus particulièrement ciblés par les extorsions. Lors de la grande mobilisation du 15 octobre, Eduardo Ruiz « Trvko » rappeur de 32 ans, est tué par un policier en civil et des dizaines de jeunes sont blessés.
Depuis, le mouvement marque une pause. « On se réorganise », dit Leandro. La destitution de la présidente, Dina Boluarte, remplacée par le très contesté José Jeri, n’a pas changé le mot d’ordre : « Qu’ils s’en aillent tous ! » « Nous n’avons pas d’affiliation partisane, mais nous ne sommes pas non plus apolitiques », précise Leandro Pacheco. Lui se revendique de centre gauche, progressiste et surtout « antifujimoriste » – une référence au parti de Keiko Fujimori et de son père, Alberto Fujimori, mort en 2024, qui a gouverné le pays de manière autocratique entre 1990 et 2000.
La « gen Z » péruvienne dénonce le « pacte mafieux » entre l’exécutif et un Congrès dominé par une majorité de droite et accusé d’avoir adopté des lois procrime, en affaiblissant le pouvoir des procureurs. Elle dénonce les « lois antidémocratiques », notamment celle limitant la liberté d’association ainsi que les « lois antiforestières affectant les populations locales et l’environnement ». Et exige le retrait des lois accordant une amnistie générale aux militaires, policiers et membres des comités d’autodéfense lors du conflit armé péruvien (1980 et 2000).
Leandro Pacheco entend maintenir la pression en vue des élections générales, prévues le 12 avril 2026. « Il ne faut surtout pas perdre l’envie de lutter pour un avenir meilleur dans ce pays », proclame-t-il. La prochaine étape sera la grève générale, annoncée pour le 14 novembre, à laquelle il espère rallier le plus de jeunes possible.
Maroc : Zine Iddine El-Jahd, l’adolescent choqué par les violences policières qui se rêve avocat

Jean troué, tee-shirt Brooklyn, baskets Nike et keffieh palestinien : Zine Iddine El-Jahd, 16 ans, incarne à lui seul une jeunesse marocaine à la fois urbaine et engagée. Mineur, comme 70 % des jeunes révoltés selon le ministère de l’intérieur, le garçon au visage juvénile se définit comme issu de la « classe moyenne ». Elève d’un lycée public du quartier d’Aïn Sebaa, ancien pôle industriel de Casablanca, il vit avec ses parents dans l’arrondissement voisin de Sidi Bernoussi, le plus peuplé de la ville. Son père et sa mère, tenanciers, y louent un café.
Persuadé que « la voix des jeunes est ignorée », il a répondu dès le premier jour à l’appel du collectif GenZ 212 (référence à l’indicatif téléphonique international du Maroc, + 212), à l’origine des mobilisations. Il se souvient très bien de l’ambiance qui régnait en ce 27 septembre. Les rassemblements se voulaient pacifiques, les revendications strictement sociales. Pourtant, raconte-t-il, les forces de l’ordre avaient chargé, procédant à des dizaines d’arrestations « arbitraires » de jeunes manifestants. Un épisode en particulier l’a marqué : des policiers frappant, sous ses yeux, un enfant de 12 ans…
Comme tous les contestataires marocains, l’adolescent réclame de meilleurs services publics d’éducation et de santé – « des besoins élémentaires auxquels la majorité des Marocains n’ont pas droit », dit-il. Il dénonce aussi « l’abandon » dont les jeunes sont victimes. Trop peu de structures sont consacrées aux plus défavorisés. Pour s’émanciper, la génération Z doit se débrouiller presque toute seule, alors que le taux de chômage urbain des 15-24 ans frôle les 50 %.
La voix calme et posée, Zine Iddine évoque les images du Népal qui avaient circulé sur les réseaux sociaux en septembre. « Là-bas, les jeunes sont confrontés aux mêmes problèmes que nous, assure-t-il, les inégalités, la corruption, les défaillances de l’Etat… » Mais la « gen Z » népalaise est parvenue à faire démissionner le premier ministre. Rien de tel au Maroc, où le chef du gouvernement est resté en place. Mohammed VI a refusé la dissolution du Parlement que réclamait la jeunesse. C’était pourtant le seul moyen de faire tomber l’exécutif. « Je ne m’attendais pas à ce qu’il prenne la décision de dissoudre, mais j’espérais des paroles plus fortes de sa part », confie le jeune homme. Il estime toutefois que le roi, qui s’est exprimé devant les parlementaires deux semaines après le début des manifestations, réclamant des ministres « une plus grande célérité », a su apaiser la colère des contestataires.
Les rassemblements ont cessé peu après, au grand soulagement de ses parents : « Mon père, qui avait manifesté pendant le “printemps arabe” de 2011, avait peur pour moi. » Plus de 2 000 personnes ont été arrêtées ; les tribunaux ont ensuite condamné des casseurs à de lourdes peines. Zine Iddine dit ne pas cautionner ces débordements, mais il y voit l’expression de « l’accumulation des frustrations ». Au sud d’Agadir, trois jeunes sont morts, dans la nuit du 1er au 2 octobre, tués par des tirs des forces de l’ordre, alors qu’ils prenaient d’assaut une brigade de gendarmerie, selon les autorités – une version partiellement remise en cause par des proches des victimes. Signe de l’extrême sévérité de la justice, des étudiants ont même été condamnés à de la prison ferme pour avoir manifesté, ou simplement incité à le faire.
Désormais, Zine Iddine rêve de devenir avocat, convaincu qu’« au Maroc, la victoire revient toujours aux plus puissants, même lorsqu’ils sont censés perdre ». Mais il n’est pas amer pour autant. Il se félicite que la « gen Z » marocaine soit parvenue à faire parler d’elle au-delà des frontières de son pays, et même jusqu’aux Nations unies. Mais, regrette-t-il, le collectif a refusé de s’allier à des partis politiques, à des syndicats ou à des associations : « Cela a peut-être été un frein : nous aurions gagné à être mieux encadrés et à nous appuyer sur l’expérience de militants aguerris. »
Trop jeune pour voter aux prochaines législatives, en 2026, il n’attend rien du scrutin. « La majorité gouvernementale ne va pas changer, et ce ne sont pas les Marocains qui décideront. Les élections sont synonymes de clientélisme, d’argent… », déplore-t-il. La « gen Z » marocaine a certes quitté la rue, mais elle n’a pas disparu. Zine Iddine est même convaincu qu’elle pourrait revenir « plus forte » la prochaine fois.
[Source: Le Monde]