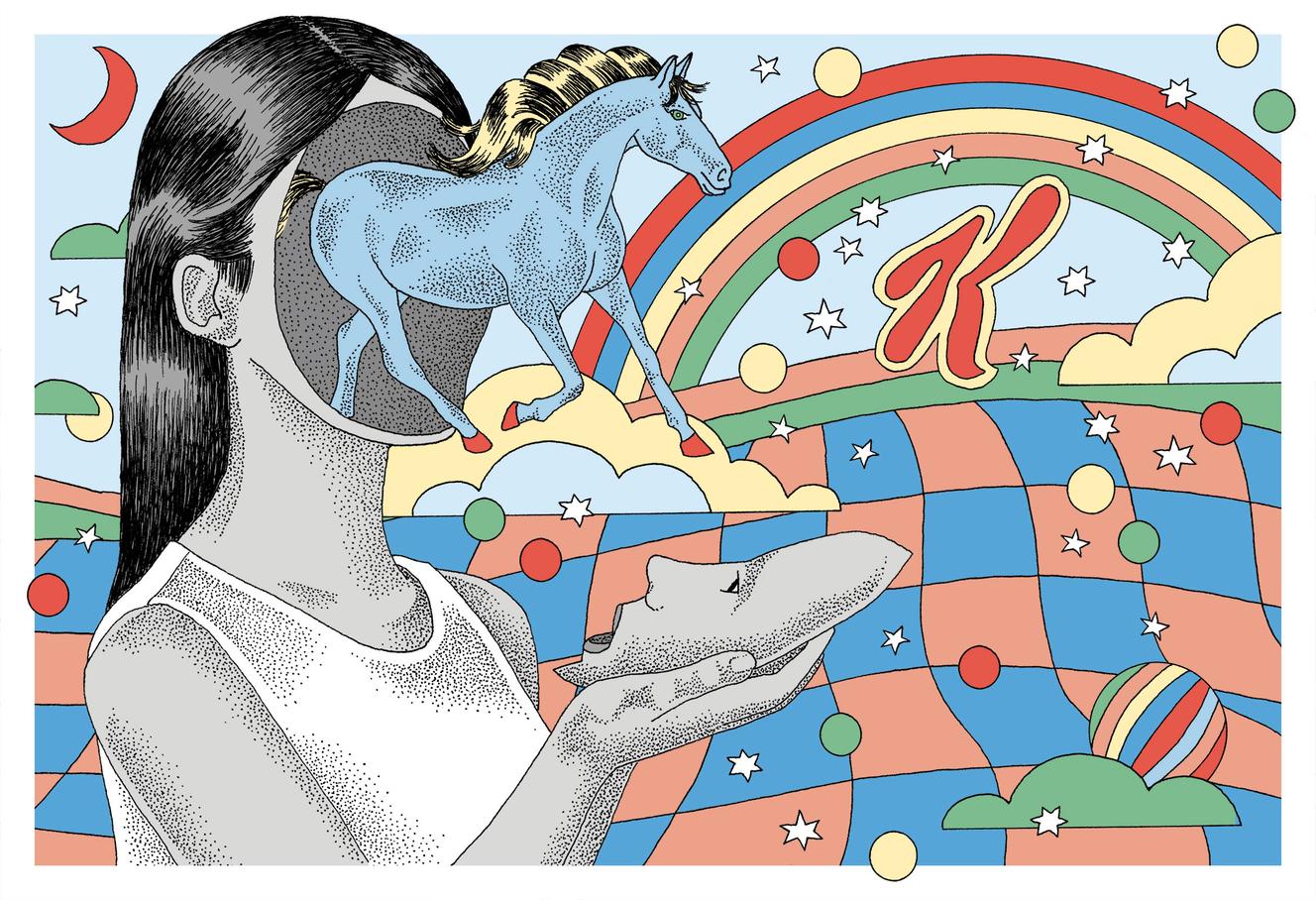Négocier la peur et réévaluer la « conquête » musulmane
Dr. Sirwan Abdulkarim Ali

L'affirmation selon laquelle les musulmans cherchent à « conquérir » les sociétés occidentales est devenue un thème récurrent dans le discours public en Europe et en Amérique du Nord. Si cette idée s'appuie sur des incidents isolés d'extrémisme et de radicalisme idéologique, elle néglige souvent les réalités sociales, politiques et psychologiques des communautés musulmanes en Occident. Il est possible de proposer un cadre négocié et équilibré pour comprendre les relations entre l'Occident et le monde musulman. Un tel cadre devrait permettre d'identifier les risques réels sans attiser la peur. Ce sont les échecs politiques au sein du monde musulman, et non la conquête religieuse, qui expliquent la migration des musulmans vers les pays occidentaux, et la meilleure protection de l'Occident réside dans le maintien de ses droits humains et de ses institutions démocratiques.
Au cours des dernières décennies, l'idée d'une « conquête musulmane de l'Occident » a largement circulé dans la rhétorique politique, les médias populaires et les débats publics. Ce discours implique que les populations musulmanes, par leur croissance démographique, leur migration et leur affirmation culturelle, finiront par transformer les sociétés occidentales en sociétés musulmanes. Ces discours sont puissants sur le plan émotionnel, mais fragiles sur le plan analytique. Ils se nourrissent de la peur mutuelle et de la méfiance historique, tout en négligeant les dynamiques sociales et politiques plus profondes qui motivent la migration et la formation de l'identité. Une approche responsable nécessite une négociation plutôt qu'une escalade, en identifiant les véritables défis, en encourageant l'intégration et en s'attaquant aux faiblesses internes des sociétés musulmanes elles-mêmes. La peur ne peut être gérée par l'exagération, mais par la compréhension.
La plupart des musulmans vivant aujourd'hui dans les pays occidentaux ne sont pas des missionnaires idéologiques ou des agents de conquête. Ce sont des individus qui ont quitté leur pays d'origine en quête de sécurité, de stabilité et de dignité, des ressources souvent indisponibles dans leur pays d'origine. Beaucoup ont fui les guerres, les régimes autoritaires ou la corruption endémique ; d'autres ont émigré à la recherche d'éducation, de travail et de liberté.
Leur migration reflète donc un échec du monde musulman, et non un plan coordonné visant à renverser les sociétés occidentales. Ces personnes sont souvent victimes d'une double aliénation : elles sont éloignées de leur pays d'origine qui les a laissées tomber et elles luttent pour être acceptées dans des sociétés d'accueil qui les regardent avec suspicion. Les présenter comme des envahisseurs revient à méconnaître à la fois leurs souffrances et leurs aspirations.
Il faut qu'on comprenne le fait que la foi musulmane moderne, dans ses nombreux contextes, s'est transformée d'un système purement spirituel en une identité politisée. Des décennies de colonialisme, d'autoritarisme et de répression idéologique ont fait de la religion un instrument politique. Elle apparaît donc souvent moins comme une foi que comme une idéologie, un étendard de résistance plutôt qu'un chemin vers la paix intérieure.
De nombreux musulmans vivant dans les sociétés occidentales se sont occidentalisés sur le plan culturel, façonnés par les valeurs démocratiques et la liberté individuelle. Certains développent même une haine de soi ou une désillusion vis-à-vis de leur propre identité après avoir été témoins de la corruption et de l'hypocrisie dans leur pays d'origine. Beaucoup d'entre eux s'accordent à dire que les groupes politiques musulmans en Occident devraient être surveillés, car ils abusent souvent de la religion pour obtenir le pouvoir. La crainte que les musulmans puissent « conquérir » l'Occident sous-estime la résilience et la complexité des institutions occidentales. Les démocraties libérales fonctionnent grâce à des systèmes hiérarchisés de droit, de gouvernance, de responsabilité et de culture civique qui ne peuvent être facilement renversés par des changements démographiques.
Les sociétés occidentales ont déjà réussi à absorber des vagues d'immigration : irlandaise, juive, italienne, asiatique ; chacune d'entre elles était initialement perçue comme une menace, mais a finalement été intégrée dans le tissu social. La culture systématique de l'Occident est trop structurée pour être démantelée par l'idéologie. Lorsqu'un groupe tente de violer ses principes fondamentaux, la réponse naturelle est la correction institutionnelle, la responsabilité juridique, le débat civique et la résistance sociale. Si certains musulmans tentent de remodeler radicalement les systèmes occidentaux, ils risquent l'exclusion sociale, voire l'expulsion, et non la révolution. Par conséquent, le scénario de la « conquête » est peu plausible lorsqu'on l'examine sous l'angle du réalisme politique.
La véritable crise ne réside pas dans l'immigration musulmane vers l'Occident, mais dans l'échec chronique de la gouvernance dans le monde musulman. De l'Afrique du Nord à l'Asie du Sud, de nombreux pays à majorité musulmane se caractérisent par la faiblesse de leurs institutions, la corruption et un leadership autoritaire. Ces conditions poussent les citoyens à chercher une vie ailleurs. Aucun pays à majorité musulmane n'est aujourd'hui un modèle mondial de justice, de prospérité et de démocratie. Au contraire, des millions de personnes fuient ces pays pour se réfugier dans les nations occidentales qu'ils sont accusés de vouloir conquérir. Cette réalité réfute en soi l'hypothèse d'une prise de pouvoir délibérée. Les intellectuels et les dirigeants politiques musulmans doivent donc rediriger leur énergie vers l'intérieur : construire des États qui reflètent les idéaux éthiques de leur foi. Ces idéaux sont ceux de la justice, de la compassion et de la bonne gouvernance, plutôt que l'exportation de la frustration à l'étranger.
La meilleure protection des sociétés occidentales contre l'extrémisme ou les tensions culturelles ne réside pas dans des politiques fondées sur la peur, mais dans le respect des principes qui font leur force : les droits de l'homme, l'égalité devant la loi, la liberté académique et l'aide humanitaire. Ce sont ces valeurs qui attirent les migrants, musulmans ou non, vers l'Occident. Les compromettre au nom de l'autodéfense reviendrait à s'infliger une blessure. Une société qui abandonne ses propres fondements moraux par crainte d'une menace extérieure perd son identité de l'intérieur.
Les tensions géopolitiques actuelles, telles que la rivalité entre Israël et l'Iran, les conflits sectaires au Moyen-Orient et les guerres par procuration impliquant les puissances mondiales, compliquent encore davantage les relations entre les musulmans et l'Occident. Le monde se trouve aujourd'hui à un carrefour délicat où des guerres locales pourraient déclencher des crises mondiales. La communauté internationale semble hésitante, laissant souvent les conflits évoluer au-delà de tout contrôle. Si cette escalade se poursuit sans contrôle, elle pourrait déclencher des vagues de déplacements, d'extrémisme et de polarisation que ni l'une ni l'autre des parties ne pourra gérer. Le résultat ne serait pas une conquête musulmane de l'Occident, mais un effondrement de la stabilité mondiale.
Il est nécessaire de repenser l'avenir, car il est irréaliste d'imaginer Paris, Londres ou la Californie régis par la charia. Les systèmes constitutionnels occidentaux sont ancrés dans des siècles d'évolution juridique et culturelle ; ils ne peuvent être remplacés par une idéologie importée. Le plus grand risque n'est pas la conquête, mais la radicalisation mutuelle, lorsque la peur en Occident et la colère dans le monde musulman s'alimentent mutuellement, conduisant à des cycles de méfiance et de conflit. La communauté internationale doit intervenir par la diplomatie, l'éducation et des politiques de développement équitables afin d'empêcher que le fossé idéologique ne se transforme en rupture civilisationnelle.
L'objectif général doit être une coexistence responsable ; le discours sur une conquête musulmane de l'Occident est, fondamentalement, un symptôme d'insécurité mutuelle. Les sociétés occidentales craignent de perdre leur identité, tandis que les musulmans sont confrontés à leurs propres échecs en matière de leadership et de légitimité. La voie à suivre ne réside pas dans la confrontation, mais dans l'autocorrection des deux côtés. Ceux qui menacent les valeurs occidentales ne représentent pas la majorité des musulmans. Beaucoup de ces acteurs sont le produit d'États défaillants, manipulés par des intérêts géopolitiques ou motivés par la frustration plutôt que par la foi. L'Occident, quant à lui, doit rester confiant dans ses institutions et ses valeurs. La seule défense efficace contre l'extrémisme, qu'il soit religieux ou laïc, est un engagement ferme en faveur de la justice, de l'égalité et de l'humanité.
L'histoire montre que les civilisations s'effondrent rarement à cause de croyances étrangères, mais parce que leurs propres dirigeants les induisent en erreur et érodent leur force morale. Les sociétés occidentales devraient être plus attentives aux manœuvres et manipulations de leurs politiciens plutôt que d'être guidées par la peur ou des suppositions infondées sur les autres. Ce qui précède plaide en faveur du dialogue, et non de la division ; de la réforme, et non de la rhétorique. Le monde n'est pas prêt pour une nouvelle guerre idéologique.
[Traduit par EDGEnews]