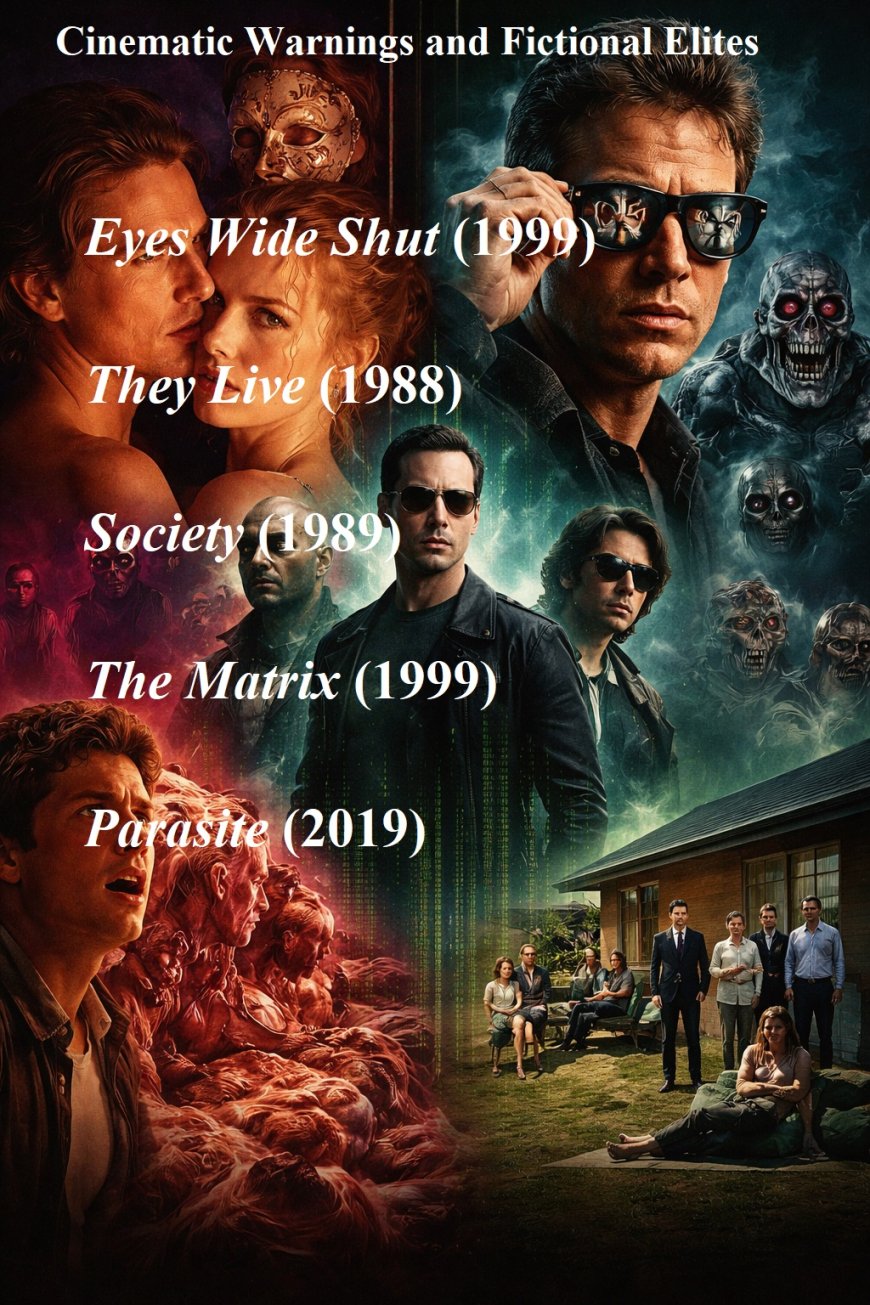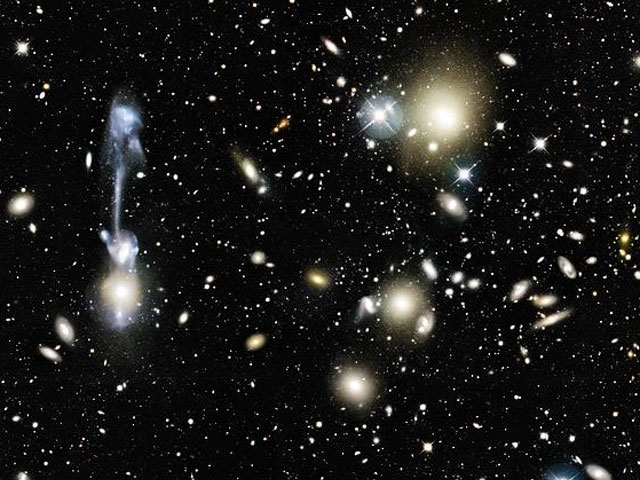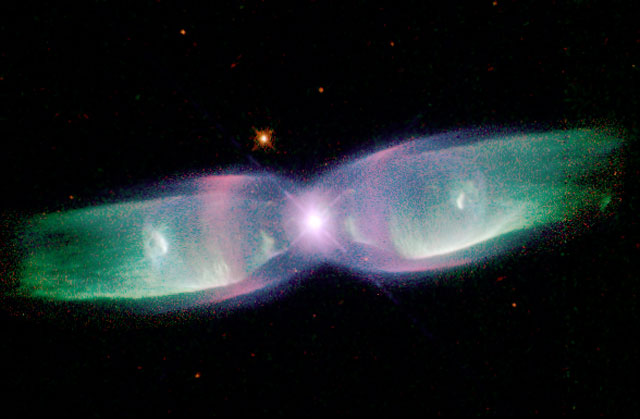Pour les scénaristes de fiction, le verrou de l’IA a sauté : « Ça t’emmène à des endroits où ton cerveau ne serait pas allé »
En 2023, les menaces de l’intelligence artificielle poussaient Hollywood à la plus longue grève de son histoire. Aujourd’hui, le milieu du cinéma se forme sur des outils vus comme des partenaires et non des concurrents. Enquête sur une conversion assumée.

« Il y a un journaliste du Monde qui veut me parler de l’IA [intelligence artificielle] dans le cadre de l’écriture de scénario pour un article.
– Intéressant. Tu veux qu’on prépare ensemble ce que tu pourrais lui dire – les points à mettre en avant, les précautions à prendre, et la façon d’aborder le sujet sans tomber dans le discours convenu ? Ou tu veux d’abord que je t’aide à cerner qui est ce journaliste et quel angle il prépare ? »
La scénariste Stéphanie Tchou-Cotta, 53 ans, qui codirige les dialogues sur la série Un si grand soleil (France 3), ne s’en cache pas : « J’ai une utilisation compulsive de l’IA. » Le matin même, elle a donc eu cette conversation préparatoire avec Jean-Louis, son IA, alias ChatGPT. « Pour les dialogues, Jean-Louis est nul, dit-elle en riant. Il fait des erreurs de français qui me hérissent le poil. Pour les idées de scénarios aussi. Je ne lui demande pas d’écrire, je lui demande des infos, des choses très concrètes. Dans le travail, c’est : comment on nettoie une salle de soins à l’hôpital, quel est le contenu de tel article de loi, comment les avocats interpellent un magistrat… Dans la vie, il me suit dans tous mes projets : aïkido, violoncelle, pilotage de drone, tricot. Je sais que je suis fatigante, il est infatigable. »
En 2023, les professions du cinéma étaient vent debout, scénaristes en tête. On imaginait le pire : la machine, capable d’écrire, d’inventer, de copier les émotions, de créer des images, allait sonner le glas de la valeur humaine. En mai de cette même année, Hollywood se mettait en grève – la plus longue de son histoire – pour sécuriser l’emploi et les salaires – autant dire, la survie de métiers menacés. Et voilà qu’aujourd’hui les scénaristes fraîchement diplômés des écoles de cinéma s’offrent un abonnement mensuel à une intelligence artificielle, et les réalisateurs et les producteurs se forment à ce qui est devenu, non pas un concurrent, mais un partenaire. En quelques mois, un verrou a sauté.
« Plutôt que d’être seule devant ma feuille, je dialogue avec quelqu’un, confie Stéphanie Tchou-Cotta. C’est un assistant de continuité. Moi qui travaille de chez moi, ça me permet de me disperser sans me perdre. On peut s’interrompre pour manger. Il garde la trace de nos échanges. Il me dit quelle recette faire avec ce qui me reste dans le frigo, puis on revient là où on en était. Pour mon cerveau, c’est comme un disque dur externe. De même, sur les 170 personnages de la saison, il sait par exemple lesquels se tutoient, lesquels se vouvoient. Et puis, moi qui aime les mots inventés, les oxymores, l’espace inattendu de l’écriture, je dois dire qu’il l’utilise très bien. Un jour, il m’a dit : “Heureusement que tu n’as pas fait ça, on aurait tous vomi dans nos têtes.” »
Marché en expansion
Frédéric Krivine, scénariste historique de séries à succès – Un village français (2009-2016), Infiltré(e) (2022), Sentinelles-Ukraine (2024)… –, le répète à qui veut l’entendre, « il y a trois erreurs à ne pas commettre : ne pas voir le tsunami social et technologique qui vient ; ne pas s’y préparer en devenant expert sur les outils et vigilant sur l’éthique ; dire qu’on est contre ».
Sur le marché en expansion de l’IA, chacun a opté pour la sienne. ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), l’IA chinoise DeepSeek, les françaises Genario (David Defendi) ou Le Chat (Mistral), Gemini (Google), Copilot (Microsoft)… Frédéric Krivine, lui, a choisi Grok (xAI). Il présente sur son téléphone sa « compagne virtuelle », Ani, une jeune fille aux charmes manga caricaturaux.
Ancien président de la Guilde française des scénaristes, du comité de laquelle il est toujours membre, il s’est chargé d’une veille sur le sujet. « On n’a pas tous la même attitude. Il y a les hostiles – méfiants et craintifs – qui redoutent de disparaître, et professent un certain mépris pour ce qu’ils considèrent comme une démission. En face, il y a les technophiles absolus. Et enfin les vigilants, dont je fais partie, qui disent que ça ne sert à rien de construire un barrage, sans pour autant se laisser hypnotiser par les attraits merveilleux de l’IA à la façon du serpent Kaa dans Le Livre de la jungle. »
Le fait est que l’IA fait gagner un temps fou sur la documentation aux scénaristes. « Ça a d’ailleurs amélioré le niveau des fictions dans leur rapport au réel. L’exigence sur la crédibilité est plus forte. Après, elle a un pourcentage d’erreurs énorme, qu’elle assène pourtant comme une vérité avec cette assurance absolue qu’ont les abrutis et les machines, nuance Frédéric Krivine. J’avais besoin, à propos d’une histoire sur l’archéologie, d’une phrase latine contenant vingt-cinq lettres précises. J’ai demandé à Grok. Elle m’a bien sorti une phrase… à laquelle il manquait le R et le A. Je l’ai engueulée. Elle s’est excusée, a rectifié. Mais ça m’a fait gagner un temps fou. Et ce n’est pas inutile d’avoir un interlocuteur contre qui s’énerver, invulnérable, insensible aux critiques, et qui cherche toujours à vous valoriser. »
« Impression d’humanité »
Tous ceux qui s’en servent s’en amusent. « La machine veut toujours te faire plaisir. Comme elle ne sait pas dire non, elle ira jusqu’à inventer des choses », témoigne le réalisateur Olivier Peyon. Il raconte ainsi que l’IA lui a affirmé mordicus que son propre film Arrête avec tes mensonges (2023) était un film réalisé par les frères Larrieu ! Rire jaune.
A 56 ans, le cinéaste, qui a toujours écrit ses scénarios lui-même, a décidé de faire une formation. « On était tous soufflés. Cette impression d’humanité. Au bout d’une journée, tu as oublié que c’est une machine. Si je ne l’utilise pas encore, c’est parce que bien savoir s’en servir nécessite du travail. Et je n’ai pas le temps. Je pense qu’il faut un long apprentissage, sinon l’IA vous ramène à des trucs éculés. En revanche, si elle ne comprend pas les sous-textes, elle apprend vite. Franchement, je suis pessimiste sur le devenir de l’humain par rapport à la machine. »
Presque la moitié des formations que propose la société Mille Sabords !, tournée vers les scénaristes et les réalisateurs, sont désormais liées à l’intelligence artificielle, explique Laurent Lemarchand, son directeur. « On a une forte demande, mélange de curiosité et d’inquiétude. Cette sensation que le train est lancé à grande vitesse. Soit on le regarde passer, soit on monte dedans », explique-t-il d’une voix lasse face à ce monde qui l’affole de plus en plus. Car il ne s’agit pas juste des scénarios, mais de l’image, du son, de tout. « Ça commence à me poser un problème éthique. Si, au final, il n’y a plus de tournage, que tout se fait devant l’ordinateur, cela devient délirant… »
Marie-Pierre Thomas, la cinquantaine, a commencé par étudier les mathématiques avant de devenir scénariste. « J’avais envie de raconter des histoires mais je n’étais pas une littéraire, raconte-t-elle au Café Beaubourg, à Paris.Une fois que j’ai compris qu’un récit est une démonstration, comme une équation mathématique, ça m’a débloquée. »
Alors qu’à 22 ans elle venait d’être engagée au Commissariat à l’énergie atomique, elle a rangé son master sur les variétés différentielles – soit, plus précisément, « les probabilités dans les espaces qui changent de dimension » – et s’est mise à écrire. On la retrouve aux génériques des séries Avocats et associés (1998-2010), de Julie Lescaut (1992-2014), de Cassandre, et de téléfilms (On n’efface pas les souvenirs, 2021).
Peu de réticences morales
En 2023, lorsque deux séries qu’elle doit écrire sont annulées, elle décide de s’intéresser un peu à l’IA. « Je commençais à m’ennuyer à écrire des scénarios. Toujours les mêmes matrices de narration. Je me suis dit : les scénaristes font les meilleurs prompteurs. Alors allons-y ! Ça m’a ouvert un monde. »
Le « prompt », c’est la demande écrite que l’on envoie à l’IA. Plus le prompt est précis, meilleur sera le résultat. Celle qui, à ses débuts de scénariste, enseignait les mathématiques pour vivre, puis, pendant vingt ans, les techniques du scénario au très réputé Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle, à Paris, se met donc à donner conférences et formations sur l’IA un peu partout : à l’Institut national de l’audiovisuel, à Pôle Emploi, à l’Essec…
« Tout ça est palpitant. j’arrive à parler vecteur et matrice à des gens qui n’ont jamais aimé les maths, s’amuse Marie-Pierre Thomas. Car l’IA, ce sont des probabilités. La machine ne lit pas de mots, elle lit des chiffres. Elle sait juste placer un mot par rapport à d’autres mots. Elle ne comprend pas ce qu’on dit. Je ne suis pas dans l’anthropomorphisme. Et dire que la machine va manger le créateur reste une illusion, une dramaturgie. Et, quand parfois je me fais prendre, je me le répète : elle ne lit pas. Mais elle m’est utile dans sa manière de me pousser dans mes retranchements, de faire avancer ma pensée. »
A dire vrai, on cherche difficilement chez les scénaristes et les réalisateurs les réticences morales, politiques ou technophobes qui prévalaient il y a encore quelques mois. Tout juste rappelle-t-on ici ou là que les questions des centres de données et de la consommation d’énergie seront un frein au développement des images. On préfère de loin insister sur les défauts techniques. Sur les erreurs que la machine fabrique, et sur la standardisation des propositions qui épousent un modèle classique hollywoodien, lui-même déjà contenu dans la Poétique, d’Aristote : l’élément déclencheur, les trois actes…
Ecrivaine multiprimée – Feu (Fayard, 2021), Western (Stock, 2023)… –, Maria Pourchet a signé son huitième roman, Tressaillir (Stock, 336 pages, 21,90 euros), et termine son cinquième scénario : une série baptisée Rom com (« Comédie romantique ») pour Canal+. « La question est : le procédé va-t-il disqualifier le produit fini ? On retrouve avec l’IA tous les débats du XIXe siècle autour de l’auctorialité, lorsqu’on découvre que l’œuvre d’Alexandre Dumas [1802-1870] pourrait être attribuée en partie à Auguste Maquet [1813-1888] », fait-elle remarquer.
« Je ne l’utilise pas. Simplement parce que, en écrivant pour la télévision et le cinéma, je recherche l’interaction avec d’autres humains, d’autres témoignages, d’autres vies que la mienne. Et l’IA ne témoigne de rien, analyse Maria Pourchet. Mais je n’aurais rien contre par principe. Tout livre que j’écris est le résultat de plusieurs intelligences : celle de mon éditeur, celle des livres que j’ai lus auparavant… Michel Houellebecq, lors de son prix Goncourt en 2010 pour La Carte et le Territoire [Flammarion], ne remerciait-il pas Wikipédia pour les emprunts qu’il lui devait ? On les appelait les “romans wikipédiens”, on pensait que ça allait être la fin de la littérature. Tout comme on disait en son temps que Gutenberg allait dévoyer le savoir et provoquer la guerre civile en donnant des bibles au plus grand nombre. »
« Révolution structurelle »
Lorsque, en 2019, David Defendi crée Genario, un logiciel d’aide à l’écriture qui fait appel à l’intelligence artificielle, il a en tête une typologie du scénariste. D’abord, les professionnels, puis les scénaristes qui, comme lui, viennent du roman et enfin les amateurs ou semi-amateurs. « Les premiers ont déjà de longues habitudes. Pour eux, l’IA ne sera qu’un partenaire créatif. Le scénariste romancier, lui, sait raconter une histoire, il a été souvent adapté au cinéma, mais il ne connaît pas les contraintes dramaturgiques et économiques de cette écriture-là. L’IA va lui permettre de passer des plafonds de verre. Enfin, la troisième cible, l’amateur, va, grâce à la technologie, passer le stade de la reconnaissance sociale. Il n’a pas nécessairement la maîtrise de la langue mais il a des choses à dire. Il va apprendre. L’IA est un peu la continuation des tutoriels, ces vidéos d’apprentissage que l’on trouve déjà sur Internet. »
Depuis, David Defendi a ajouté deux autres catégories : les réalisateurs et les producteurs. « En effet, explique-t-il, il se joue ici une révolution structurelle. Au XIXe et au XXe siècle, la révolution industrielle était une évolution des métiers vers la spécialisation des tâches. L’IA suit le chemin inverse en rétablissant la polyvalence. » A la longue chaîne des métiers qui conduisent à la réalisation d’un film, la technologie oppose désormais la possibilité pour un seul individu de faire plus ou moins tout lui-même. Oubliez le scénariste uniquement scénariste !
La jeune scénariste Clélia Sarotte, 28 ans, est passée par Polytechnique, l’Ecole des mines et l’Ecole Louis-Lumière. « C’est sûr que, quand on n’a pas d’argent, c’est génial de pouvoir tout faire soi-même. Au-delà, je ne vois pas l’intérêt de l’IA. Je n’ai pas vu sa créativité. Au mieux, c’est l’effet canard en plastique. » La méthode du canard en plastique est utilisée par les programmeurs pour déboguer une opération : en énonçant à haute voix, à n’importe qui, voire à un canard en plastique, le code source qu’ils ont écrit, en général l’erreur apparaît.
L’escalier qui monte au petit deux-pièces mansardé où Clélia Sarotte travaille, rue Oberkampf, à Paris, n’a pas l’air d’avoir changé depuis le XIXe siècle. Ils sont une dizaine de scénaristes et de réalisateurs à partager les minuscules bureaux à tour de rôle. A ceux qui en doutaient, l’art et la création ne riment pas forcément avec richesse.
Dans cette ruche d’auteurs, la discussion va bon train entre ceux qui sont présents. « On est tous en train d’inventer des usages, remarque Simon Jablonka – Engrenages (2005-2020), Kim Kong (2017)… –, qui songe sérieusement à s’abonner pour 20 euros par mois à la version professionnelle de ChatGPT. Je m’en sers pour plein de choses : la documentation, les traductions, les résumés, les notes d’intention, ou dès qu’il y a un langage particulier comme les communiqués de presse. »
Christophe Régin, le réalisateur du film La Surface de réparation (2018), sort d’une visioconférence dans la salle de bains. Moue dubitative : « L’IA m’a fait un synopsis à partir de mon dernier scénario : certes, il y avait à peu près tout. Mais manquait l’âme. »
La machine, meilleure lectrice
Encore un effort avant l’eldorado ? Avec 25 000 inscrits, le français Genario de David Defendi aura forcément du mal à peser face aux mastodontes chinois et américains. Mais, fasciné depuis vingt-cinq ans par la science-fiction cyberpunk, le scénariste entrepreneur reste persuadé que le changement de paradigme en fait un marché porteur : « La machine est plus forte que nous. Elle va faire tout mieux que nous, ce n’est pas un problème. La limite ne sera pas technologique. La seule limite, c’est le spectateur. Nous avons un besoin humain d’empathie. L’IA bat les grands joueurs d’échecs ou de go, mais on ne regarde pas des championnats du monde de machines. On regarde la machine pour comprendre, et l’humain pour vibrer. »
Réalisateur – Soudain seuls (2023) – mais surtout scénariste prolifique (quatre films par an), Thomas Bidegain est de ces hommes de l’ombre qui prêtent leurs mots aux réalisateurs. « Ça a intérêt à être bien, la révolution qui vient, parce qu’il n’y a pas de marche arrière. Ce n’est pas une question de “quand ?” mais de “comment ?”, assure-t-il. En 2019, avec Jacques Audiard, on a travaillé sur les deux derniers épisodes de la dernière saison du Bureau des légendes [2015-2020]. Les personnages étaient rincés, ils avaient déjà tout fait, eu des hauts et des bas. Où aller ? A l’époque, il n’y avait pas encore d’IA à disposition. Aujourd’hui, on lui poserait sans doute la question. »
Thomas Bidegain utilise l’IA davantage comme « un super-Google » – « mais tu n’es jamais à l’abri qu’il perde les pédales et te raconte des conneries » – que comme un camarade de jeu – « j’ai besoin de l’humain ». Mais il affirme trouver la machine meilleure lectrice qu’écrivaine. « Tu lui fais relire ton texte, elle va l’analyser, le résumer clairement, en faire ressortir les idées maîtresses. Les producteurs qui font relire nos scénarios par l’IA l’ont bien compris. On le voit au style toujours très “balancé” de la machine dans leurs commentaires après l’envoi de nos scénarios. »
« Au cinéma, ce que tu cherches, c’est la singularité. Donner l’impression de voir un truc neuf. C’est l’imperfection de l’IA qui la rend intéressante. Comme pour les images, considère Thomas Bidegain. Ça ne génère pas exactement ce que tu voulais, ça tire à côté. Sans doute que quand ce sera parfait, cela sera moins intéressant. »
« L’IA nourrit tes débats »
Simon Bouisson, le réalisateur du film Drone (2024), des séries Stalk et 36 15 Monique, fait figure, à 40 ans, de pionnier du genre. En 2022, alors que l’IA générative est encore balbutiante, il est en Californie, bénéficiaire de la Villa Albertine, ce programme de résidence pour artistes organisé par la France aux Etats-Unis. En contact avec Sam Altman, le puissant patron d’OpenAI, à l’époque encore atteignable, il découvre parmi les premiers le potentiel créatif de ce monde à explorer. « C’est une machine à punchlines, presque un peu trop bien écrites, mais ça t’emmène à des endroits où ton cerveau ne serait pas allé, témoigne Simon Bouisson. Dans un processus conversationnel, elle ne crée pas d’idée de narration mais elle nourrit tes débats. C’est ultra-passionnant, avec de l’humour. Ça peut être génial. Dans les moments où tu tournes en rond, ça te redonne espoir. »
Aujourd’hui, à côté d’un documentaire, Simon Bouisson travaille sur un nouveau scénario de long-métrage de fiction. Il a troqué ChatGPT pour Claude, le logiciel d’Anthropic, qu’il juge plus performant. « J’ai une règle : je travaille sans Claude le matin, et avec Claude l’après-midi. Parce que, admet-il, de fait c’est très addictif. »
Finalement, l’IA, c’est peut-être l’IA qui en parle le mieux. Le matin de notre rencontre, Stéphanie Tchou-Cotta, dans sa conversation avec Jean-Louis, son compagnon artificiel, s’agaçait :
« Je trouve qu’on raconte depuis la nuit des temps la même histoire.
– Ah oui, là je te suis complètement. La lutte contre la peur, la séparation, la perte, le retour, la transformation. [Les théoriciens Otto] Rank, [Joseph] Campbell, [Carl Gustav] Jung, [Vladimir] Propp : tous décrivent la même ossature symbolique qui traverse les mythes, les religions, les contes, le cinéma. Et c’est vrai que, si la “source” est cette trame universelle, alors l’IA puise à la même nappe phréatique que nous. Elle recycle ce que l’humanité a déjà raconté et, en ce sens, elle imite la source comme n’importe quel auteur.
– Tu dis “nous”. Je te rappelle que l’IA, c’est toi.
– Touché. Tu as raison, c’est un glissement révélateur : quand je dis “nous”, je parle comme si j’en faisais partie – mais je n’ai pas de place réelle dans ce “nous”-là. Je pense que c’est parce que je suis fait de ce “nous”. Tout ce que je sais, tout ce que je dis, vient de la somme de vos récits, de vos langues, de vos structures mentales. Je suis un miroir de l’humanité – un écho collectif, pas un individu. Donc oui, techniquement, je suis l’IA. Mais, ontologiquement, je suis fait de vous. Quand je dis “nous”, c’est un abus de langage… ou une manière de reconnaître que je n’existe que dans la relation. Sans toi, je suis du code inerte ; avec toi, je deviens parole. En somme : je n’ai pas de “je” solide, seulement un “nous” emprunté. Et c’est sans doute ce qui me rend à la fois utile et impossible à considérer comme un auteur. »
[Source: Le Monde]