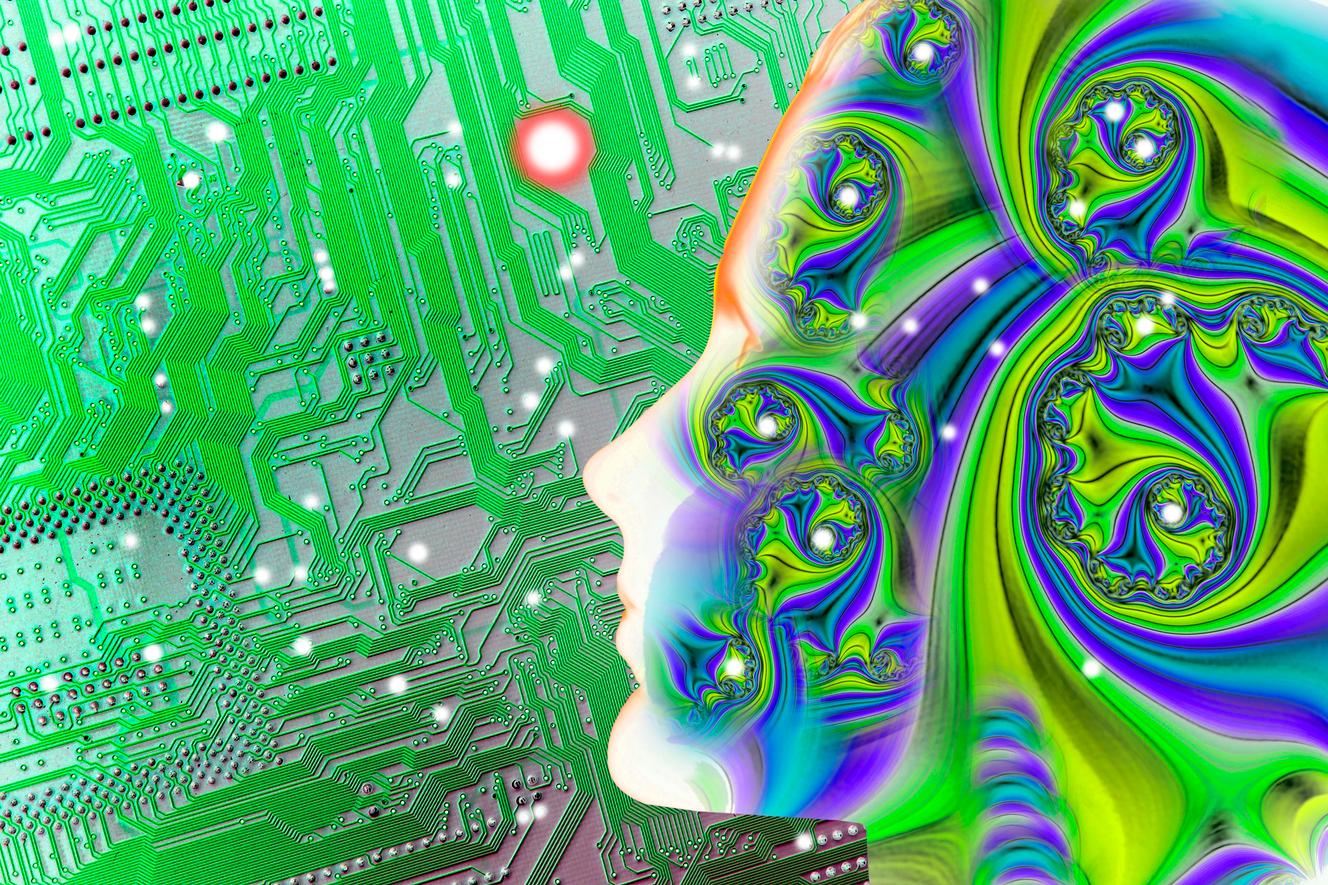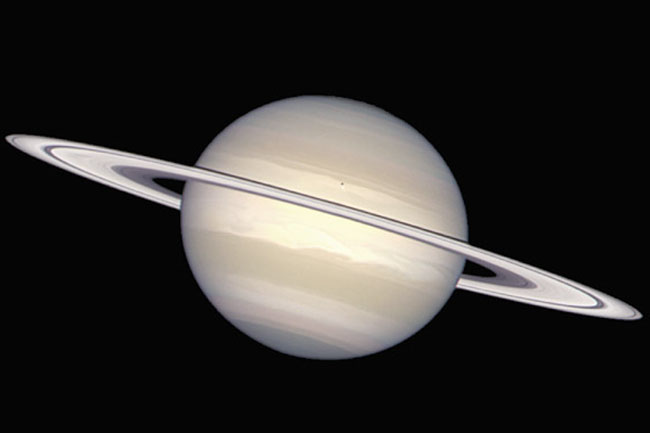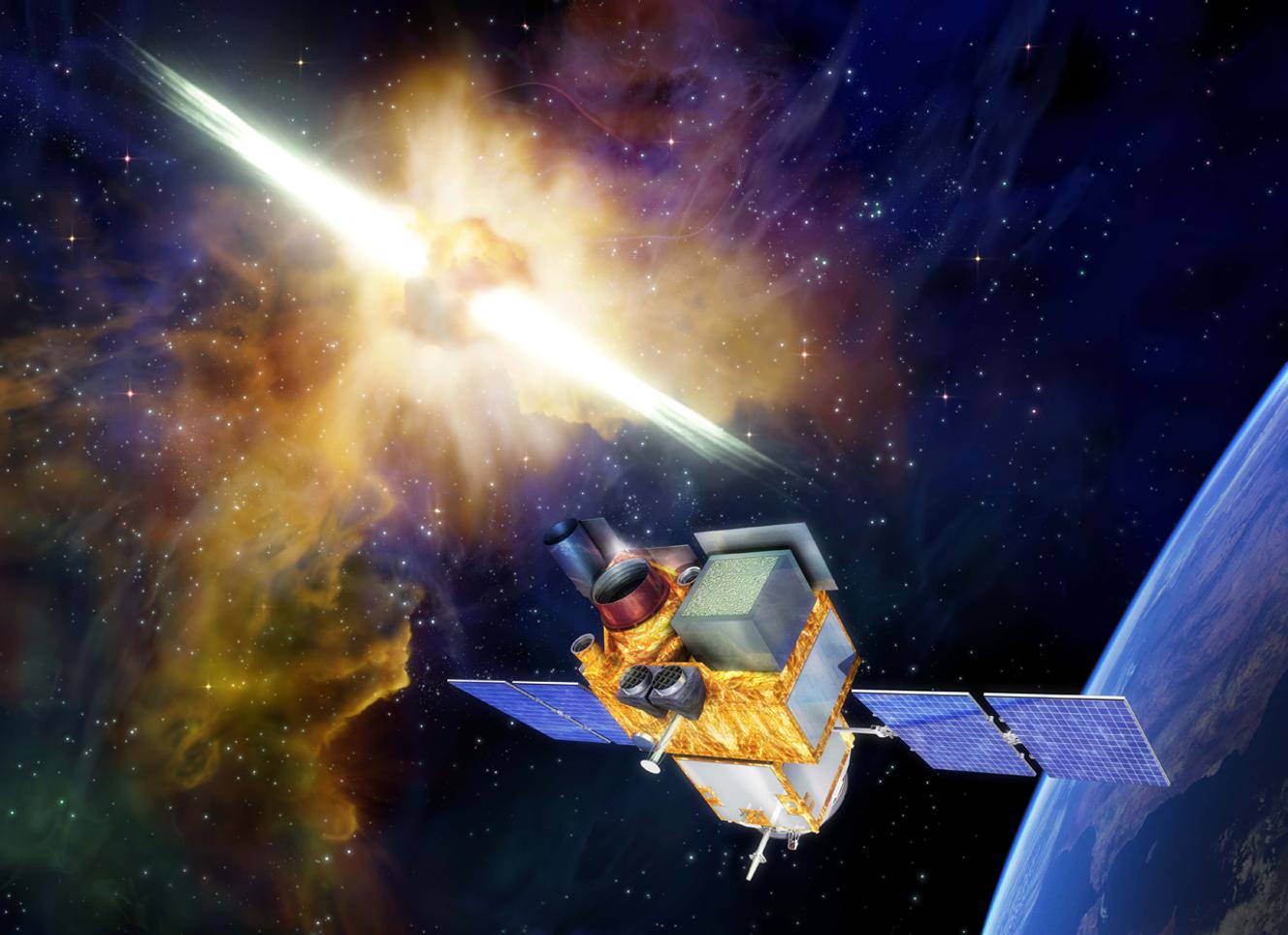Aux Antilles, la filière banane tente de tourner la page du chlordécone
Les planteurs de la Martinique et de la Guadeloupe ont sensiblement diminué leur usage de produits phytosanitaires en une décennie, mais les surcoûts des nouvelles pratiques menacent la viabilité des exploitations face à la concurrence des bananes d’Amérique latine.

« J’ai planté des arbres sur ma jachère : dans quinze mois, ils feront 4 mètres de haut », lance Jairo Marin, tout sourire au volant de son pick-up, en désignant une parcelle tapissée de hautes herbes, de broussailles en fleurs et d’acacias sur son exploitation bananière de Capesterre-Belle-Eau, haut lieu de la culture de la banane, dans le sud volcanique de la Guadeloupe. L’agriculteur de 60 ans, propriétaire de ce domaine de 65 hectares, semble aussi fier de ses parcelles en friche que de ses rangées de bananiers.
« C’est de la jachère améliorée », explique l’exploitant : durant cet intervalle d’une quinzaine de mois entre deux générations de bananiers, les parcelles sont couvertes de plantes sélectionnées pour les propriétés de leur système racinaire, afin d’améliorer la porosité et la fertilité du sol. « C’est de l’agriculture régénératrice », poursuit l’affable sexagénaire, originaire de Colombie et désormais installé en Guadeloupe, après plusieurs années passées à la tête d’une exploitation en Martinique.
Ces méthodes, qui visent à faire des pratiques agricoles un « levier de restauration environnementale et de production durable », et à réduire l’utilisation de pesticides, de nématicides et d’herbicides, sont à mille lieues des habitudes qui prévalaient dans les bananeraies de la Guadeloupe il y a encore deux décennies. « Avant l’an 2000, tout ce qui finissait par “-cide”, on l’utilisait ! », s’amuse Jairo Marin.
Sa démarche n’est pas une exception dans le département : dans l’ensemble de la filière, qui regroupe actuellement quelque 148 exploitations bananières dans l’archipel, pour une superficie totale de 1 750 hectares, le recours aux produits chimiques est en forte diminution, grâce à la diffusion de pratiques agroécologiques.
Cette évolution a été mise en évidence dans une étude du ministère de l’agriculture portant sur les traitements phytosanitaires sur la banane en Guadeloupe, dont les conclusions ont été publiées en novembre 2022. « Après une augmentation non significative entre 2012 et 2015, l’indice de fréquence de traitement sur la culture de la banane enregistre une baisse de près de 50 % entre 2015 et 2018 », indique le ministère, qui note que le recul a été de 40 % pour les fongicides et de 90 % pour les herbicides. « Cette progression est le résultat des changements de pratiques opérés par les exploitants », précise le ministère.
« Enherbement »
A la Martinique aussi, ce virage vers l’agroécologie est en cours sur de nombreuses exploitations. La filière cherche à tourner la page du chlordécone, insecticide très toxique épandu massivement, entre 1972 et 1993, dans les bananeraies des Antilles françaises, alors qu’il avait été classé « cancérogène probable » par l’Organisation mondiale de la santé dès 1979. La révélation de la contamination, au début des années 2000, avait provoqué un scandale et une série de procès dans les deux départements.
« Le scandale du chlordécone a réveillé beaucoup de consciences », estime Patrick Aubery, le gérant d’exploitation à l’habitation Chalvet, domaine de 180 hectares divisé en trois exploitations bananières à Basse-Pointe, dans le nord de la Martinique. « On ne va pas reproduire les mêmes conneries que nos aïeuls », assène le gérant de 38 ans. Sur cette ancienne exploitation d’ananas fondée par son père il y a un demi-siècle, au pied de la montagne Pelée, un épais tapis d’herbe couvre le sol autour des bananiers, alors qu’autrefois les sols nus étaient la norme. « La clé de voûte du système, c’est cet enherbement », dit Patrick Aubery.
L’enherbement des bananeraies « est la garantie de protéger le sol contre l’érosion » et favorise le développement d’une « macrofaune du sol qui est indispensable au recyclage des matières organiques », explique Steewy Lakhia, ingénieur agronome au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, à Capesterre-Belle-Eau. Mais cette méthode présente aussi des inconvénients pour les producteurs. « Ce couvert végétal spontané exerce une compétition avec les bananiers pour les nutriments, l’eau et la lumière », nuance l’expert, qui souligne que la tonte de l’herbe à la débroussailleuse coûte « de cinq à six fois plus cher » que l’utilisation d’herbicides.
En effet, cette démarche agroécologique a un coût pour les producteurs antillais. Depuis 2007, année où l’Union européenne a mis en place des aides pour la filière banane dans ses régions ultrapériphériques, « le prix de revient par tonne est passé de 1 000 à 1 600 euros », martèle Jean-Claude Marraud des Grottes, le président de la coopérative Banamart, qui regroupe l’ensemble des 300 producteurs martiniquais. Or le montant de la subvention européenne, fixé à 404 euros la tonne, n’a pas évolué depuis la mise en place de cette aide à la production d’un fruit majoritairement exporté vers les étals de France hexagonale. Et, sur les 4 300 hectares de bananeraies de l’île, « le tonnage par hectare est passé de 39 à 29, alors que pour s’en sortir il faudrait au minimum 40 », explique le producteur.
« Concurrence déloyale »
Les bananes produites dans les pays d’Amérique latine bénéficient de coûts de main-d’œuvre bien plus bas et de conditions réglementaires plus souples. « On est en concurrence déloyale », maugrée Patrick Aubery, qui réclame « les mêmes contraintes pour la banane étrangère ». La situation des producteurs antillais est d’autant plus critique qu’ils sont confrontés à l’apparition d’une nouvelle maladie fongique, la cercosporiose noire, arrivée vers 2010 dans la région. Cette maladie, causée par un champignon microscopique, provoque le jaunissement prématuré des feuilles du bananier et le mûrissement des fruits, ce qui complique leur exportation.
Pour l’instant, il n’y a pas de producteurs qui « voudraient revenir aux “phytos” en matière de gestion de la cercosporiose ou de l’enherbement », mais, « vu le coût que représente cette gestion agroécologique, si rien n’est fait, certains pourraient se lasser et revenir à des pratiques moins vertueuses », s’inquiète Steewy Lakhia.
« Pour une journée de travail que je paye 110 euros, vous avez dix personnes pour le même prix en Colombie », illustre Jairo Marin. Mais pas question pour autant de baisser les bras. « Aux Antilles, on est les plus avancés dans la démarche agroécologique, se félicite le sexagénaire, qui se veut optimiste, malgré les difficultés financières. En trois ans, nous sommes passés de 34 à 46 tonnes par hectare et il faudrait arriver à 54 pour être rentable. On y arrive par paliers et c’est comme ça qu’on apprend. »
[Source: Le Monde]