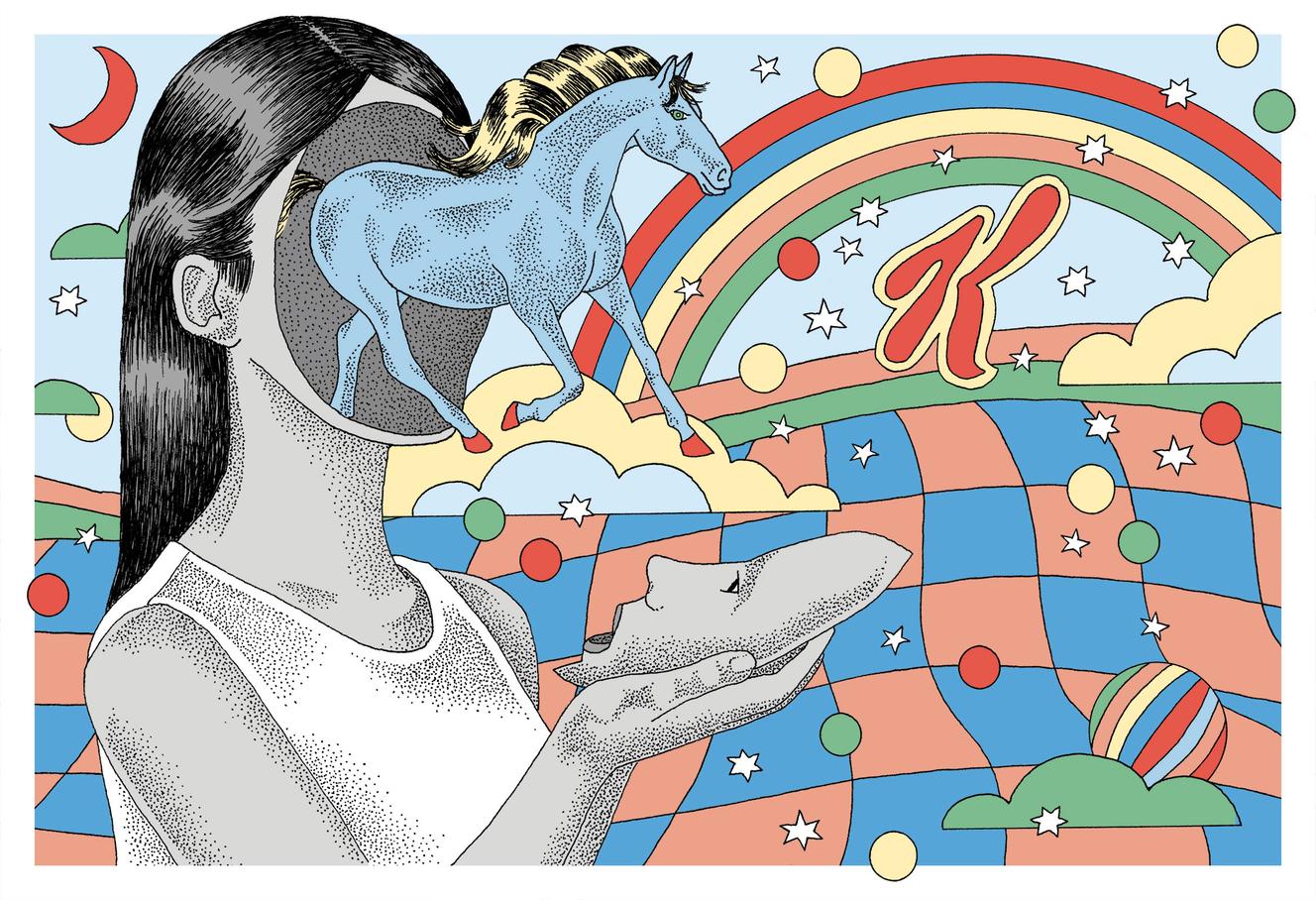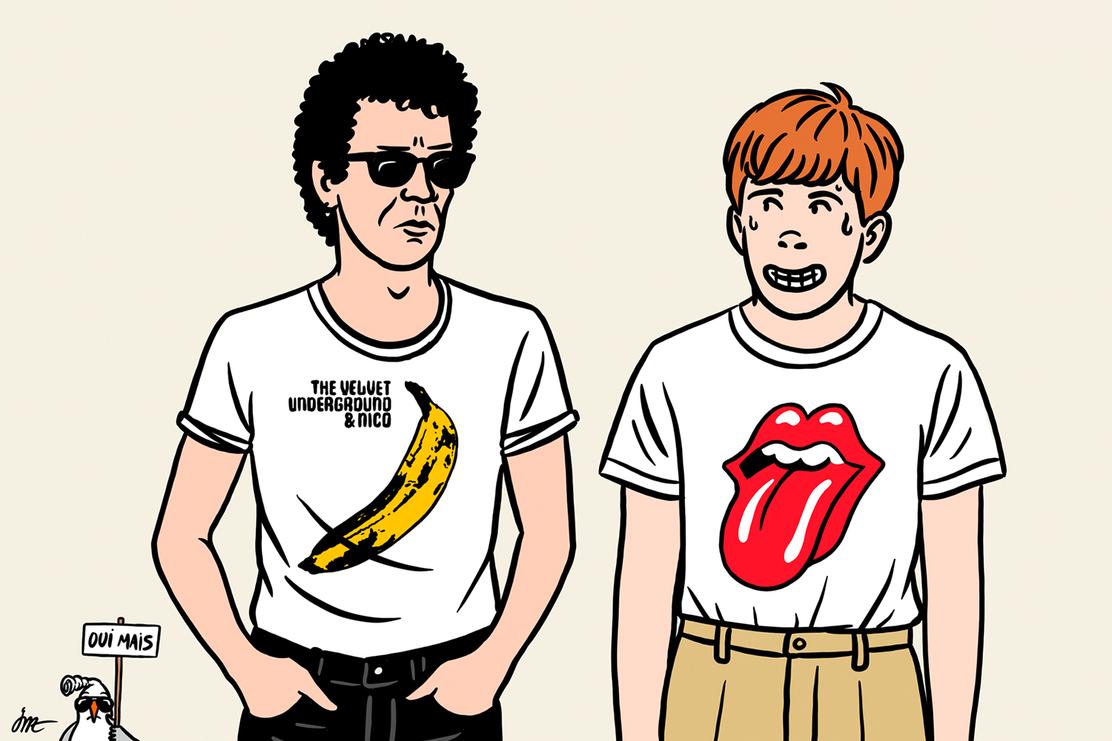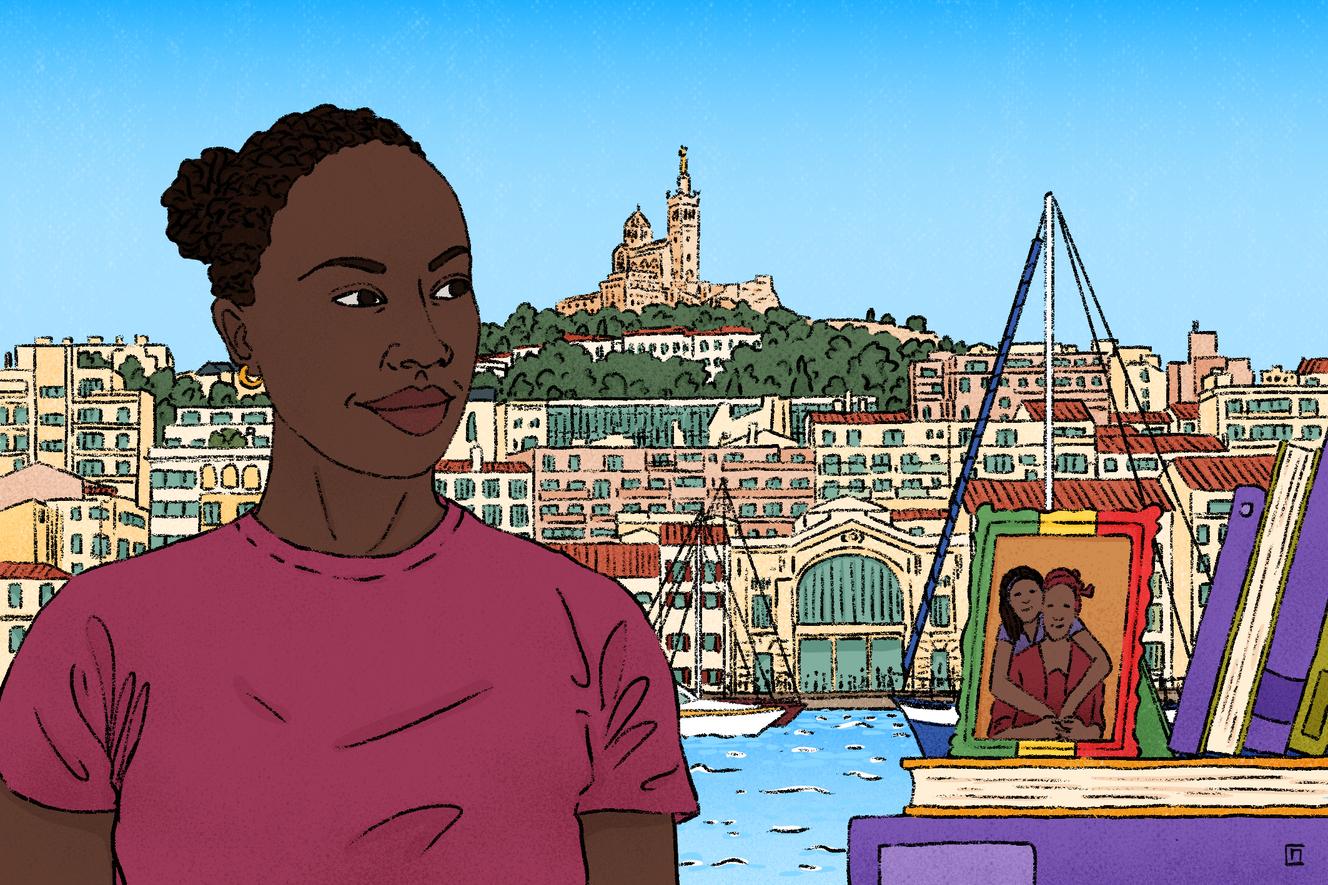Le grand oral du bac à l’ère de ChatGPT : « Dès qu’on creuse sur les connaissances ou l’argumentation, il n’y a plus personne »
Les 531 000 élèves de terminale générale et technologique passent l’oral jusqu’au 2 juillet. De plus en plus d’entre eux utilise les intelligences artificielles pour le préparer. Les enseignants, eux, ont peu de temps dans l’année à y consacrer.

Après avoir passé plusieurs jours à être juré du grand oral du baccalauréat, François (qui souhaite rester anonyme) est passablement agacé. « Je me demande ce que j’examine et pourtant cette évaluation compte pour 10 % de la note finale du bac », s’énerve ce professeur de sciences économiques et sociales de l’académie de Bordeaux. Parmi les dizaines de candidats qu’il a reçus, il en a vu « réciter des textes qui ne pouvaient pas être les leurs ». « J’ai parfois l’impression d’être un professeur du Cours Florent [l’école de théâtre]. Je ne sais pas comment a été préparé l’exposé et je n’ai pas les moyens de le vérifier », expose-t-il.
A côté des sujets types fournis depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, les intelligences artificielles (IA) génératives, utilisées de plus en plus fréquemment par les élèves, viennent troubler les enseignants interrogés. « On se retrouve avec des exposés bien écrits avec des références qui tombent naturellement mais qui sonnent creux », affirme François, à qui les inspecteurs ont transmis une « consigne claire » : « Ne pas sanctionner un élève qui a utilisé une IA », rapporte-t-il.
Depuis le 23 juin et jusqu’au 2 juillet, les 531 000 élèves de terminale générale et technologique passent cette dernière épreuve orale, fruit de la réforme de l’examen mise en place par Jean-Michel Blanquer en 2018. Les candidats présentent deux sujets en relation avec leurs enseignements de spécialité, qu’ils ont préparés pendant l’année. Le jury composé de deux enseignants, dont un non-spécialiste de la matière, en choisit un. L’élève a alors dix minutes d’exposé puis dix minutes d’entretien.
« Cette seconde partie avec les questions du jury permet de se rendre compte de l’utilisation ou non de l’IA, même si c’est de moins en moins aisé », constate David Boudeau, professeur de sciences de la vie et de la Terre et président de l’Association des professeurs de biologie et de géologie. Pour l’enseignant, certains élèves prennent l’IA comme « une baguette magique » qui « génère un exposé en quelques minutes » et ils « s’arrêtent là » : « Des mots de vocabulaire assez poussés sont prononcés, le discours est clair, mais dès qu’on creuse sur les connaissances ou l’argumentation, il n’y a plus personne. »
« Cela finit par se voir »
Christine Guimonnet en est convaincue, « si l’élève s’est contenté de ChatGPT, cela finit par se voir ». Professeure d’histoire-géographie dans l’académie de Versailles, elle a eu le cas d’une élève, durant la première semaine d’examen, qui a assumé avoir travaillé avec l’IA et un youtubeur « dont elle ne se rappelait plus le nom » pour son sujet « Peut-on dire que la Russie est une dictature ? ». « Elle ne pouvait pas donner d’arrière-plan géo-historique ou même me dire comment l’on nomme le Parlement russe », déplore l’enseignante.
Néanmoins, l’impact sur la note n’est pas toujours très important, la forme comptant autant que le fond. Cette épreuve est désormais réputée facile chez les lycéens. Le ministère de l’éducation nationale minimise, lui, les conséquences de l’utilisation de l’IA sur cette épreuve, puisqu’elle repose sur la « capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante », mais aussi « à argumenter et à relier les savoirs, à mobiliser son esprit critique ».
Les enseignants ne rejettent pas totalement la faute sur leurs élèves, car ils se plaignent de ne pas avoir le temps de bien les préparer à cette épreuve. Aucun accompagnement spécifique au grand oral n’est prévu dans les emplois du temps et depuis le retour des épreuves écrites en juin à la session 2024, cette préparation s’est encore réduite comme peau de chagrin.
Dans une enquête de l’Association des professeurs de sciences économiques et sociales à laquelle plus de 750 enseignants de cette discipline ont répondu au printemps, 41 % ont déclaré qu’aucun oral blanc n’était organisé dans leur établissement. Ils sont 42 % à juger les attendus du grand oral peu, voire pas du tout, clairs et plus de la moitié se sentent insuffisamment formés. « Les élèves ne peuvent pas fournir un vrai travail de recherche sur le temps scolaire. Ils s’en remettent alors à divers outils dont l’IA, sans le regard critique suffisant », déplore Benjamin Quennesson, coprésident de cette association.
« S’en servir tout en apprenant à s’en méfier »
Dans l’académie de Montpellier, la professeure de mathématiques Chloé Chateau a pris les devants. Pour leur montrer comment bien se servir des intelligences artificielles, elle a demandé à ses élèves de s’appuyer sur ChatGPT pour définir leur problématique et formuler leur sujet. « On a par exemple demandé à l’IA de mettre en lumière des paradoxes en mathématiques, détaille l’enseignante, qui a ensuite engagé les élèves à prendre du recul avec les résultats obtenus. Ils peuvent s’en servir comme d’un assistant tout en apprenant à s’en méfier. »
« Comme tout nouvel outil, il faudrait que les enseignants puissent se l’approprier et montrer à leurs élèves comment s’en servir, et ne pas voir seulement la bête monstrueuse qui va nous remplacer », reconnaît Jean-Christophe Masseron, professeur de mathématiques à Paris, qui fait comparer à ses élèves les résultats obtenus par différentes IA à partir d’une même demande. L’enseignant constate un usage exponentiel de ces outils par les élèves depuis quelques mois. « Ils se sont servis de ChatGPT pour le grand oral, comme pour écrire leurs lettres de motivation pour Parcoursup », relève-t-il.
Ces différentes expériences ouvrent la boîte de Pandore de l’évaluation à l’heure de l’intelligence artificielle et posent la question du format du grand oral, qui « n’a pas encore bien trouvé sa place », selon nombre d’enseignants interrogés. Pour le ministère de l’éducation nationale, à l’inverse, « la moyenne des candidats à cette épreuve montre qu’elle est bien comprise et maîtrisée par [ces derniers] ».
La Rue de Grenelle fait néanmoins le choix de diminuer son poids à partir de 2026, en raison de la création d’une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques, dont le coefficient est pris sur le grand oral. Ce dernier comptera désormais pour 8 % de la note finale du baccalauréat contre 10 % actuellement pour la voie générale, et pour 12 % au lieu de 14 % pour la voie technologique. Est-ce en raison de ces différentes limites ? Le ministère de l’éducation nationale assure que non, le grand oral restant la deuxième épreuve en ce qui concerne le coefficient.
[Source: Le Monde]