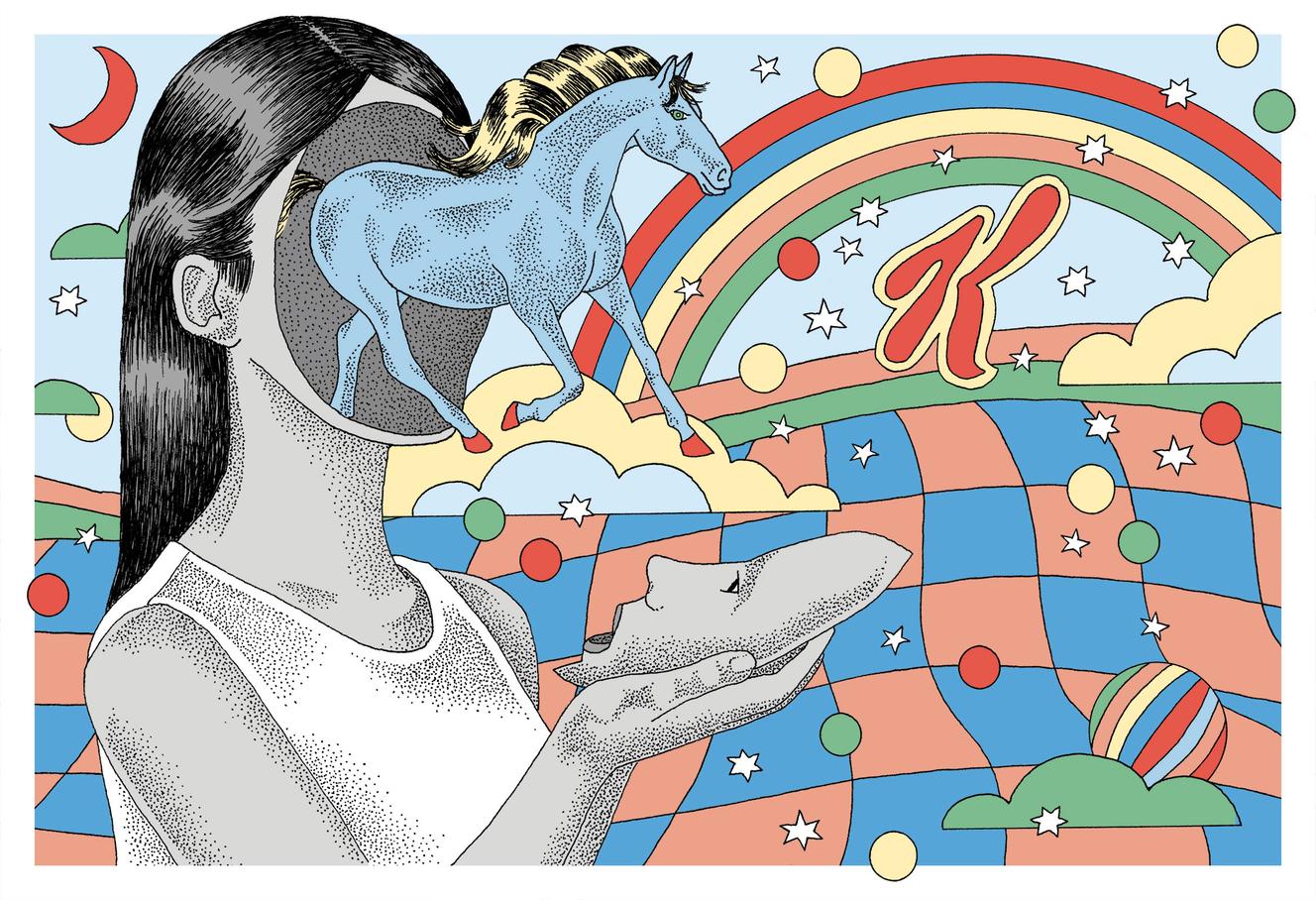La Chine, hyperpuissance de la transition écologique
Panneaux solaires, éolien, batteries… En quinze ans, le pays s’est hissé, à coups de plans quinquennaux, au sommet mondial de cette industrie, reléguant les Européens loin derrière.

Des étendues désertiques du Gansu au nord aux monts du Yunnan au sud, en passant par les collines creusées d’anciennes mines de charbon du Shanxi et les marais salants du golfe de Bohai, la Chine se couvre de panneaux solaires à un rythme qui défie l’imagination. Les installations photovoltaïques font désormais partie du paysage, de même que les éoliennes. Le pays, pourtant encore de loin premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, occupe une place à part du fait de son effort en matière de transition énergétique.
Environ 55 % des panneaux installés dans le monde en 2024 ont été posés en Chine et, rien qu’en cinq mois, entre janvier et mai, 198 gigawatts (GW) de panneaux solaires ont été déployés sur le territoire chinois – un peu moins que la puissance installée cumulée aux Etats-Unis (239 GW). La Chine a ainsi franchi les 1 000 GW de panneaux solaires installés – elle peine à tenir le rythme de leur branchement au réseau – quand l’Union européenne (UE) était à 338 GW à la fin de l’année 2024.
« La Chine a bâti le système d’énergies renouvelables le plus étendu (…) et la chaîne industrielle dans les nouvelles énergies la plus complète », lançait le président, Xi Jinping, le 23 avril dans un message adressé à un sommet virtuel sur le climat organisé par le Brésil. En un cercle qu’il juge vertueux, l’Etat-parti entend faire de la Chine le premier pays à concilier transition énergétique et croissance économique soutenue.
Rattrapage économique des provinces rurales
La Chine part de loin. Au début des années 2010, le charbon est encore roi, le parc de voitures à essence est en pleine expansion et l’air à Pékin est irrespirable. Les autorités estiment à cette époque à 1,2 million le nombre de morts causées chaque année par la pollution de l’air, devenue un problème politique majeur. En 2015, un documentaire d’une ancienne journaliste de la télévision d’Etat, Chai Jing, qui pense que cet « airpocalypse » est la cause d’une tumeur chez sa fille avant même sa naissance, émeut nombre de familles.
La protection de l’environnement devient une composante majeure des « plans quinquennaux » qui organisent les ambitions du gouvernement. A partir du douzième plan (2011-2015), la Chine désulfure massivement les centrales à charbon, responsables en grande partie des pluies acides et des particules fines et explore le déploiement de lignes à ultra-haute tension pour acheminer l’électricité verte des régions arides et ensoleillées de l’Ouest comme le Qinghai et le Xinjiang vers les centres industriels des régions côtières.
Invitées par Pékin à investir massivement dans les industries de la transition énergétique, les provinces rurales y voient l’occasion d’amorcer enfin un rattrapage économique. Un groupe de la région alors encore peu dynamique de l’Anhui, Sungrow, devient au cours des années 2010 le deuxième plus gros fabricant mondial d’onduleurs (derrière le géant chinois Huawei), indispensables pour convertir l’électricité des panneaux photovoltaïques. Et ce grâce à des contrats majeurs pour des fermes solaires à travers la Chine et un programme d’électrification de villages reculés.
En 2020, les autorités de la même province de l’Anhui font venir un prestigieux constructeur de voitures électriques alors au bord de la faillite, le shanghaïen Nio qui, contre un premier chèque équivalent à 800 millions d’euros, installe à Hefei une usine automatisée remplie de robots allemands. Dans l’attente d’une rentabilité, Nio est encore aujourd’hui régulièrement soutenu par des fonds publics locaux.
Concurrence féroce dans le pays
Li Auto à Changzhou, XPeng à Canton, Leapmotor à Jinhua… Partout en Chine, des constructeurs émergent grâce au soutien de collectivités locales. Tous ne survivront pas. A Yichun, petite ville du Jiangxi, le siège de l’administration locale est dominé par un écran géant sur lequel sont listés tous les investissements dans les « nouveaux » secteurs de l’économie et leur état d’avancement. Là-bas, le constructeur automobile Neta et ses emplois tenaient grâce aux financements des autorités locales, jusqu’à se déclarer en cessation de paiements en juin. Les producteurs de panneaux solaires se plaignent aussi de la difficulté à survivre, les groupes les plus puissants cassant en permanence les prix.
Il y a du trop-plein, mais la Chine estime que c’est par la masse de sa production que les technologies vertes deviennent accessibles à l’échelle planétaire. Ses entreprises, en concurrence féroce entre elles, innovent sans cesse pour réduire les coûts, améliorer les performances et tenter de dégager une marge. Le leader mondial des batteries automobiles, CATL, installé dans la province du Fujian, à Ningde (38 % du marché mondial), et le deuxième, BYD (15 %, mais premier producteur de voitures électriques de la planète), à Shenzhen (Guangdong), sont dans une guerre à qui saura rendre accessible la batterie chargeable en cinq minutes.
L’empire du Milieu dispose de 80 % de la capacité de production de panneaux solaires dans le monde, de 60 % pour les éoliennes, il construit la moitié de la soixantaine de réacteurs nucléaires actuellement en chantier sur la planète et domine environ 70 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Son savoir-faire dans les batteries automobiles lui permet en retour de prendre l’avantage dans un autre secteur-clé : les armoires de stockage d’énergies de source intermittente, nécessaires pour rendre le solaire et l’éolien viables à grande échelle.
La Chine renforce ainsi sa domination industrielle avec une présence sur toute la chaîne, des investissements dans les matières premières partout dans le monde jusqu’aux produits finis. Le gouvernement, lui, soutient l’ensemble par des subventions et une planification à long terme.
Pour Pékin, cette industrie de la transition énergétique apporte une réponse à la crise du modèle économique précédent. Le secteur immobilier s’est figé et la consommation intérieure n’est jamais repartie au rythme d’avant la pandémie de Covid-19. Les nouvelles technologies de la transition et du numérique, elles, ont progressé trois fois plus vite que le reste de l’économie en 2024, générant plus de 1 600 milliards d’euros de produit intérieur brut, soit l’équivalent de l’économie espagnole.
Plus grande consommatrice mondiale de charbon
« La force de traction de la transition énergétique n’est plus tant la politique que le marché. Des familles dont les revenus ne sont pas élevés peuvent désormais s’acheter une voiture électrique, tandis que le coût d’un champ de panneaux solaires ou d’éoliennes est devenu plus faible que celui de centrales au charbon ou au gaz naturel », constate Jiang Kejun, professeur en politiques climatiques sur le campus de Canton de l’Université des sciences et technologies de Hongkong. M. Jiang sait de quoi il parle : il a longtemps dirigé un institut rattaché à la très puissante agence de planification étatique.
Li Shuo, devenu directeur du programme sur la Chine et le climat d’Asia Society après avoir travaillé chez Greenpeace, fait un constat proche. « Cela a commencé par une vision très claire du gouvernement sur la nécessité d’améliorer la situation sur le plan de l’environnement tout en en tirant les avantages économiques. Mais ensuite l’échelle, l’intégration des chaînes d’approvisionnement, l’efficacité industrielle ont engendré une baisse des coûts qui permet à la Chine, devenue hyperpuissance des technologies vertes, d’apporter ses produits et sa technologie au monde », dit-il.
Malgré cela, la Chine a encore émis 12 milliards de tonnes de CO2 en 2024, soit 30 % du total de la planète pour seulement 18 % de sa population. Alors que le pays a longtemps insisté dans les négociations climatiques sur la responsabilité des Occidentaux, un Chinois émet toujours moins de CO2 qu’un Américain, mais plus du double d’un Français. La part du charbon a chuté dans sa consommation énergétique, passant de plus de 70 % en 2010 à 58 % en 2024, mais le pays en brûle toujours 40 % de plus que tout le reste de la planète réunie.
Les observateurs se demandent quand cet effort massif dans les renouvelables se traduira enfin par une baisse de ses émissions. La Chine s’est engagée à atteindre le pic de ses émissions d’ici à 2030 et la neutralité carbone en 2060. Une étude du Centre de recherche sur l’énergie et l’air propre, basé à Helskini, a constaté en mars que les émissions de la Chine ont baissé de 1 % sur un an.
Les Européens en première ligne
Les aléas du dynamisme de l’économie ainsi que de l’utilisation des climatiseurs, dont sont très friands les Chinois, du fait des canicules plus fréquentes rendent toute prédiction hasardeuse, alors que de leur côté les Etats-Unis abandonnent leurs ambitions climatiques. Mais la Chine pourrait être très proche dès maintenant de son pic d’émissions. Certes, le pays continue de choquer en construisant de nouvelles centrales au charbon, mais 80 % de la hausse de sa demande en électricité est désormais couverte par les énergies dites « propres », approchant ainsi du basculement si elle continue à installer du renouvelable à un tel rythme.
Sa domination de l’économie de la transition n’est pas sans conséquences sur ses relations avec le reste du monde. Pékin considère faire sa part du travail parfois dans des secteurs longtemps délaissés par les Occidentaux tels que les batteries et refuse d’entendre que ses subventions puissent être destructrices d’emplois ailleurs, comme l’en accuse l’UE. La Chine se contente de répéter que c’est elle qui rendra la transition possible pour tous. Les Etats-Unis ont fermé la porte : Joe Biden avait imposé 100 % de droits de douane aux voitures électriques chinoises et Donald Trump détricote les politiques climatiques.
Les Européens sont donc en première ligne et peinent à réaliser à quel point il sera difficile, si ce n’est illusoire, d’envisager combler le retard industriel et technologique tandis que le leader poursuit son sprint. A une autre époque, la Chine n’était pas parvenue à rattraper les Allemands et les Japonais dans les moteurs à essence, elle avait dû les forcer à s’adosser à des entreprises locales sur son marché.
« La technologie chinoise est vraiment forte maintenant. L’Europe est confrontée à ce que subissait la Chine il y a vingt ou trente ans sur les voitures thermiques. Pour promouvoir l’emploi local, il faut demander aux groupes chinois de faire des coentreprises localement, comme la Chine l’a imposé par le passé », conseille Jiang Kejun, qui a longtemps travaillé auprès des planificateurs chinois.
[Source: Le Monde]