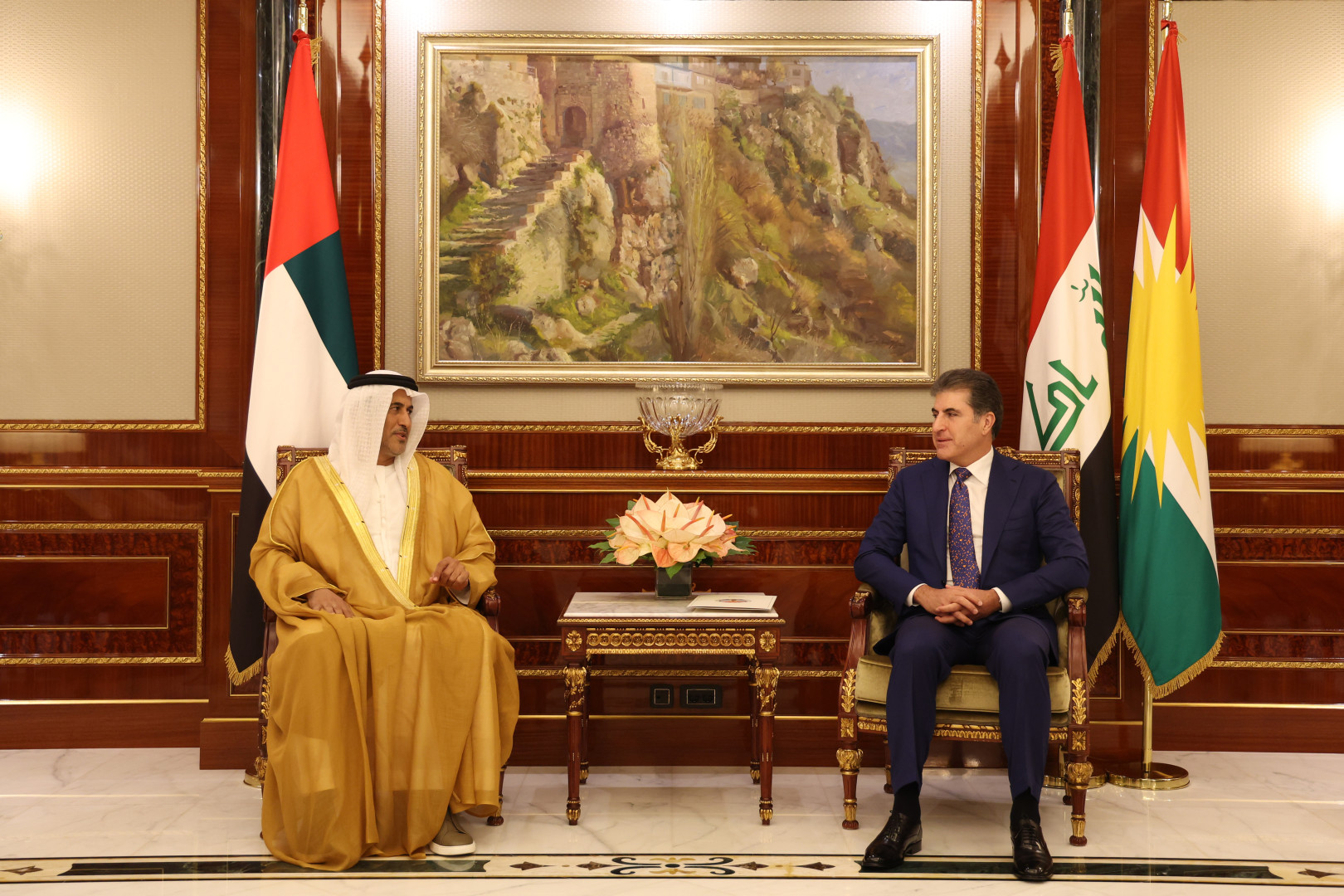Pourquoi Israël ne sait pas terminer une guerre
Les guerres menées par l’armée israélienne ont toujours duré des années quand une intervention extérieure, généralement des Etats-Unis, n’y mettait pas fin.

L’Etat d’Israël s’est établi dans ses frontières actuelles, soit 77 % de ce qui était jusque-là la Palestine, à l’issue d’une guerre fondatrice d’un peu moins de huit mois, en 1948-1949. La jeune armée israélienne a alors triomphé des cinq armées arabes venues d’Egypte, de Syrie, de Transjordanie, d’Irak et du Liban pour l’attaquer.
Cette première guerre israélo-arabe, qualifiée de « guerre d’indépendance » en Israël et de « guerre de Palestine » en arabe, s’est accompagnée de l’expulsion de plus de la moitié de la population arabe de Palestine, dont une bonne partie s’est réfugiée dans la région de Gaza, sous la protection de l’armée égyptienne. L’armée israélienne a alors tenté une manœuvre d’encerclement en pénétrant en territoire égyptien, une incursion contrée par les Etats-Unis, qui ont imposé un cessez-le-feu. Non seulement cette intervention américaine a marqué l’avènement d’une « bande de Gaza », mais elle a constitué un précédent d’interventions réussies, là où l’armée israélienne, laissée à elle-même, semble incapable de mettre fin aux hostilités.
La deuxième guerre israélo-arabe, en octobre-novembre 1956, est la seule où l’armée israélienne n’opère pas seule, mais en coalition avec la France et le Royaume-Uni, déterminés à abattre en Egypte le régime du colonel Nasser, qui a osé nationaliser le canal de Suez. Les Etats-Unis contraignent les trois agresseurs à suspendre les hostilités, avant d’obliger Israël à évacuer les territoires occupés, notamment la bande de Gaza, en mars 1957.
Des guerres courtes, pourtant plus favorables à Israël
La troisième guerre israélo-arabe, en juin 1967, est entrée dans l’histoire sous l’appellation de « guerre des Six-Jours », du fait du caractère fulgurant de l’offensive israélienne. Non seulement Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont désormais occupées, mais c’est aussi le cas de la péninsule égyptienne du Sinaï et du plateau syrien du Golan. Les Etats-Unis obtiennent d’Israël un cessez-le-feu avant que l’humiliation arabe ne vire à la déroute, ce qui aurait entraîné une réaction de l’Union soviétique.
Le même enchaînement se reproduit en octobre 1973, après cette fois dix-huit jours d’un conflit ouvert par une offensive syro-égyptienne.
L’invasion israélienne du Liban, en mars 1978, est suspendue au bout de quelques jours par les Etats-Unis, déterminés à parrainer la première paix israélo-arabe, signée, un an plus tard, entre Israël et l’Egypte. En revanche, la deuxième invasion israélienne du Liban, en juin 1982, est soutenue par Washington, ce qui ouvre un conflit long de dix-huit ans. Outre le soutien américain à l’occupation par Israël d’une partie du Liban, la durée exceptionnelle de cette guerre s’explique parce que la cible initiale de l’Etat hébreu, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), n’est expulsée du Liban que pour être remplacée par un adversaire enraciné localement et bien plus redoutable, le Hezbollah pro-iranien.
Israël met un terme au conflit en décidant de retirer unilatéralement ses troupes du Liban, en mai 2000. C’est aussi par un retrait unilatéral, cette fois hors de Gaza, qu’Israël clôt, en septembre 2005, les cinq années d’insurrection palestinienne désignées sous l’expression de « deuxième Intifada ».
Les risques d’un aveuglement militariste
Les deux retraits qu’Israël a refusé de négocier hors du Liban et de Gaza génèrent une instabilité structurelle, malgré un rapport de force écrasant en faveur de l’Etat hébreu. Le front libanais s’ouvre de nouveau en juillet 2006 pour une « guerre des trente-trois jours », que seuls les Etats-Unis et la France parviennent à suspendre.
Le blocus imposé durant seize années par Israël à la bande de Gaza, après sa prise de contrôle par le Hamas, en juin 2007, n’empêche pas un cycle d’affrontements dévastateurs pour l’enclave palestinienne, en 2008-2009, en 2012, en 2014 et en 2021. Ces « guerres de Gaza » se concluent au bout d’une à plusieurs semaines par un cessez-le-feu parrainé par l’Egypte, sous la pression des Etats-Unis, mais sans négociation directe entre Israël et le Hamas. Le contraste est frappant avec la « première Intifada », le soulèvement non armé de la population palestinienne de 1987 à 1993, qui avait débouché sur des négociations directes entre Israël et l’OLP et un authentique processus de paix israélo-palestinien.
Benyamin Nétanyahou, l’actuel premier ministre israélien, avait déjà saboté un tel processus de paix lors d’un précédent passage à la tête du gouvernement, de 1996 à 1999. Il a trouvé dans la guerre contre Gaza, devenue une fin en soi, le moyen le plus sûr d’échapper aux multiples procédures judiciaires qui le visent. Il alimente pour cela le traumatisme profond qu’ont laissé les attaques du Hamas, le 7 octobre 2023, dans la société israélienne. Et il nourrit d’autant plus ce traumatisme qu’il refuse d’accorder la priorité à la libération des otages israéliens, préférant une escalade sans fin dont l’impact est effroyable pour la population de Gaza. Mais Benyamin Nétanyahou s’est débarrassé à l’automne 2024 de son ministre de la défense, puis des généraux qui s’opposaient à la prolongation d’un conflit sans objectif militaire clair. Cette fuite en avant s’est aggravée avec la guerre déclenchée, le 13 juin, par Israël contre l’Iran, guerre conclue, douze jours plus tard, après une intervention inédite des Etats-Unis aux côtés d’Israël.
Quant à la guerre en cours contre Gaza, elle est entrée dans son vingt-deuxième mois, sans autre horizon de règlement qu’une trêve qui serait aussi fragile que les deux précédentes. Si l’histoire nous éclaire à cet égard, c’est que le gouvernement israélien ne pourra pas être convaincu, mais devra être contraint à mettre un terme aux hostilités.
[Source: Le Monde]