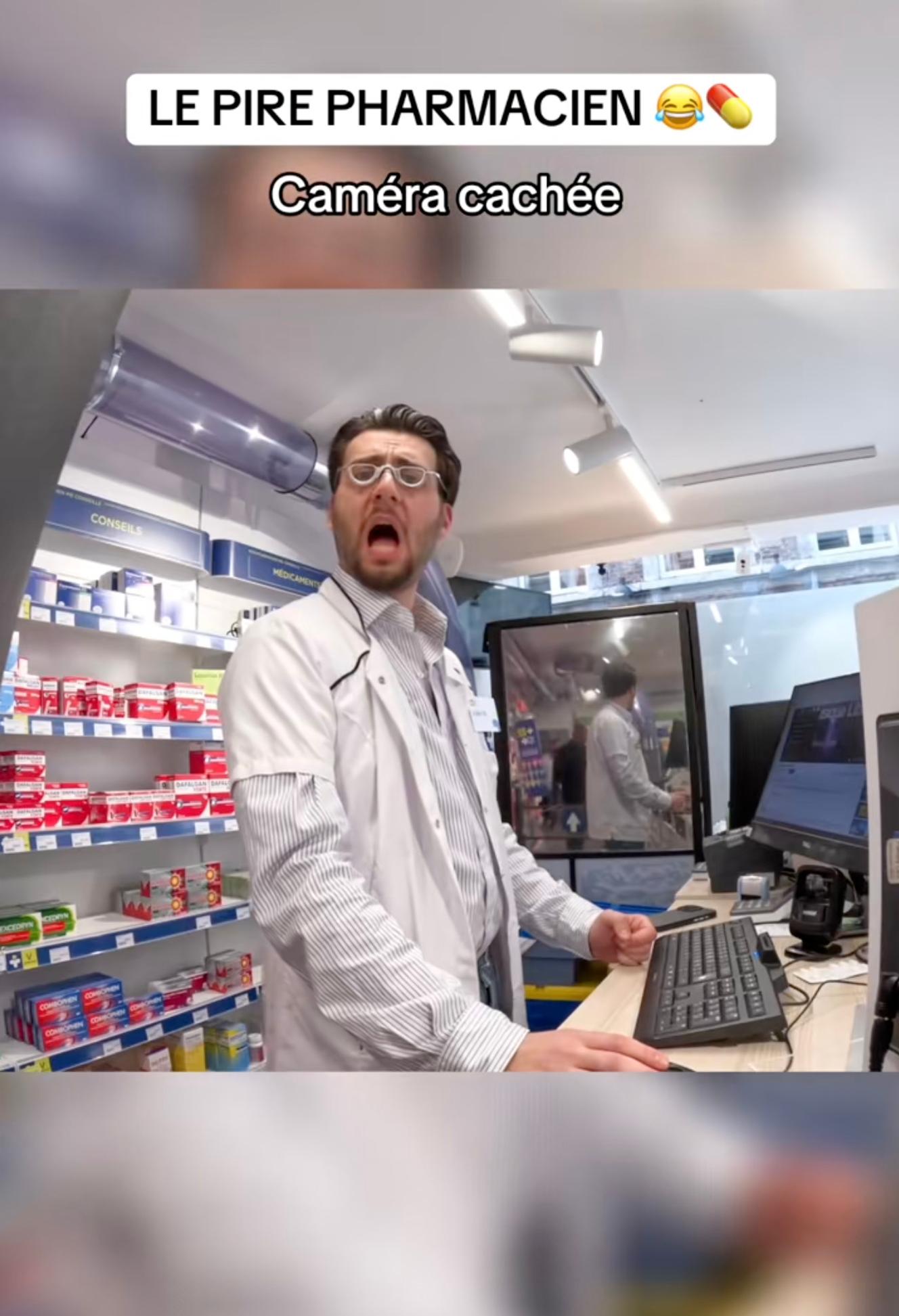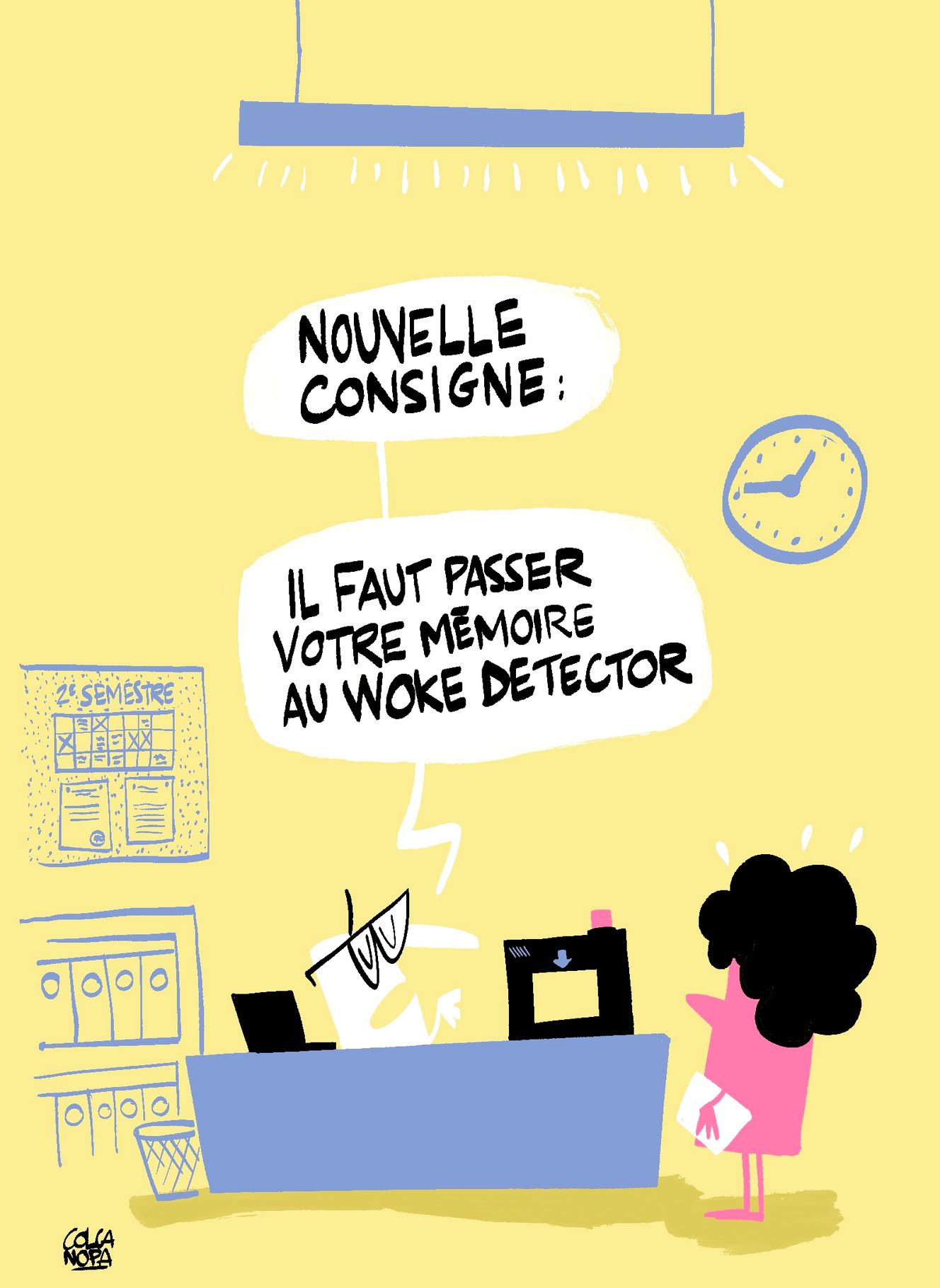Face à la Russie, « la théorie du fou » de Donald Trump, qui annonce mobiliser deux sous-marins nucléaires
Le président américain a affirmé, vendredi, réagir aux déclarations de l’ancien président russe Dmitri Medvedev, alors qu’il tente, sans succès pour l’instant, de faire venir Vladimir Poutine à la table des négociations sur l’Ukraine.

Donald Trump, a annoncé, vendredi 1er août, le déploiement de deux sous-marins nucléaires face à la Russie. « A la suite des déclarations hautement provocatrices de l’ancien président russe Dmitri Medvedev, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, j’ai ordonné le déploiement de deux sous-marins nucléaires dans les zones concernées, au cas où ces déclarations insensées et incendiaires seraient plus que cela », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Et d’ajouter : « Les mots sont très importants et peuvent souvent avoir des conséquences inattendues. J’espère que ce ne sera pas le cas. »
En cause, les propos de M. Medvedev. Traité juste avant de « président raté de la Russie qui croit qu’il est toujours président » par Donald Trump, l’ancien chef de l’Etat russe a invité sur le réseau Telegram et en russe le locataire de la Maison Blanche à revoir la série télévisée post-apocalyptique The Walking Dead et il a fait allusion à la fameuse « main morte », le système de riposte nucléaire automatique de la Russie soviétique.
M. Medvedev, qui passait pour un président modéré entre 2008 et 2012, est un habitué de ce genre de propos, en témoignent ses déclarations lorsqu’il fut question, en 2022, d’enquêter sur les crimes de guerre russes en Ukraine : « L’idée de punir un pays qui possède l’un des plus grands potentiels nucléaires est absurde. Et constitue potentiellement une menace pour l’existence de l’humanité », avait-il menacé.
Nul ne sait si l’annonce de Donald Trump a conduit à un changement effectif de position des sous-marins américains et si ceux-ci sont à propulsion nucléaire et-ou armé d’ogives nucléaires. Ils n’ont en théorie pas à être repositionné, pouvant atteindre leur cible à des milliers de kilomètres de distance.
Mais la menace fait partie de la chorégraphie américaine, alors que le président a donné à Vladimir Poutine un ultimatum de cinquante jours, le 14 juillet, ramené à une dizaine de jours, le 29 juillet, pour arrêter les hostilités. Le républicain a compris que la paix qu’il se promettait de conclure entre la Russie et l’Ukraine était pour l’instant inopérante. Il a menacé Moscou de sanctions, tout en se demandant si elles seraient efficaces et il a envisagé des représailles secondaires, pour les pays qui financent de facto la Russie, notamment l’Inde et la Chine, acheteurs de ses hydrocarbures.
L’initiative de Donald Trump incite à la prudence
Dmitri Medvedev a violemment attaqué ce procédé sur X, en anglais, le 28 juillet : « Trump joue au jeu de l’ultimatum avec la Russie : cinquante jours ou dix jours… Il devrait se rappeler deux choses : 1. La Russie n’est ni Israël, ni même l’Iran. 2. Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre. Non pas entre la Russie et l’Ukraine, mais avec son propre pays. Ne prenez pas la voie de “Sleepy Joe” [le surnom donné par Donald Trump à son prédécesseur démocrate Joe Biden] ».
L’initiative du président américain incite à la prudence. Le comité éditorial du Wall Street Journal estime certes que Joe Biden a « beaucoup trop toléré le chantage nucléaire de la Russie » et calibré ses ripostes dans la guerre en Ukraine tout en jugeant que « la théorie du fou de Trump », qui consiste à être complètement imprévisible « a ses limites ». Lors de son premier mandat, le républicain avait utilisé cette tactique face à son homologue nord-coréen, Kim Jong-un, déclarant que son « bouton nucléaire » était « beaucoup plus gros et plus puissant » que celui de M. Kim.
Mais la Corée du Nord n’est pas la Russie. Vendredi, le président russe, Vladimir Poutine, a répondu indirectement pour la première fois à Donald Trump depuis son ultimatum de lundi. « Toutes les déceptions naissent d’attentes démesurées, a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, près de Saint-Pétersbourg. Pour résoudre le problème de manière pacifique, nous avons besoin de discussions approfondies, non pas en public, mais dans le silence d’un processus de négociation. »
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans une déclaration publiée peu après les propos tenus par Vladimir Poutine, a pour sa part exhorté la Russie à « aller au-delà de l’échange de déclarations et de réunions de niveau technique pour engager des pourparlers entre dirigeants ». Les deux pays belligérants ont tenu trois réunions techniques à Istanbul, en Turquie, au cours des dernières semaines.
Intensification des frappes russes sur l’Ukraine
Ces échanges ont lieu alors que l’envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, est censé se rendre à Moscou. « Nous allons imposer des sanctions », avait déclaré, jeudi, Donald Trump dont le ton bienveillant vis-à-vis de Moscou a changé. « La Russie ? Je trouve ce qu’ils font dégoûtant », a-t-il déclaré faisant référence à la poursuite des bombardements de l’Ukraine.
Jeudi, au moins trente et une personnes ont été tuées et 150 autres blessées lorsque des missiles et des drones russes ont percuté plusieurs bâtiments de la capitale Kiev.
Selon un décompte de l’Agence France-Presse publié vendredi, les forces armées russes n’ont jamais lancé autant de drones contre l’Ukraine qu’en juillet de cette année. Cette analyse, fondée sur des chiffres fournis par Kiev, révèle que Moscou a tiré 6 297 de ces engins à longue portée contre l’Ukraine, un chiffre en augmentation pour le troisième mois consécutif et en hausse de 16 % par rapport à juin.
[Source: Le Monde]