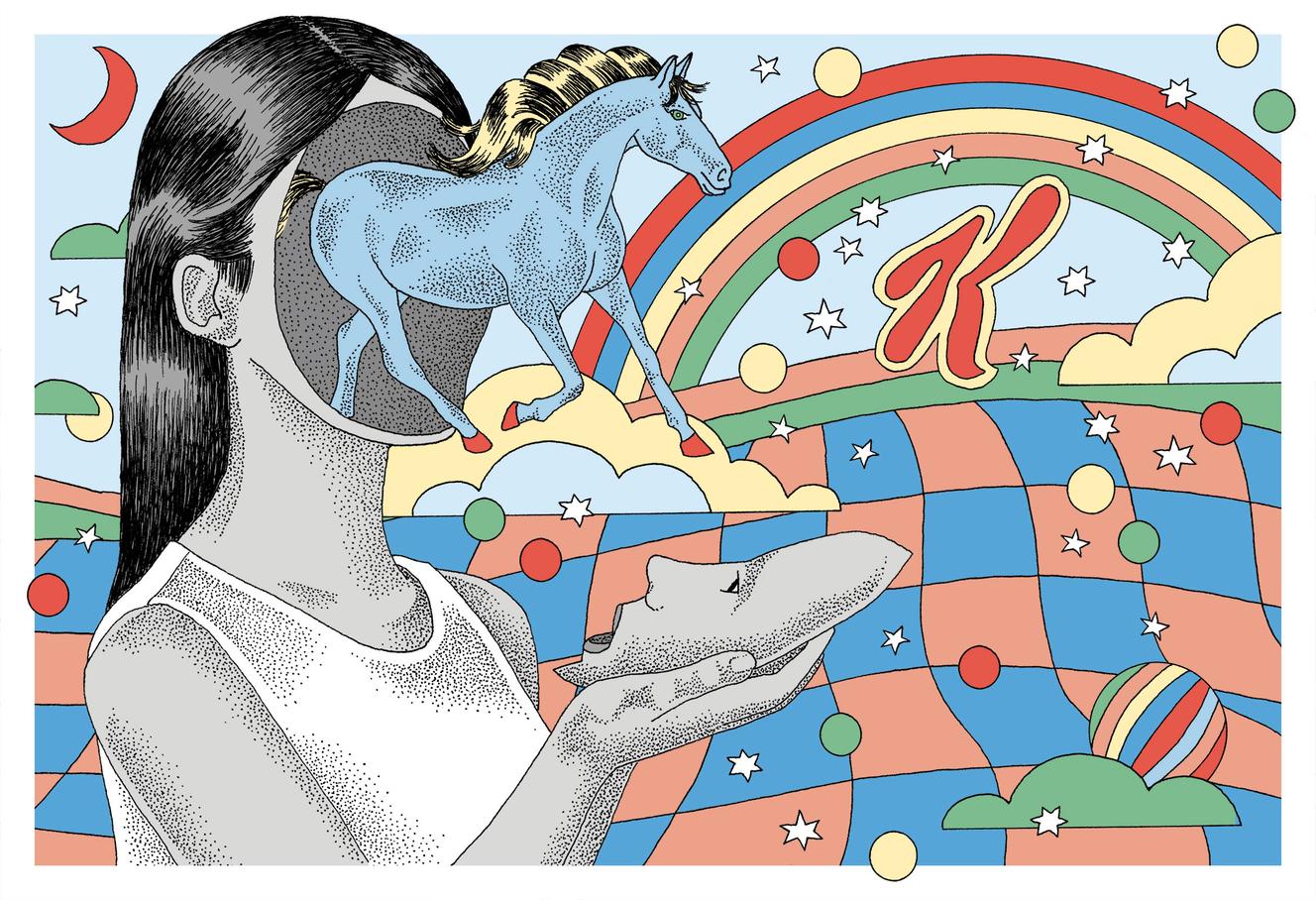Vacances : ces freins financiers, psychologiques ou logistiques qui empêchent une partie des Français de partir
De 20 % à 40 % de la population ne parviennent pas à s’offrir au moins une semaine de congé hors du domicile chaque année. Les communes et les associations qui tentent de les soutenir commencent à pâtir du contexte économique.

« J’ai l’impression que c’est un peu obligatoire de partir, mais, heureusement, mes enfants ne sont pas difficiles et il y a plein de choses qu’on n’a pas encore faites à Angers. » Sarah (prénom d’emprunt), secrétaire médicale de 32 ans, profite ce mercredi 16 juillet, avec ses enfants, des animations gratuites de « L’été au lac », un programme organisé par la municipalité : baby gym avec sa dernière, tir à l’arc et tennis de table pour ses deux aînés. Elle passera son été dans la ville où elle habite. « J’aimerais partir, mais cela coûte cher ! », glisse-t-elle.
Selon une enquête du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, en 2023, 40 % des Français ne sont pas partis en vacances, soit quatre nuits consécutives hors du domicile, principalement pour des raisons financières. Début 2024, 21 % de la population déclaraient, selon l’Insee, ne pas avoir les moyens de partir au moins une semaine en vacances. Des niveaux proches de ceux constatés avant la crise sanitaire liée au Covid-19.
Précaires enchaînant les contrats courts, étudiants en job d’été, familles monoparentales ou nombreuses… « Pour ceux dont la seule préoccupation est de remplir le frigo, il est impossible de se projeter dans un départ », explique Jean Stellittano, secrétaire national du Secours populaire.
Au manque de moyens s’ajoutent parfois des freins symboliques, logistiques ou encore psychologiques. Pousser la porte d’un centre social peut être associé – à tort – par certains à la figure stigmatisante des « cassos ». « Alors même que nos activités s’adressent à des publics précaires, beaucoup n’y recourent pas facilement, par fierté », témoigne Romain Beaucher, président du centre social intercommunal des Portes du Morvan, à Lormes (Nièvre). Paradoxalement, ce sont des familles des classes moyenne et supérieure nouvellement installées sur ce territoire fortement attractif qui vont se tourner vers son centre social, désireuses de nouer des liens. « Le défi est d’inverser le stigmate et de rendre désirable le fait de partir en vacances avec le centre social », ajoute le président.
Sentiment de culpabilité
Encore faut-il s’autoriser à partir. Rencontrée au pied de son immeuble HLM du quartier populaire de la Roseraie, à Angers, Ibtissem (elle n’a pas précisé son nom), 34 ans, un mari dans le BTP et deux enfants, évoque le coût des billets pour aller rendre visite à sa famille en Algérie. Surtout, elle attend des réponses pour obtenir la nationalité française et suivre un CAP petite enfance : « Des personnes travaillent pour moi, je ne peux pas partir en vacances ! »
Un sentiment de culpabilité et d’illégitimité qui se retrouve chez nombre de bénéficiaires du centre social et culturel Faubourg Duchateau, à Denain (Nord), une commune où le taux de pauvreté atteignait 43 % en 2021, selon sa directrice, Alexia Cachera. « Il y a ceux qui se disent “les vacances, c’est pas pour moi qui suis au RSA [revenu de solidarité active], c’est pour ceux qui travaillent, moi, on va me dire que je suis en vacances toute l’année”, explique-t-elle. Même s’ils n’ont pas un travail rémunéré, ils ont un quotidien stressant, fait de lourdes questions comme “comment je fais bouillir la marmite ?” »
« Il y a le travail rémunéré, le travail domestique, celui du “care” et celui de chercher un travail, relève, de son côté, le sociologue spécialiste des loisirs Bertrand Réau. Penser les vacances uniquement en termes de récompense du travail, c’est mettre sous silence leurs autres fonctions sociales : savoir-faire, savoir-être, intégration sociale… »
Ce savoir-faire s’acquiert. « On apprend à partir en vacances, (…) à se sentir “capable” d’organiser quelque chose de dépaysant, analyse M. Réau. Apprendre à réserver un billet, organiser un itinéraire et des activités dans un lieu inconnu… Tout cela nécessite une socialisation particulière. » D’après M. Stellittano, du Secours populaire, « beaucoup n’ont que les images de la télé, de choses luxueuses et inatteignables. Nous leur parlons de la montagne, des séjours à la ferme. On lève les freins un à un : mettre un peu d’argent de côté chaque mois, demander une aide financière, trouver la destination, le matériel… » Si nécessaire, des bénévoles assurent un accompagnement, une fois sur place.
« Un moyen de se relancer »
Le frein à la mobilité peut être particulièrement handicapant, qu’il soit matériel (absence de permis et-ou de voiture) ou psychologique. « Il y a une crainte chez certains adultes de ne pas comprendre comment marchent les transports en commun, même ceux de proximité, constate Mme Cachera, à Denain. D’où l’importance de familiariser les enfants aux sorties en tram pour que cela ne devienne pas un frein, une fois adulte. »
Car l’accès aux vacances est un bénéfice à la fois individuel et collectif. « Partir même une semaine, ou faire partir ses enfants, a un effet impressionnant sur le moral, la santé mentale, la cohésion familiale. Plus encore quand on vit à quatre dans un deux-pièces, remarque M. Stellittano. C’est un répit, un moyen de se relancer et des souvenirs que l’on garde longtemps. »
« Loin d’être uniquement un temps de détente et de plaisir, les vacances peuvent être aussi l’occasion de construire des compétences de gestion financière, d’organisation logistique, d’ouverture à autrui qui seront mobilisables dans d’autres sphères », considère M. Réau.
Une dynamique positive qu’Alexia Cachera mesure de façon tangible au sein de son centre socioculturel : « Il y a des jeunes qu’on a connus enfants qui reviennent pour faire du bénévolat, puis qui passent leur BAFA [brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur] pour devenir animateur. Cela fonctionne très bien et crée un réel lien de confiance avec les habitants, car ils sont issus du quartier. »

Les excursions à la journée sont l’occasion de « recréer une appartenance de territoire à travers des souvenirs communs », considère Christelle Priet, directrice du centre socioculturel et de loisirs du Pays châtillonnais (Côte-d’Or), un territoire enclavé qui cumule les indicateurs de fragilité. « L’été est l’occasion de permettre à chacun de se réapproprier son cadre de vie : non, on n’a rien à envier à d’autres territoires et oui, ça peut être chouette le Châtillonnais. » « Proposer des activités tout l’été, c’est non seulement offrir de structurer le temps, mais aussi permettre d’avoir des choses à raconter à la rentrée, pour éviter le sentiment de honte », défend-elle.
Inflation des transports
Avec le centre social Christine-Brossier, à Sury-le-Comtal (Loire), « la sortie accrobranche revient à 10 euros la journée, repas compris, loin du tarif normal », souligne Alexandra Faure, responsable du pôle enfance. Mais les initiatives des municipalités, des maisons des jeunes et de la culture ou des associations commencent à pâtir du contexte économique. Un autre frein qui vient s’ajouter.
Inflation des transports oblige, le Secours populaire a dû renforcer sa collecte de dons afin de rassembler 80 000 enfants lors de sa Journée des oubliés des vacances, prévue le 20 août. A Denain, le centre social d’Alexia Cachera reçoit une aide de l’Etat pour son « plan été ». « Ce plan a été fait pour recréer du lien et redynamiser aussi le tourisme, qui avait pris un gros coup avec l’épidémie [de Covid-19], explique-t-elle. Sans ces financements, les séjours [organisés à Olhain, dans le Pas-de-Calais, et à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, ainsi que la plupart des activités à la journée] auraient été impossibles à organiser. Chaque année, nous avons la crainte qu’on nous annonce que ça s’arrête. »
Le gouvernement avait consacré 50 millions d’euros, en 2020, aux dispositifs « Quartiers d’été » et « Quartiers solidaires », qui subventionnent séjours et activités pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une enveloppe divisée par deux en 2025. Les « colos apprenantes », plébiscitées depuis leur lancement en 2020, subissent une légère réduction de voilure cette année, avec 34,9 millions d’euros finançant le départ d’enfants de familles modestes.
La dotation du Pass colo, créé en 2024, a certes presque triplé, à 11,5 millions d’euros, mais son impact demeure limité : ce chèque de 200 à 350 euros est réservé aux séjours des enfants de 11 ans, sous condition de ressources, et laisse un reste à charge souvent élevé. Pour 2026, Matignon compte réduire de 300 millions d’euros le budget alloué au sport, à la jeunesse et à la vie associative.
« L’Etat s’est désengagé »
De fait, les vacances font les frais d’un changement de paradigme politique. En témoigne la récente proposition controversée du gouvernement de monétiser la cinquième semaine de congés payés, un totem de l’ère Mitterrand instauré pour « changer la vie » des Français.
« Dans les années 1960-1970, l’Etat s’engageait activement sur le sujet, à la fois du côté de l’offre, par l’aménagement du territoire [construction de stations balnéaires, édification de villages de vacances, etc.], et du côté de la demande, par un large soutien aux associations de tourisme social. En 1998, une loi contre les exclusions reconnaissait le droit aux vacances comme un droit fondamental. Puis l’Etat s’est désengagé », retrace M. Réau.
Il note que, désormais, l’Insee suit « la demande touristique principalement avec un angle économique : combien de nuitées sont réservées dans telle ou telle commune, quelle est la part du tourisme international, etc. » Les vacances des Français ne sont redevenues un sujet qu’au gré du Covid-19, du fait de « la désertion des touristes internationaux ». Quitte à disparaître de nouveau une fois la crise sanitaire passée ?
[Source: Le Monde]