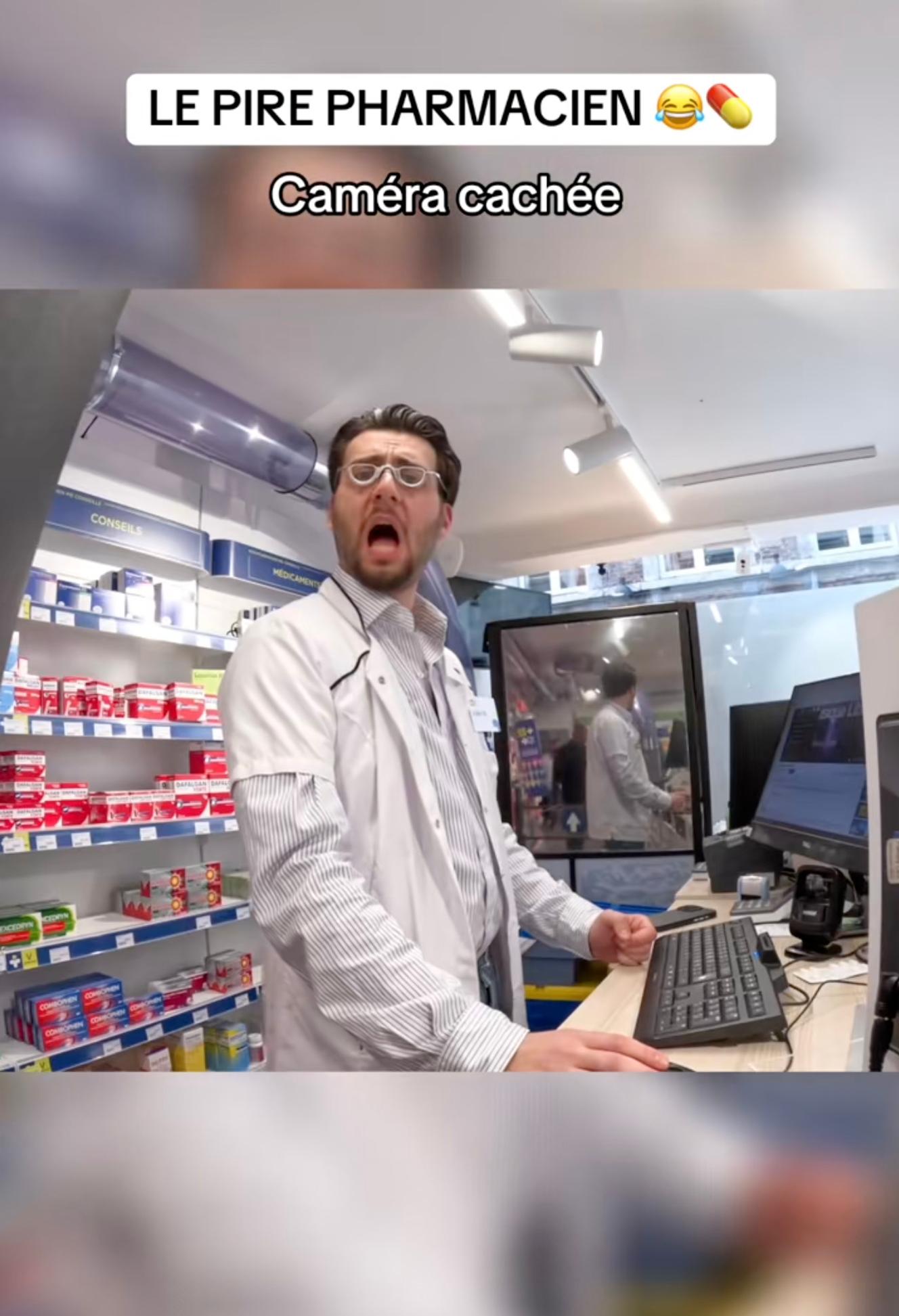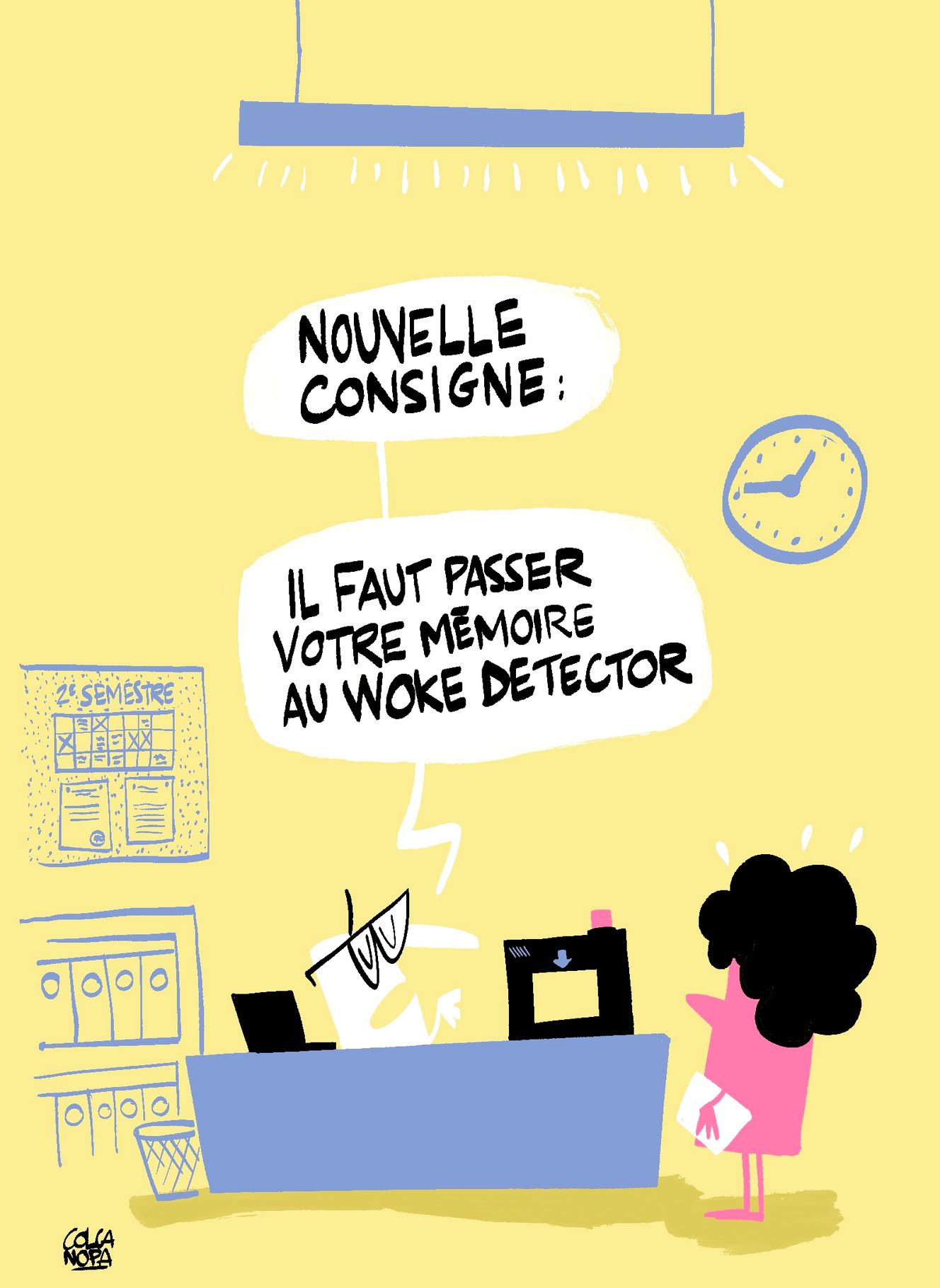Incendie dans l’Aude : « Ça ressemblait à l’apocalypse, ce feu qui arrivait sur nous à une telle vitesse »
Dans le massif des Corbières, 16 000 hectares de végétation ont été carbonisés en l’espace de vingt-quatre heures malgré la mobilisation de 2 500 pompiers appuyés par la plupart des moyens aériens dont dispose la France.

« On est seuls au monde. » Cette phrase résonnera longtemps dans la tête de Denis Bruno. « Imaginez un peu la scène… raconte-t-il. Le feu entoure ma maison, il est à deux mètres de la façade et tout près dans le jardin, derrière. Moi, j’humidifie les murs comme je peux avec mon tuyau d’arrosage et le pompier qui tient la lance me dit : “On est seuls au monde”. »
Déjà inquiet de la violence des flammes, Denis Bruno reconnaît avoir senti la peur l’envahir. Une sensation qu’il ne connaissait pas, mais qui l’a habité durant les longues heures où le feu a tourné autour de Coustouge (Aude), son village des Corbières. « Etre au milieu des flammes, entendre leur bruit, c’est effrayant. Mais il fallait que je reste pour protéger ce qui fait ma vie, ce que j’ai construit. »
Cette peur, ils sont nombreux à l’avoir ressentie, chacun à leur manière, face à la déferlante de flammes que connaît le massif des Corbières depuis mardi 5 août à 16 heures. A Coustouge, où trois maisons ont brûlé, une partie des 116 habitants ont fui, dès mardi soir, les flammes qui ont rodé une partie de la nuit. Mercredi, une partie d’entre eux sont revenus en fin de journée et n’ont pu que constater le spectacle de désolation.
La route départementale 106 qui conduit vers ce hameau, était jonchée de fils électriques, de poteaux fracassés et qui terminaient doucement de se consumer ou flambaient à nouveau. Pas un brin d’herbe ne reste dans les fossés et sur les accotements, couleur de suie. Partout, à perte de vue, des squelettes d’arbres au milieu d’un paysage gris. Au bord de la route, deux maisons dont il ne reste plus que des pans de murs, comme si l’intérieur, les huisseries et le toit avaient fondu sous la chaleur du brasier.
Le plus gros incendie de l’été
Dans les Corbières, 16 000 hectares de végétation ont été carbonisés en vingt-quatre heures malgré la lutte sans relâche de 2 500 pompiers sur ce feu hors normes dont les flammes montaient à 10 mètres ou 15 mètres et dont les fumées voilaient tout le paysage, mercredi soir encore. Dans les villages et près des bâtiments calcinés, une odeur de brûlé épaississait l’air, le rendant difficile à respirer. On dit déjà de ce sinistre qu’il serait le plus gros incendie de l’été, un de ceux difficiles à gérer.

Pompier depuis 1987, Christophe Magny, directeur du service d’incendies et de secours de l’Aude, reconnaît avoir été confronté à un feu d’une puissance et d’une rapidité inédite. « Mardi, il se propageait à une vitesse de 1 000 hectares à l’heure et nous avons observé des sautes de feu de 200 mètres et même de 500 mètres, qui allumaient un nouvel incendie plus loin », résume le colonel. Face aux quelque 90 kilomètres de lisière du sinistre, il a fallu installer quatre PC opérationnels, ce qui est très rare.
Exceptionnelle également la mobilisation de neuf des onze Canadair dont dispose la France, ainsi que de quatre avions Dash et plusieurs hélicoptères. Mercredi, ils ont opéré 200 largages d’eau dans une noria ininterrompue. Cela n’a pas suffi pour permettre aux soldats du feu de contrôler le sinistre qui continuait de s’étendre encore mercredi soir. Moins vite, certes, mais comme la tramontane est tombée, laissant place à un vent en provenance de la mer, les flammes sont parfois revenues sur des zones où elles étaient déjà passées.
La rareté des précipitations les deux années passées a créé une sécheresse profonde des arbres et des arbustes. Ce facteur, cumulé avec une température supérieure à 30 °C, un air ambiant très sec et un vent à 65 km/h expliquent pourquoi le feu s’est propagé aussi vite. A cela s’ajoute la combustibilité des pins d’Alep que l’Office national des forêts estime présents sur 30 % des territoires parcourus, le reste étant constitué de chênes verts (20 %), de garrigue (30 %) et de zones agricoles (20 %).
« Le ciel n’était qu’une chaîne de flammes »
Parti de la commune de Ribaute vers 16 heures, mardi, le feu est passé sur quinze communes différentes. Il s’est divisé à un moment créant deux sinistres distincts qui se sont finalement conjugués pour revenir sur certaines communes depuis deux directions différentes et en même temps. Cet incendie a causé un mort – une personne qui a refusé d’évacuer la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse – et deux blessés graves.
Dans ce lieu de 757 habitants, très touché par les flammes mardi soir et vers lequel elles revenaient mercredi soir, s’est rapidement organisé un endroit destiné à recevoir les évacués. De café dortoir improvisé, cette salle est devenue le lendemain un espace de partage d’une nuit cauchemardesque.
Gérard Navarro et Georges Clayrac, tous les deux la soixantaine, taisent ce qu’ils ont perdu dans le feu – un véhicule et un bateau pour le premier ; une plantation d’arbres fruitiers, pour le second –, jugeant que c’est insignifiant par rapport à ceux qui ont tout perdu. Ils s’arrêtent en revanche longuement sur la puissance inédite de l’incendie. « Jamais, on n’avait vu ça », note l’un, quand l’autre compare la manière dont les flammes se sont répandues à une traînée de poudre. Une expression qu’une habitante saisit au vol pour estimer que « ça ressemblait surtout à l’apocalypse, ce feu qui arrivait sur nous à une telle vitesse ».
Cette même image a également saisie Anne de Volontat lorsque, vers minuit, elle a tenté – en vain – avec son époux, le maire de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, de venir vérifier l’état de leur domaine viticole Château Les Palais, qu’ils avaient évacué à 19 heures, sur demande des gendarmes. « Je n’aurais jamais dû ressortir car le ciel n’était qu’une chaîne de flammes. C’était vraiment impressionnant et j’avoue que j’ai pensé à ce moment-là que je ne retrouverais pas la maison le lendemain matin. »
Au domaine, une des nombreuses exploitations viticoles des Corbières, le hangar, un tracteur et plusieurs véhicules ont brûlé. Témoins de la température qui a régné sur l’exploitation, les bouteilles vides, stockées dans la cour sur une palette, ont fondu et pris des libertés avec leur forme originelle lorsque le verre s’est resolidifié ; un salon de jardin, également fondu, côtoie des arbres qui n’ont pas brûlé.
Vignes et récoltes menacées
L’angoisse pèse maintenant sur le raisin, tant il est incertain que la cuvée 2025 puisse produire un vin commercialisable. Les fumées qui auront plané plusieurs jours sur les grappes de fruit en pleine maturation risquent de transformer le goût habituel. Mais il sera impossible de le savoir avant d’avoir vendangé et même vinifié…

Dans ce département où les vignerons peinent déjà à gagner leur vie et où a été réalisé un cinquième de l’arrachage des ceps financé en 2024 par le gouvernement, la perspective d’une récolte ratée, après deux exercices largement réduits en raison de la sécheresse, sème l’angoisse au sein de la profession et au-delà. « Ici, à Saint-Laurent, la coopérative fait vivre la moitié de la ville. Avec l’incendie, elle risque de perdre 80 % de son activité », s’inquiète Jeanne Fabre, vigneronne.
Comme si le feu avait joué les touristes sur la route des vins de Corbières, il a au passage roussi et séché une partie des parcelles, laissant croire que l’automne est déjà arrivé. Si la vigne est réputée être une culture pare-feu, les flammes hors normes ne lui ont pas permis de jouer ce rôle partout. Le secteur viticole compte pour 12 000 emplois dans l’Aude, auxquels il faut sans doute ajouter une bonne part du tourisme, tant les ceps sont un marqueur des paysages du massif.
Mercredi déjà, bien avant que les dernières braises soient éteintes, l’inquiétude de la survie de ce territoire était sur toutes les lèvres. Qui reviendra en vacances après avoir été évacué, comme cela a été le cas pour les vacanciers de plusieurs campings ? Qui choisira de vivre là où la végétation a brûlé et où le risque demeure ?
Après cet épisode, Claire Save et David Tharan – un jeune couple installé depuis un an – se posent déjà la question d’un départ. « Avoir dû évacuer a été une expérience assez traumatisante. Quand on a son sac à la main et qu’on se demande ce qu’on doit mettre dedans, ce qui est important pour nous, ce n’est pas si évident, observe la jeune femme. Ensuite, on a passé la nuit à se demander si on avait emmené les choses les plus importantes, à se dire qu’on aurait dû faire autrement. » Comme elle, un millier de personnes ont été évacuées. Et, mercredi soir, il était encore trop tôt pour regagner les domiciles, a rappelé la préfecture.
Cette première partie d’été a été dramatique pour l’Aude. A la région de Narbonne-Bages, dévastée les 7 et 8 juillet par le deuxième plus grand feu qu’avait connu le département depuis 1950, s’est ajouté celui de la zone de Sigean, où 500 hectares ont brûlé les 26 et 27 juillet. Le 5 juillet, il y avait eu le sinistre de Douzens, qui avait vu disparaître 360 hectares de végétation. Sans oublier, celui qui a ouvert l’été, le 29 juin, brûlant aussi 360 hectares à cause de braises échappées d’un barbecue mal éteint, transporté dans une remorque sur l’autoroute.
[Source: Le Monde]