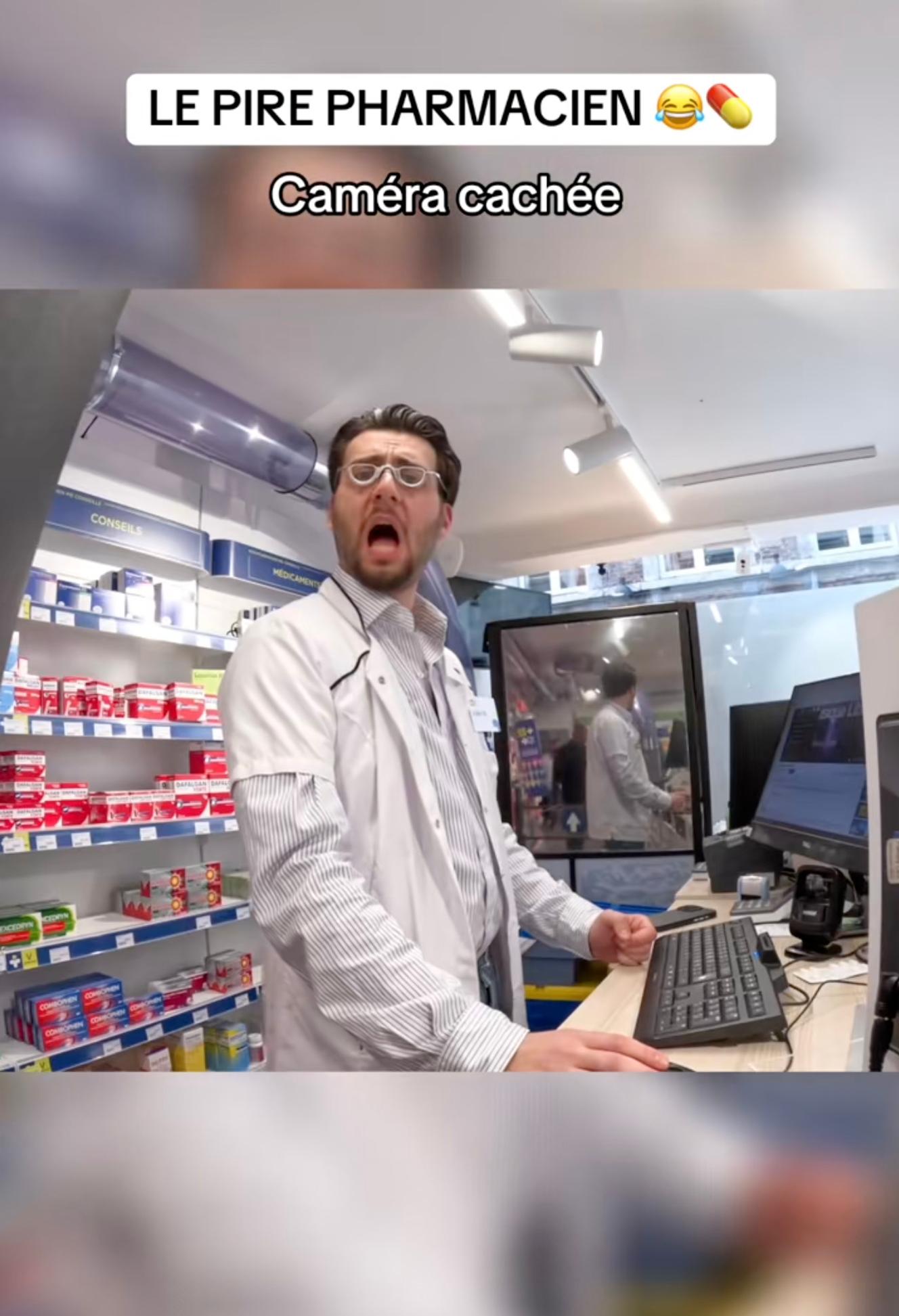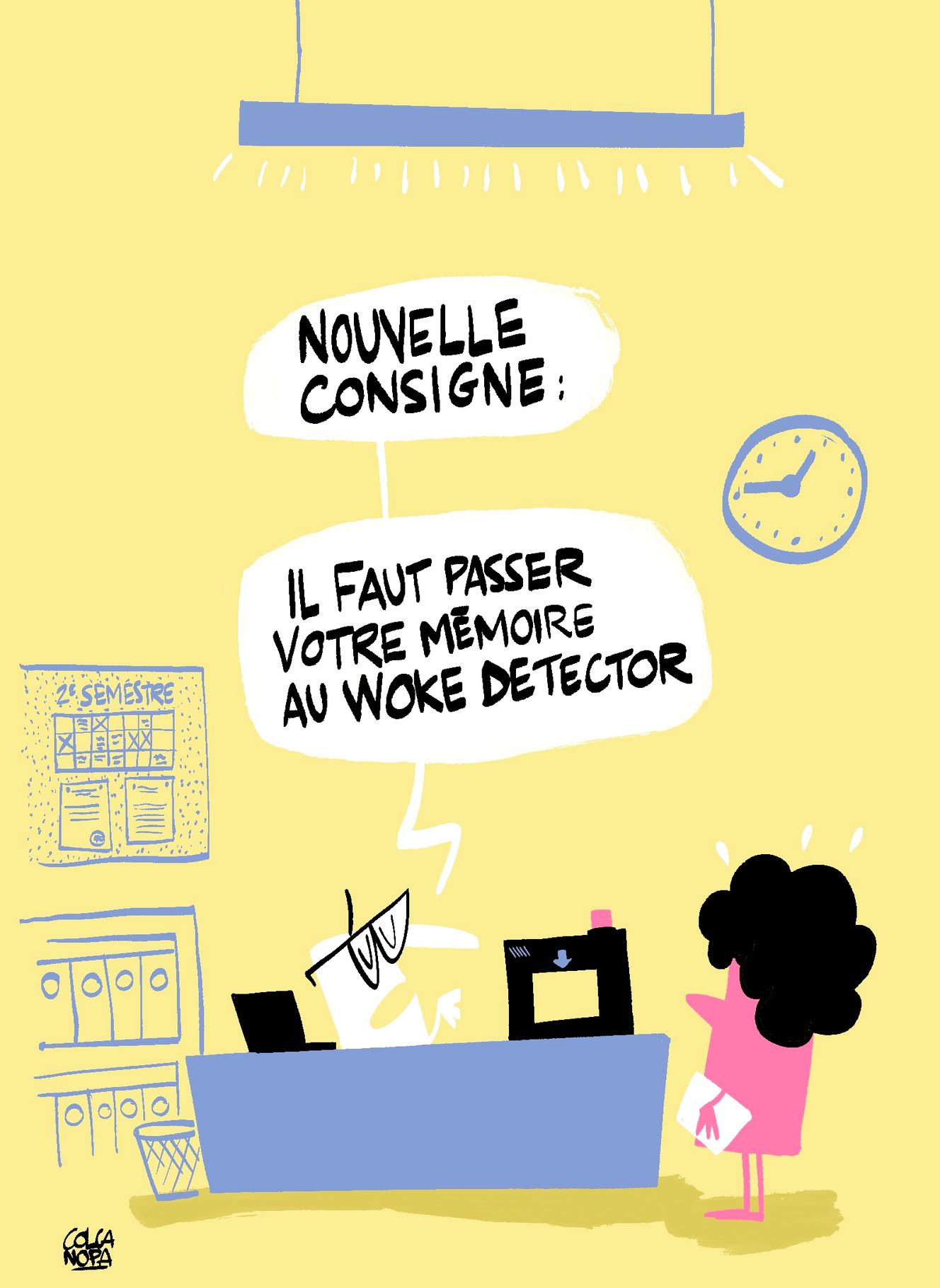Comment la géopolitique s’est invitée dans le conflit entre Thaïlande et Cambodge
Bangkok et Phnom Penh ont signé un cessez-le-feu, le 7 août, sous l’égide de l’Asean. La crise entre les deux pays, a révélé une redéfinition de l’influence de la Chine et des Etats-Unis dans la région.

La Thaïlande et le Cambodge se sont accordés sur les termes d’un cessez-le-feu à leur frontière commune, à Kuala Lumpur, jeudi 7 août, après quatre jours de négociations à l’initiative de la Malaisie, qui préside le groupement régional de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean), auquel appartiennent les deux pays. Le cessez-le-feu sera surveillé par une équipe d’attachés de défense de l’Asean. La Chine et les Etats-Unis y étant conviés en tant qu’observateurs.
La situation réelle sur le terrain reste difficile à éclaircir : l’armée thaïlandaise, par le truchement du commandant en chef de la région militaire concernée, Boonsin Padklang – qui a joué un rôle-clé durant le conflit – a affirmé, mercredi, qu’elle ne se retirerait pas de onze sites stratégiques sur la frontière « quels que soient les résultats des pourparlers »,une posture révélatrice du hiatus entre le gouvernement civil et le commandement militaire.
Les tensions autour de la frontière disputée, qui ont donné lieu à des escarmouches entre des soldats des deux camps et des mouvements de troupes depuis février, avaient pris une ampleur inédite le 24 juillet, avec des tirs de roquette du Cambodge contre des zones civiles en Thaïlande, puis une riposte de l’armée de l’air thaïlandaise contre le territoire cambodgien jusqu’à l’annonce d’un cessez-le-feu provisoire le 28 juillet au soir. Ces accrochages ont fait au moins 43 morts.
Appels du pied américains à Phnom Penh
L’exacerbation du conflit a vu les deux pays multiplier les initiatives en direction de la communauté internationale, dont les deux superpuissances américaine et chinoise, qui évoluent ici dans un théâtre historique d’affrontement : la Thaïlande est un allié des Etats-Unis ; le Cambodge est devenu ces quinze dernières années le « meilleur ami » de Pékin dans la région.
Or, Phnom Penh fait mine de flirter avec Washington depuis l’accession au poste de premier ministre de Hun Manet. Le fils de Hun Sen, président du sénat et considéré comme l’homme fort du Cambodge, est un ancien cadet de West Point, la célèbre académie militaire américaine. Un navire de guerre américain a, pour la première fois, fait escale à Sihanoukville fin 2024, après huit ans de brouille. L’intervention de Donald Trump, qui avait appelé les deux belligérants par téléphone le 26 juillet pour exiger un cessez-le-feu, a conduit le Cambodge à annoncer son soutien à la candidature du président américain pour le prix Nobel de la paix, le 1er août. A Phnom Penh, d’immenses affiches montrent le président américain avec la mention « President of Peace ».
Cet opportunisme est vu, côté thaïlandais, comme un quitte ou double de la part de la direction cambodgienne pour inciter les Etats-Unis à faire pression sur Bangkok sans toutefois s’aliéner la Chine. « Hun Sen pense qu’il est hors de question d’utiliser la Chine pour faire pression sur la Thaïlande, en raison des liens profonds et anciens entre les deux pays. La Chine n’interviendra tout simplement pas de cette manière », estime Wanwichit Boonprong, politologue à l’université Rangsit de Bangkok, dans une longue analyse publiée par le Bangkok Post. La presse cambodgienne a présenté comme un succès la rencontre, mercredi, entre le ministre de la défense cambodgien, Tea Seiha, et l’amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement indo-pacifique des Etats-Unis, en marge des négociations entre les deux gouvernements. Washington, qui avait déjà entrepris, sous la présidence de Joe Biden, de rétablir de meilleures relations avec le Cambodge pour faire contrepoids à la Chine, est ravi de voir Phnom Penh répondre à ses appels du pied.
En Thaïlande, la proposition cambodgienne d’attribuer le prix Nobel à Trump a attiré sarcasmes et critiques : les ultranationalistes estiment que le conflit n’est pas fini, et les progressistes ne voient pas en Trump un « homme de paix », estime en substance l’éditorialiste de Khaosod, Pravit Rojanaphruk.
Concession de Bangkok à Pékin
Sentant les Etats-Unis vaciller dans leur soutien, Bangkok veille à assurer ses arrières. « La stratégie de la Thaïlande a consisté à se rapprocher de puissances moyennes à travers le monde, dans ce qui semble être une démarche à long terme pour construire une coalition amicale de nations prêtes à écouter les appels de Bangkok concernant ce conflit », réagit, à Bangkok, Phil Robertson, directeur de l’ONG Asia Human Rights and Labor Advocates et observateur au long cours de la région.
Le 5 août, le gouvernement thaïlandais a approuvé la commande de quatre avions de chasse suédois Gripen supplémentaires – une proposition de l’armée de l’air thaïlandaise, annoncée au préalable et faite au détriment des F-16 américains également présents dans son arsenal. Mais le geste le plus hautement symbolique concerne la Chine : le gouvernement thaïlandais a approuvé le même jour, après des années de retard et d’âpres négociations, une commande de sous-marins chinois datant de 2017, initialement bloquée car les moteurs allemands prévus avaient été interdits d’exportation par Berlin en vertu de l’embargo européen vis-à-vis de la Chine. Bangkok a finalement accepté qu’ils soient équipés de moteurs chinois et de prolonger de trois ans le contrat pour leur fourniture – une concession considérable à Pékin de la part de Bangkok. Cette pomme de discorde empoisonnait les relations entre les deux pays.
La géopolitique d’aujourd’hui s’enracine dans les conflits du passé : la Thaïlande, contrairement à tous ses voisins d’Asie du Sud-Est, n’a jamais été colonisée, ayant habilement tiré parti des rivalités entre la France et le Royaume-Uni. Mais elle en a payé le prix : en 1893, le royaume a été contraint par la France de céder des territoires qu’il contrôlait au Laos et s’est vu imposer une frontière le long de la rive thaïlandaise du Mékong – et non sur la ligne médiane du fleuve, comme le voudrait une répartition équitable. Cette délimitation fut loin d’être le fruit d’un accord mutuel : à l’époque, des canonnières françaises tenaient Bangkok en joue. Ce traumatisme historique est resté vif dans la mémoire collective thaïlandaise.
Vulnérabilité stratégique
Dans le contentieux territorial avec le Cambodge, la dispute porte sur la frontière imposée par la France en 1904. La carte qui en découle, établie en 1907 à l’échelle du 1/200 000 (1 centimètre pour 2 kilomètres), octroyait au Cambodge – donc en réalité à la France – des positions stratégiques situées au-delà de la ligne de crête des monts Dangrek, frontière naturelle entre les deux pays. Bien que non validée par les membres siamois de la commission mixte comme elle aurait dû l’être par la suite, cette carte ne fit alors l’objet d’aucune objection formelle ni d’un contre-levé de la part de la Thailande, et c’est en son nom que la Cour internationale de Justice (CIJ) a accordé en 1962 et en 2013 le temple de Preah Vihear et ses environs, pourtant situés sur le plateau montagneux thaïlandais, au Cambodge.
Or, la Thaïlande conteste depuis plusieurs décennies ce tracé au nom de cartes plus précises (1/50 000, soit 1 centimètre pour 500 mètres) et souhaite négocier sur cette base une démarcation des zones disputées selon le principe de la ligne de crête. Cela s’explique : la perception de sa vulnérabilité stratégique par la Thaïlande a pris une dimension nouvelle à l’heure où la Chine étend son emprise sur le bassin du Mékong. La mainmise croissante de Pékin sur le Laos et le Cambodge est perçue à Bangkok, comme à Hanoï au Vietnam, comme une menace majeure.
Le Cambodge a sans conteste souffert dans son histoire de la domination du Siam, qui a occupé le nord du Cambodge de 1795 à 1907, puis de nouveau de 1942 à 1945, à la faveur de la capture de l’Indochine française par le Japon. Il a donc toutes les raisons de ne pas vouloir rester prisonnier d’un entre-deux avec son puissant voisin. Mais il n’est pas sans ressources : la possibilité d’un recours à l’arbitrage de la CIJ, comme pour la zone du temple de Preah Vihear en 1962 et 2013, lui donnait jusqu’alors un levier important. En abattant toutes ses cartes – Phnom Penh a déposé le 16 juin une plainte formelle à la CIJ pour quatre autres sites contestés – il reste désormais exposé au rapport de force qu’a tout lieu de vouloir imposer la Thaïlande, qui ne reconnaît pas la CIJ – sauf si les grandes puissances s’en mêlent…
[Source: Le Monde]