L’IA, mes étudiants et moi : « Le semestre passé constitue la pire expérience de ma vie d’enseignant »
L’écrivain et journaliste Thomas Chatterton Williams s’alarme de l’omniprésence de l’intelligence artificielle à l’université, qui met, selon lui, en péril des fondements mêmes de l’éducation et notre capacité à réfléchir.
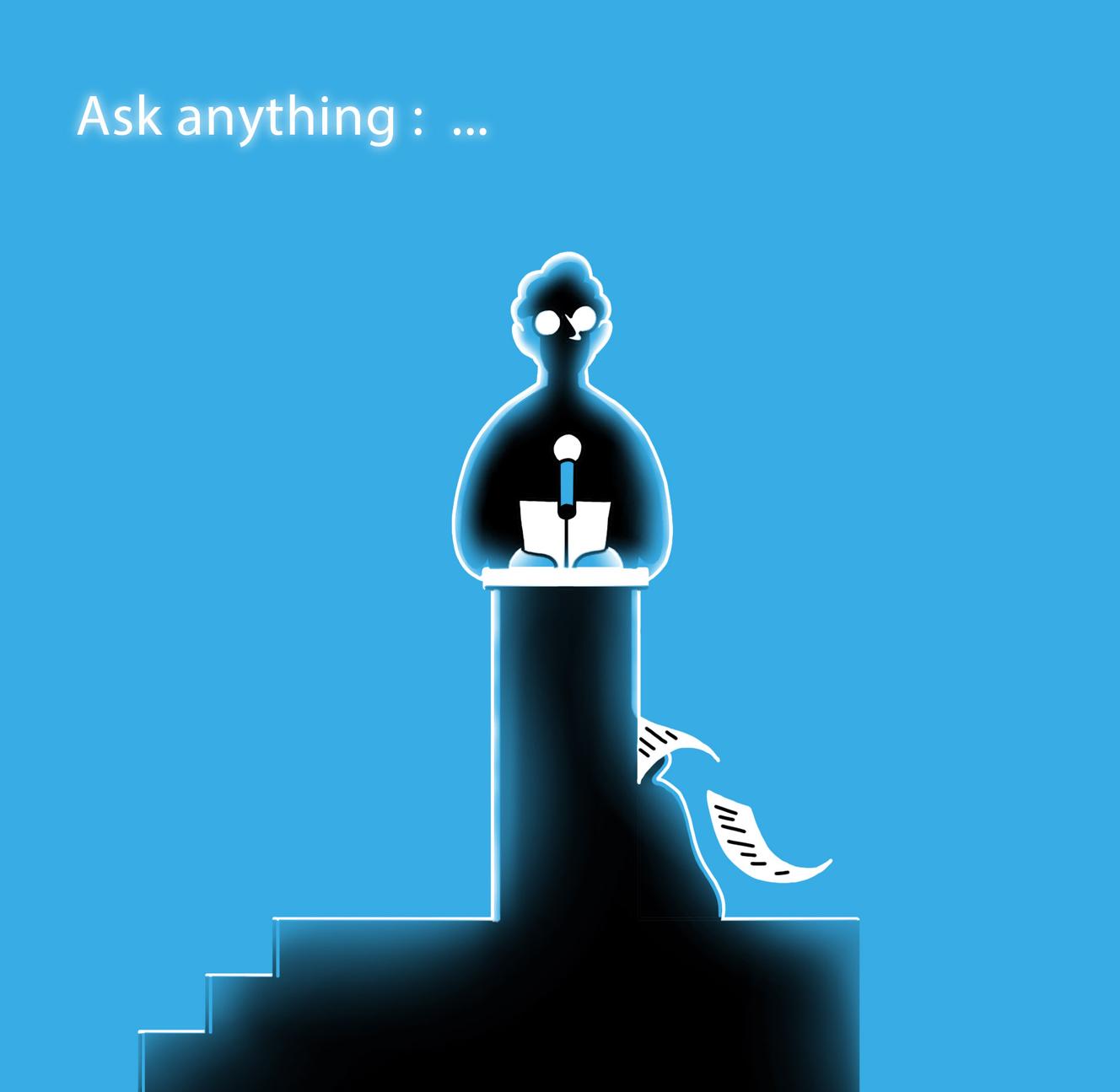
Depuis trois ans, j’enseigne au sein d’un liberal arts college, niché sur les berges du fleuve Hudson, à deux heures de route au nord de Manhattan, dans l’Etat de New York. Chaque année, de janvier à juin, j’y assure deux séminaires dans un cadre de carte postale.
Dans le premier cours, je propose à mes étudiants un panorama de la pensée noire aux Etats-Unis et, dans le second, nous examinons en détail certains textes-clés de l’écrivain français qui a le plus d’importance pour moi : Albert Camus. Ce séminaire-là, mené en anglais, commence par l’étude de L’Etranger – en douceur, si l’on peut dire. Nous nous attaquons ensuite au Mythe de Sisyphe, puis à La Peste, avant de batailler avec L’Homme révolté, lors des ultimes séances. Ce dernier essai est extrêmement difficile d’accès pour la génération actuelle, dépourvue de repères par rapport aux régimes sanguinaires du XXe siècle que dénonce Camus (qu’ils soient fascistes ou communistes) et totalement démunie face aux références classiques mobilisées par l’ouvrage, qu’elles soient littéraires ou bibliques – dans l’esprit de l’auteur, son lectorat les maîtriserait forcément.
Ce problème n’est pas propre à mon établissement. Même les universités les plus prestigieuses des Etats-Unis, qui exigeaient autrefois que les étudiants sachent lire et écrire le latin et le grec, ont considérablement revu leurs exigences à la baisse. Par exemple, les étudiants qui veulent intégrer Columbia, à New York, peuvent évoquer les podcasts qu’ils écoutent dans leurs dossiers de candidature. Plus besoin de se vanter, tel l’écrivain et essayiste américain d’origine ghanéenne W. E. B. Du Bois il y a un siècle, d’avancer « bras dessus bras dessous avec Balzac et Dumas ». Les établissements les plus réputés se contenteraient sans doute d’un nom comme celui de Joe Rogan, podcasteur et commentateur d’arts martiaux.
Comme je l’explique lors du premier cours, il n’est pas rédhibitoire de n’avoir aucune connaissance sur Nietzsche, Saint-Just ou Dostoïevski. Même ignorer qui est Caïn, Abel ou Prométhée n’est pas un obstacle insurmontable, quoique ce soit un peu plus inquiétant. Pour valider le séminaire, le seul impératif est de fournir un effort intellectuel sincère et soutenu. Les étudiants doivent assister à chaque séance, lire les textes du corpus, participer en classe et rendre quelques devoirs écrits faisant preuve de leurs compétences : voilà les clauses du contrat qu’étudiants et enseignants ratifient ensemble.
Disruption généralisée
Or l’enjeu des rendus écrits a été radicalement vidé de son sens par l’irruption de l’intelligence artificielle. En à peine trois ans d’enseignement, j’ai pu voir combien cette technique a profondément bouleversé les notions d’auteur et de plagiat, et jusqu’à l’idée même de réflexion personnelle. Tant et si bien que, désormais, la seule manière pour moi d’accorder du crédit à des travaux d’étudiants est de les voir coucher leurs idées sur le papier de mes propres yeux.
OpenAI a lancé ChatGPT à l’attaque de la planète en novembre 2022, deux mois avant mon premier cours. Un ou deux étudiants essayèrent maladroitement de faire passer pour personnels des devoirs écrits par des intelligences artificielles génératives – pensant, de façon presque attendrissante, que je n’y verrais que du feu. Mais la fraude était assez facile à détecter, et la sanction fut immédiate et sévère.
A l’été 2023, et en l’absence de procédures claires à l’échelle des institutions – dans les universités et même dans les établissements d’enseignement secondaire –, personne n’était préparé à l’ampleur monumentale qu’allait prendre cette disruption généralisée.
A mesure que la technologie s’immisçait dans nos existences, je vis exploser le nombre d’étudiants qui tentaient de valider mes séminaires en rendant des devoirs intégralement factices ou, de façon plus sophistiquée, en mêlant cette pseudo-écriture générée par l’IA à leurs propres phrases. Le semestre qui vient de s’achever en juin constitue la pire expérience de mon parcours académique, aussi bien en tant qu’étudiant qu’enseignant. J’en viens même à revoir mes positions les plus basiques en ce qui concerne la communication écrite : dans de nombreuses circonstances, je ne suis plus si sûr qu’elle soit utile, ni même souhaitable.
L’omniprésence de l’intelligence artificielle met en péril les fondements mêmes de l’enseignement supérieur. L’effet délétère de Google Maps sur notre sens de l’orientation – nous sommes maintenant nombreux à consulter nos smartphones alors que nous savons quel chemin emprunter – se retrouve dans les conséquences négatives de l’IA sur notre aptitude à bien assimiler et manier les mots ou les idées, compromettant par là même notre capacité à réfléchir. C’est une évolution particulièrement inquiétante. Dans une société violente et plurielle comme celle des Etats-Unis, fondée dès l’origine sur l’autonomie et l’individualisme érigés en vertus, elle laisse le champ libre à la nouvelle forme d’autoritarisme abrutissant qu’incarne Donald Trump.
Dans Phèdre, Platon – par le truchement de Socrate – relate le mythe de l’invention de l’écriture et identifie trois raisons principales au fait de ne pas y voir un progrès. D’abord, il argue que « faire confiance à l’écriture » réduit nos capacités de mémorisation et pousse à la complaisance, en nous rendant dépendants de sources de connaissance extérieures à nous-mêmes ; ce qui a pour résultat « l’apparence de la sagesse », mais non sa réalité. Ensuite le discours écrit étant figé, l’art de la dialectique et ses questions ne peuvent ni le clarifier ni l’affiner : « Il signifie toujours une seule et même chose. » Enfin les textes, à l’instar des tableaux, ne peuvent s’adapter par eux-mêmes aux besoins ou aux compétences de différents publics. « Ecrit, chaque discours roule de droite et de gauche, se lamente Socrate, indifféremment auprès de ceux qui s’y connaissent et, pareillement, auprès de ceux dont ce n’est point l’affaire. »
Revenir à la méthode de Socrate
Je me souviens avoir été confronté à ce dialogue socratique pour la première fois il y a un quart de siècle, dans un cours sur la philosophie grecque dans l’Antiquité. A l’époque, son propos m’avait semblé risible, et même révoltant. Plus je me jetais à corps perdu dans la lecture et l’écriture – jusqu’à décider de bâtir ma vie et ma carrière autour de ces activités jumelles, m’échinant à polir des phrases qui finiraient en articles, essais et ouvrages –, plus ma position à l’extrême opposé de Socrate me paraissait irréfutable.
Loin d’être une « image » sans vie du discours oral, comme le soutient Platon, je tenais pour évident qu’un texte composé avec sérieux, bien édité et corrigé avec soin représentait un pinacle en matière d’accomplissement rhétorique et linguistique. Un livre ou un essai est une invention quasi magique, qui comprime de vastes périodes de temps en l’espace de quelques pages. Ainsi, quelque chose que l’on peut consommer en une poignée d’heures demande des années de labeur – les copies de dix pages sur Camus que mes étudiants ont trois semaines pour rédiger n’exigent que trente minutes de lecture attentive de ma part. Utilisée correctement, l’écriture permet d’exprimer n’importe quel discours ou un argument de la meilleure manière possible.
Ma défense de l’écriture a perdu cette belle assurance. Certes, les auteurs ou journalistes consciencieux continueront à valoriser le fait de réussir à se forger, au prix de grands efforts, une voix, un style, un point de vue personnel, quels que soient les progrès ou les ingérences de l’intelligence artificielle. Mais pour l’immense majorité des étudiants qui n’aspirent pas à gagner leur vie par ces moyens épuisants, tout cela semblera de moins en moins utile et gratifiant – tout comme s’appliquer à faire une division à la main plutôt qu’attraper une calculatrice. Voilà pourquoi j’en suis venu à penser et repenser au plaidoyer multimillénaire de Platon contre l’écriture.
Quand je reprendrai mes séminaires l’année prochaine, je prévois de revenir à la méthode socratique. Les notes finales s’appuieront sur des entretiens individuels en fin de semestre, à l’oral, où les étudiants devront manier ce que le philosophe appelle « le discours de celui qui sait, discours vivant et animé ». En procédant ainsi, je m’épargnerai au moins la pénible et dégradante situation d’avoir à me demander si l’e-mail d’un étudiant s’excusant après avoir été pris à tricher n’est pas, comme son devoir, écrit avec l’aide d’une intelligence artificielle.
[Source: Le Monde]


















































