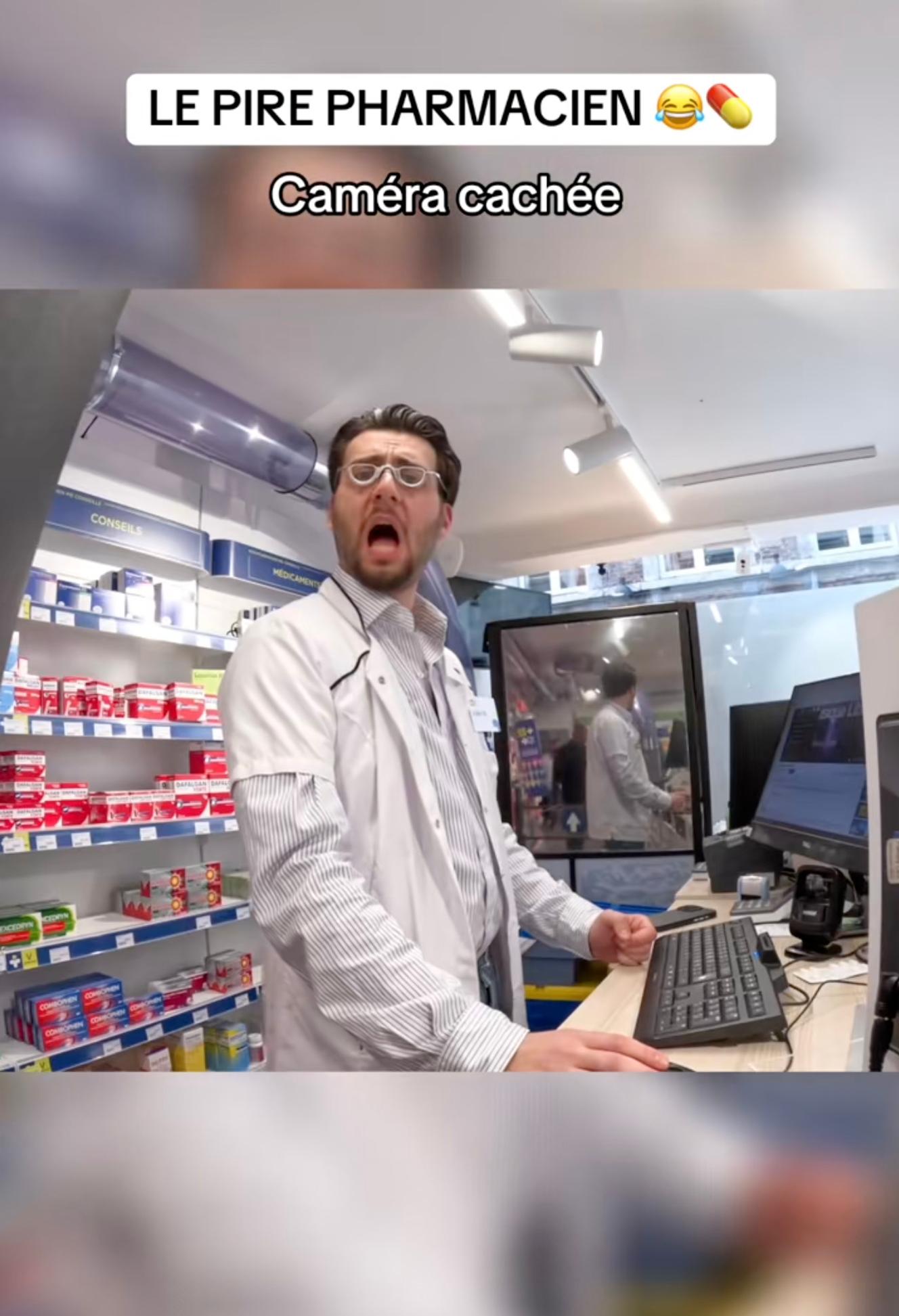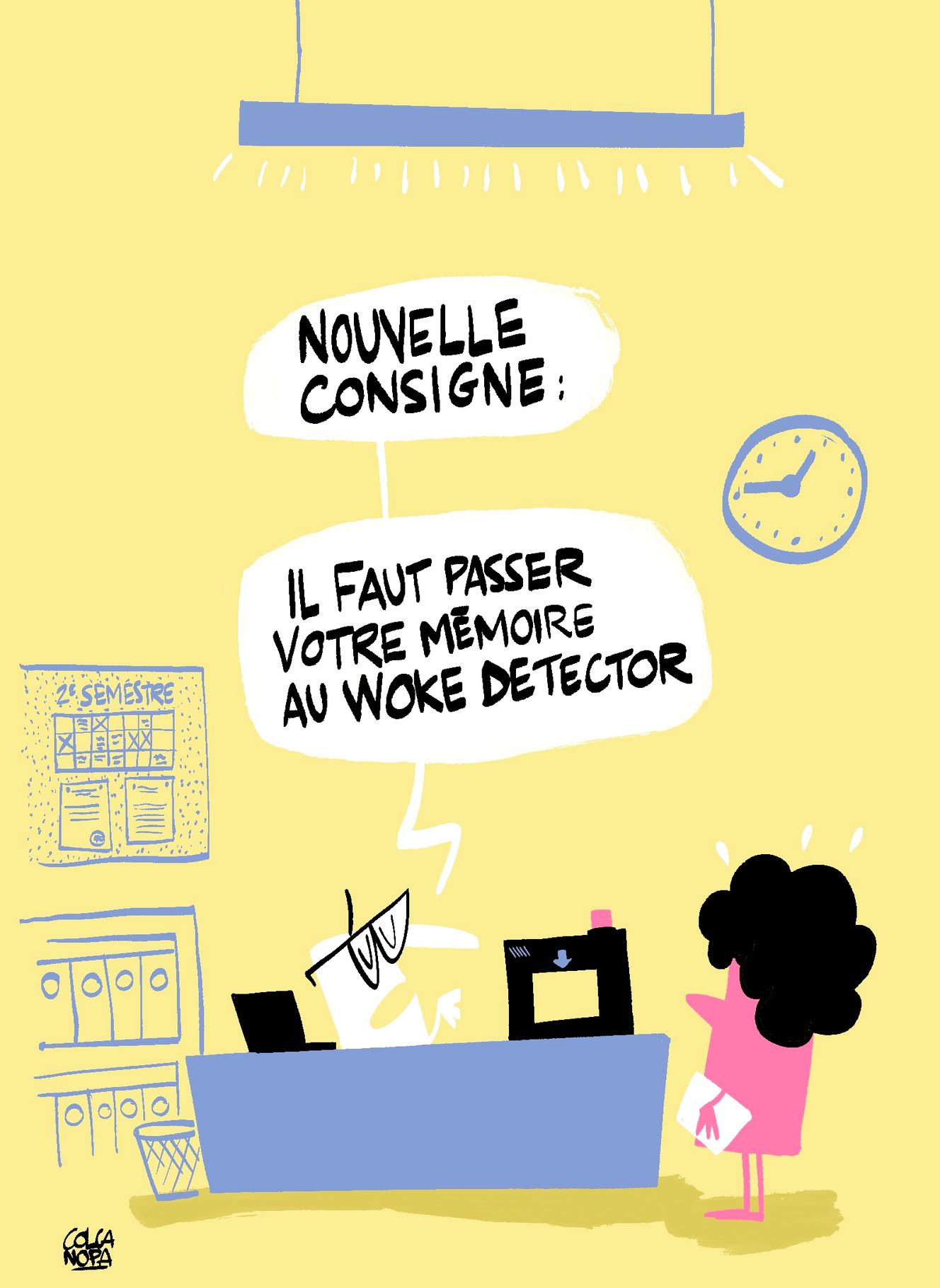Mohammed VI, roi des grandes manœuvres diplomatiques
Ces dernières années, le souverain marocain n’a cessé de s’activer sur la scène internationale. Du dossier très sensible du Sahara occidental à celui du rapprochement avec Israël, il s’est souvent imposé en maître du jeu.

L’air automnal est doux à Rabat. Sur l’esplanade du Mechwar, face au palais royal, de longs tapis rouges ont été déroulés. Soudain, les cuivres de la fanfare de la garde résonnent, signal de l’arrivée du cortège. La Mercedes Pullman 600 décapotable dans laquelle ont pris place le roi Mohammed VI et Emmanuel Macron approche au ralenti. De fiers cavaliers sanglés dans leur tunique rouge à cape verte – les couleurs nationales – les escortent au trot, dans le sillage d’un trio de lanciers guidé par un officier sabre au clair. Sur cette place comme partout ailleurs en ville, les couleurs mêlées de la France et du Maroc frissonnent sous la brise venue du front de mer. Un vrai temps d’idylle.
En ce 28 octobre 2024, le palais a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le président français, accompagné d’une délégation pléthorique où dominent les people, habitués pour beaucoup des riads à Marrakech et autres langueurs marocaines. Les retrouvailles entre amis, qu’une étrange fâcherie avait éloignés, sont émues. Un retour aux fondamentaux d’une relation qui a toujours été intime depuis l’accès à l’indépendance, en 1956, de l’ancien protectorat français ? Point du tout. L’équilibre entre les deux Etats a glissé ; plus rien n’est comme avant. Contrairement à la maxime de Lampedusa dans son livre Le Guépard (1958), « il faut que rien ne change pour que tout ait changé ».
Si Emmanuel Macron a droit, ce jour-là, au faste d’un royaume, qui a l’art de recevoir, c’est qu’il a cédé. Après avoir longtemps hésité, tergiversé, il offre à Rabat un cadeau diplomatique de première grandeur : la reconnaissance par la France de la « souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental. Afin de lui forcer la main, Rabat avait imposé, à partir de l’été 2021, une épreuve de force d’une rare virulence, trois années de froid polaire : suspension des contacts officiels, gel des coopérations, attaques incessantes – et parfois au-dessous de la ceinture – dans la presse aux ordres.
Formule magique
Le président français aurait pu résister si, par ailleurs, la relation franco-algérienne – son premier tropisme – n’était pas restée toxique, si sa main tendue avait été saisie par Alger, bref, si son rêve d’une réconciliation avait été exaucé. Or, sa déception est amère. Dans son entourage, les voix s’élèvent pour s’inquiéter du risque de voir la France « perdre sur les deux tableaux ». On le presse donc de « recalibrer » sa diplomatie maghrébine vers le Maroc.
C’est chose faite avec une lettre présidentielle adressée fin juillet 2024 à Mohammed VI. Le locataire de l’Elysée y admet solennellement que « le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Alger, qui soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, fulmine. Mais Rabat exulte : la voie est libre, désormais, pour accueillir avec faste, en octobre, le chef d’Etat français.
Oubliés, les affronts réciproques des trois dernières années. Ainsi est remisé dans le coffre des secrets d’Etat le scandale Pegasus, du nom du logiciel espion israélien acheté par les Marocains et dont Emmanuel Macron avait été une cible potentielle aux côtés de milliers d’autres victimes, selon les révélations, en juillet 2021, d’un consortium de rédactions (dont celle du Monde) coordonné par l’organisation Forbidden Stories.
L’affaire avait lourdement pesé sur la relation personnelle entre Emmanuel Macron et Mohammed VI. Le souverain marocain avait été offensé de voir sa protestation d’innocence récusée par le président français lors d’un appel téléphonique glacial, si l’on en croit la version de l’échange rapportée par l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun, en juin 2023.
La déchirure se produit à ce moment-là, dans le contexte de l’affaire Pegasus. Même quand il séjourne, à titre privé, à Paris, dans son somptueux hôtel particulier de 1 600 mètres carrés au pied de la tour Eiffel, le roi refuse de prendre les appels du président français. Entre Rabat et Paris, ou entre le Champ-de-Mars et la rue du Faubourg-Saint-Honoré, où se situe l’Elysée, le contact est rompu.
Afin de retisser le lien, on recourt alors à la diplomatie parallèle des princesses. En février 2024, les trois sœurs du roi – Lalla Meryem, Lalla Hasnaa, Lalla Asma – sont reçues à déjeuner à l’Elysée par la première dame, Brigitte Macron, des retrouvailles que solennise une photo souvenir dans le salon Cléopâtre, devant une tapisserie d’Yves Oppenheim. Le président français passe une tête pour les saluer dans un geste qui n’a rien d’improvisé. Le ciel s’éclaircit. Mais il reste à Emmanuel Macron à prononcer la formule magique – « souveraineté marocaine » (sur le Sahara occidental) – que le roi attend de lui pour clore la brouille.
La crise entre Paris et Rabat a révélé au grand jour un nationalisme marocain sourcilleux, voire vindicatif. L’humoriste et acteur Jamel Debbouze, pourtant un protégé de Mohammed VI, en a fait les frais : pour avoir osé s’afficher en tribune avec un maillot moitié français moitié marocain à l’occasion du match de football France-Maroc, en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, il provoque un tollé dans son pays d’origine. Furieux, le palais annule le festival annuel du Marrakech du rire, dont Jamel Debbouze est le parrain et le promoteur, au motif officiel de travaux de restauration du Palais El Badi, scène principale de l’événement. Le message à l’égard de la diaspora et des doubles nationaux est clair : c’est au Maroc, et à son roi avant tout, que vous devez allégeance.
Mission de deux règnes
Au-delà des péripéties franco-marocaines, l’épisode consacre un nouveau succès diplomatique du royaume chérifien, s’ajoutant à d’autres ralliements à ses thèses sur le Sahara occidental, émanant notamment des Etats-Unis, de l’Espagne ou de l’Allemagne. L’adoubement d’Emmanuel Macron conforte le Maroc dans son statut de puissance régionale émergente. Et cette percée porte la signature expresse de Mohammed VI, ce drôle de roi qui n’aime pas la diplomatie, sèche la plupart des sommets internationaux, quand il ne pose pas des « lapins » à ses homologues, comme l’Espagnol Pedro Sanchez, le Turc Recep Tayyip Erdogan ou le Chinois Xi Jinping.
Une anecdote révélatrice de son humeur ombrageuse face aux contraintes de la diplomatie : après une soirée festive, au tournant des années 2010, il ne s’était pas réveillé à temps le lendemain matin pour un rendez-vous avec un haut responsable américain de passage à Rabat. Le chambellan, qui s’était hasardé dans la chambre royale pour l’informer de la présence du dignitaire de Washington, s’est fait éconduire rudement par le monarque, furieux d’être importuné dans son sommeil.
C’est donc ce souverain-là qui aura paradoxalement rehaussé le statut du Maroc sur la scène régionale. Sur le dossier sahraoui, il aura été inflexible, l’érigeant en priorité stratégique du royaume. Lors de son traditionnel discours du Trône, en août 2022, il l’avait même qualifié de « prisme » à travers lequel il ferait le tri entre ses vrais amis et les faux.
C’est que cette affaire-là est sacrée au Maroc. Une « question existentielle », a-t-on coutume de dire. « Allez demander aux Français de la première guerre mondiale si l’Alsace-Lorraine n’était pas française ! C’est la même chose [pour nous] », avait déclaré Hassan II sur Antenne 2, en 1987. Un peu plus de dix ans plus tôt, en 1975, ce même Hassan II avait pris possession de l’ex-colonie espagnole délaissée par Madrid, dans le lyrisme de la « marche verte ».

Cette flambée patriotique teintée de ferveur religieuse – les 350 000 participants à la marche brandissaient le Coran d’une main, le drapeau marocain de l’autre – avait remis en selle un Hassan II déstabilisé par deux tentatives de coup d’Etat militaire en 1971 et en 1972. L’armée, tout absorbée à sécuriser la zone face à l’insurrection du Front Polisario, ne sera désormais plus un danger pour lui.
Cet épisode est le grand tournant du règne d’Hassan II. Le trône est sauvé par le Sahara occidental. Mais cette « récupération des provinces spoliées » du Sud – selon la terminologie officielle – est contestée au regard du droit international. Il reviendra à son héritier, Mohammed VI, de la faire admettre à la communauté des nations. En somme, à l’inscrire au « cadastre » des Nations unies (ONU).
Là sera la grande mission de son règne. La tâche est encore loin d’être accomplie, car les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU continuent de considérer le territoire comme voué à l’« autodétermination » –, perspective certes à ce stade théorique, sinon illusoire. En 2007, Mohammed VI avait proposé l’horizon d’une « région autonome du Sahara » pour mieux enterrer l’autodétermination.
« Sentiment de puissance »
Ces dernières années, trois des membres permanents du Conseil de sécurité – Etats-Unis, France, Royaume-Uni – ont embrassé cette autonomie marocaine comme la voie privilégiée, voire exclusive, à suivre. La dynamique internationale joue donc en faveur du royaume. Afin d’obtenir ce résultat, le Maroc aura bénéficié d’une lassitude assez générale autour d’un conflit vieux d’un demi-siècle, devenu inextricable depuis qu’il s’est enkysté à la faveur de la rivalité algéro-marocaine.
Mohammed VI aura aussi utilisé les grands moyens d’une diplomatie de plus en plus agressive, n’hésitant pas à ouvrir une crise frontale avec les Etats réticents à entériner ses revendications sur le Sahara occidental. Ainsi le bras de fer a-t-il été virulent au printemps 2021 avec l’Allemagne, mais surtout avec l’Espagne, voisin de l’au-delà du détroit de Gibraltar, qui a fait l’objet d’un véritable « chantage » migratoire, pour reprendre les termes indignés des autorités de Madrid. Près de 8 000 migrants – en grande majorité des Marocains, dont de nombreux adolescents – s’étaient en effet introduits, à la mi-mai 2021, à l’intérieur de Ceuta, enclave espagnole située dans le nord du royaume, avec l’évidente complicité de la police locale.
L’avertissement était transparent : le Maroc était disposé à « lever le pied » sur son contrôle aux frontières afin de forcer l’Espagne à renoncer à ses velléités de sympathie vis-à-vis de la cause sahraouie. Dix mois plus tard, Madrid cède. En mars 2022, le premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, reconnaissait que le plan marocain d’autonomie sur le Sahara occidental représentait « la base la plus sérieuse » en vue d’un règlement du conflit.
Le changement de pied était radical dans un pays taraudé par la mauvaise conscience d’avoir quitté le territoire dans la précipitation au crépuscule du franquisme, où la solidarité avec la population sahraouie a toujours rencontré un vif écho. C’est aussi, pour Mohammed VI, une revanche savoureuse sur l’humiliation que lui avait fait subir l’Espagne lorsqu’elle avait envoyé ses forces spéciales déloger manu militari la demi-douzaine de gendarmes marocains envoyés occuper l’îlot contesté de Persil, à l’est du détroit de Gibraltar, en juillet 2002.
Quelques mois après le changement espagnol sur le Sahara, en août 2022, Berlin ployait à son tour, en qualifiant le projet marocain de « bonne base ». Quant à la France, elle finira par aller au-delà de ses partenaires européens en reconnaissant en termes explicites la « marocanité » du Sahara occidental : le prix des trois années d’attente imposées par Emmanuel Macron à Mohammed VI.
Au moins la France a-t-elle ainsi repris sa position de « leader » en Europe dans le soutien à Rabat, elle qui avait déjà coécrit, en 2007, le plan d’autonomie dans le but d’aider son allié marocain, à l’époque à la peine sur ce dossier. Un retour aux classiques, mais cette fois-ci forcé par le roi.
« Un sentiment de puissance conduit le Maroc à durcir son attitude », décrypte un ancien ministre espagnol ayant eu à gérer la relation avec le royaume chérifien. Ce « sentiment de puissance » a été dopé en décembre 2020 par le fameux « deal de Trump ». Dans les ultimes semaines de son premier mandat, le président américain avait reconnu, au nom de Washington, la « souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental en échange de l’acceptation par Rabat de normaliser ses relations avec Israël, dans le cadre des accords d’Abraham, négociés en secret par une équipe ne répondant qu’au roi du Maroc.
Une relation ancienne et discrète
En apparence désintéressé par la politique internationale et peu assidu dans le travail au jour le jour, Mohammed VI a réalisé là un coup majeur. Suprême habileté, le palais royal fait signer l’accord par le premier ministre d’alors, Saad-Eddine Al-Othmani, un islamiste, le 22 décembre 2020, aux côtés de Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, et de Meir Ben-Shabbat, conseiller israélien pour la sécurité nationale et lui-même issu d’une famille juive marocaine.
Un tel rapprochement, officiel et assumé, entre Rabat et Tel-Aviv ne saurait réellement surprendre. Il révèle au grand jour une relation aussi discrète qu’ancienne. Depuis le début des années 1960, les deux Etats se sont échangé maints services clandestins. Hassan II avait ainsi autorisé les Israéliens à espionner le sommet de la Ligue arabe organisé en septembre 1965 dans un hôtel de Casablanca, une précieuse pêche aux informations deux ans avant la guerre des Six-Jours. De son côté, Israël a – entre autres coups de main – aidé les Marocains à édifier, dans les années 1980, le mur de sable de 2 700 kilomètres en lisière du Sahara occidental, afin de parer aux raids du Front Polisario.

La connivence va au-delà de la froide logique d’Etat. Elle s’inscrit dans une dimension humaine enracinée dans l’histoire ; celle d’un pays, le Maroc, où la présence juive était autrefois la plus importante dans la région. L’attachement pour la terre de leurs ancêtres des Israéliens d’ascendance marocaine – dont le nombre fait débat (472 800 selon Tel-Aviv, 800 000 d’après Rabat) – demeure profond. Et il se perpétue d’autant plus aisément que le royaume chérifien a multiplié les marques d’attention à l’égard des juifs restés sur place (entre 1 500 et 2 000).
Il a ainsi amendé, en 2011, le préambule de la Constitution, pour y préciser que son « unité » avait été « enrichie » de son « affluent hébraïque » –, un geste impensable en Algérie ou en Tunisie. Vingt ans plus tôt, un juif marocain, André Azoulay, avait été nommé conseiller du roi Hassan II, titre qu’il a ensuite conservé sous le règne de Mohammed VI, dont il avait accompagné de près les débuts. Si son rôle est maintenant moins central, il n’est pas insignifiant : André Azoulay continue d’incarner le « vivre-ensemble » marocain en multipliant les festivals dans sa ville d’Essaouira, un patrimoine intercommunautaire qui participe au soft power du royaume.
Mohammed VI fait preuve du même tropisme pro-israélien que son père. Bien avant son ralliement aux accords d’Abraham, et en sa qualité de président du comité Al-Qods – une structure créée par l’Organisation de la coopération islamique pour œuvrer à la préservation du patrimoine de Jérusalem –, il avait un jour envoyé un émissaire avec pour consigne de remettre des fonds destinés à restaurer le toit du dôme du Rocher.
« Va voir les Israéliens ! », lui avait-il ordonné. « Quand je suis rentré, je lui ai rendu compte en commençant par dire que j’étais allé voir les Jordaniens, qui sont gardiens de l’esplanade des Mosquées [à Jérusalem], relate le messager.Mohammed VI est entré dans une colère noire : “Ne t’avais-je pas dit d’aller voir les Israéliens ?”, m’a-t-il reproché. »
Le Sahara prime sur Gaza
La guerre à Gaza, à partir de l’automne 2023, a toutefois brouillé la perception, dans l’opinion marocaine, du partenariat Rabat - Tel-Aviv. La violence de la riposte israélienne aux attaques terroristes du Hamas du 7-Octobre a réveillé des doutes, voire une hostilité, à la normalisation, que seule sa contrepartie en matière d’acquis sur le Sahara occidental avait désamorcés lors de la conclusion du « deal » de la fin 2020. Face au spectacle des massacres dans l’enclave palestinienne, l’humeur populaire se rebiffe et des manifestations, parfois massives, agitent Casablanca, Rabat ou Tanger, où fusent des slogans du type : « Le peuple veut la fin de la normalisation. »
En guise de réponse, le palais fait savoir que Mohammed VI se mobilise en faveur des Gazaouis. Très timidement et sans jamais accompagner ses protestations et ses appels à la retenue par des mesures ou des menaces concrètes. L’enjeu stratégique est trop sensible : il ne saurait être question de sacrifier l’atout considérable que lui apporte désormais la coopération sécuritaire avec Israël.
Sur la période 2020-2023, l’Etat hébreu s’est hissé au troisième rang des exportateurs d’armes vers le Maroc, derrière les Etats-Unis et la France, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. En valeur absolue, le royaume chérifien affiche certes un budget militaire très inférieur à celui de l’Algérie, quasiment de moitié en 2025. Mais, sur le plan qualitatif, l’appui israélien lui permet de monter en gamme, au point de reconfigurer l’équilibre géopolitique régional.
La principale nouveauté, dans ces manœuvres, tient dans la sanctuarisation croissante du Sahara occidental face à la menace représentée par le Front Polisario épaulé par Alger. Grâce à la technologie de l’Etat hébreu, le Maroc va en effet se lancer dans la production autochtone de drones, avec l’ambition de devenir, à terme, une puissance exportatrice de ces aéronefs sans pilote.
Si l’on y ajoute les commandes passées à Israel Aerospace Industries du système de défense aérienne et antimissile Barak MX, ainsi que de deux satellites hypersophistiqués de renseignement Ofek 13, on comprend que le bouclier que le royaume déploie à ses frontières lui confère une assurance nouvelle. Une telle coopération avec Tel-Aviv, aux « acquis énormes », selon la formule enthousiaste du journal en ligne Barlamane, proche du palais, est vouée à surmonter les contingences de l’actualité, fût-elle dramatique, au Proche-Orient. Pour Mohammed VI, comme pour ses généraux, le Sahara prime sur Gaza.
Outre cette quasi-alliance avec Israël, le « fil rouge » du Sahara occidental permet d’expliquer un autre tournant pris par la diplomatie marocaine : l’ouverture à l’Afrique subsaharienne. « Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre d’Afrique et qui respire grâce à son feuillage bruissant aux vents de l’Europe », avait écrit Hassan II avec lyrisme dans son livre Le Défi (Albin Michel, 1976).
Profondeur africaine
Mais cette dualité avait surtout penché en faveur de l’Europe et, au-delà, de l’Occident, à l’heure des alignements dictés par la guerre froide. Hassan II n’avait jamais réellement investi le continent africain. Il l’a même ostensiblement boudé en claquant la porte, en 1984, de l’Organisation de l’unité africaine – devenue plus tard Union africaine. Il n’avait pas pardonné à l’organisation d’avoir admis en son sein la République arabe sahraouie démocratique (RASD), issue du Front Polisario.
Un tel éloignement joua en réalité contre les intérêts du Maroc, puisqu’il laissa la voie libre à l’Algérie et à son allié de la RASD pour plaider la cause sahraouie dans les enceintes africaines. Dès son accession au trône, en 1999, Mohammed VI s’efforce au contraire de combler le handicap. Il multiplie les tournées à travers le continent, y gagnant au passage le surnom de « Mohammed VI l’Africain ».
Ce grand retour culminera avec la réintégration, en 2017, de l’Union africaine, qui permit au Maroc d’enrôler de nouveaux soutiens africains à ses revendications sur le Sahara occidental. Entre autres arguments, la « diplomatie des engrais » – exportation et transformation des phosphates, dont le Maroc est le deuxième producteur mondial – est mobilisée au service de l’objectif de la « sécurité alimentaire ».
En deux décennies, le royaume mène ainsi avec volontarisme sa projection vers sa profondeur africaine. En Afrique de l’Ouest, des entreprises marocaines – dans les secteurs de la banque, de l’assurance, des télécommunications, de l’immobilier… –, dont beaucoup sont sous le contrôle direct du roi, s’imposent de plus en plus sur les marchés locaux. En parallèle, le royaume a dressé des passerelles religieuses à travers la promotion d’un « islam du juste milieu »(formation des imams), en jouant des affinités historiques avec la confrérie soufie tidjaniya, influente notamment au Sénégal.
Une « diplomatie migratoire » a aussi été déployée en direction des dizaines de milliers de Subsahariens présents dans le royaume, à travers des politiques de régularisation entre 2013 et 2018. Opportuniste, Rabat a avancé ses pions stratégiques au Sahel en mettant à profit les démêlés de l’Algérie avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Une telle position charnière entre l’Afrique et l’Europe est vantée à satiété par la propagande officielle, mais elle correspond à une réalité tangible. Aux portes du détroit de Gibraltar, le complexe portuaire de Tanger Med, fruit de la volonté personnelle de Mohammed VI, adossé à un bassin industriel de 1 300 entreprises (automobile, aéronautique, agroalimentaire…) à la main-d’œuvre bon marché afin d’attirer les investisseurs internationaux, a pris une importance nouvelle, à l’heure où les bouleversements internationaux ont conduit à repenser le paradigme des délocalisations.
Les Européens y prêtent une attention croissante. Lors de sa fameuse visite de 2024 à Rabat, Emmanuel Macron a lui-même loué le rôle que pourrait jouer le Maroc dans l’« intégration des chaînes de valeur » visant à protéger l’Europe et l’Afrique de la « fragmentation du commerce international ».
Un tableau idyllique ? Il ne fait guère de doute qu’à Rabat un art consommé de la communication gonfle à l’excès le profil du royaume et la stature de Mohammed VI. Ainsi de cette proposition de désenclaver les Etats du Sahel en leur offrant le débouché de l’Atlantique – au niveau du Sahara occidental, comme par hasard –, qui n’a aucune logique géographique. Ou ce projet de gazoduc Nigeria-Morocco Gas Pipeline de 5 600 kilomètres le long du littoral africain, dont le but affiché – alimenter l’Europe – va se heurter à la décarbonation en cours du Vieux Continent. Sa finalité, en réalité, n’est autre que de concurrencer un projet similaire de l’Algérie empruntant, lui, la voie transsaharienne.
Le Maroc apparaît ainsi comme rongé par sa rivalité avec son voisin de l’est, l’aspirant – au-delà d’une inquiétante course aux armements – dans une guerre d’image et un affrontement des récits aux effets délétères pour la région. La fracture s’approfondit inexorablement, au point de prendre la forme d’une dérive des continents. « Le Maroc s’est détaché du Maghreb de par sa proximité avec l’Occident, sa politique africaine très dynamique et sa relation avec Israël », résume la politologue Khadija Mohsen-Finan. Mohammed VI aura été le roi de ce nouvel arrimage géopolitique du royaume chérifien et de ses ambitions de puissance.
[Source: Le Monde]