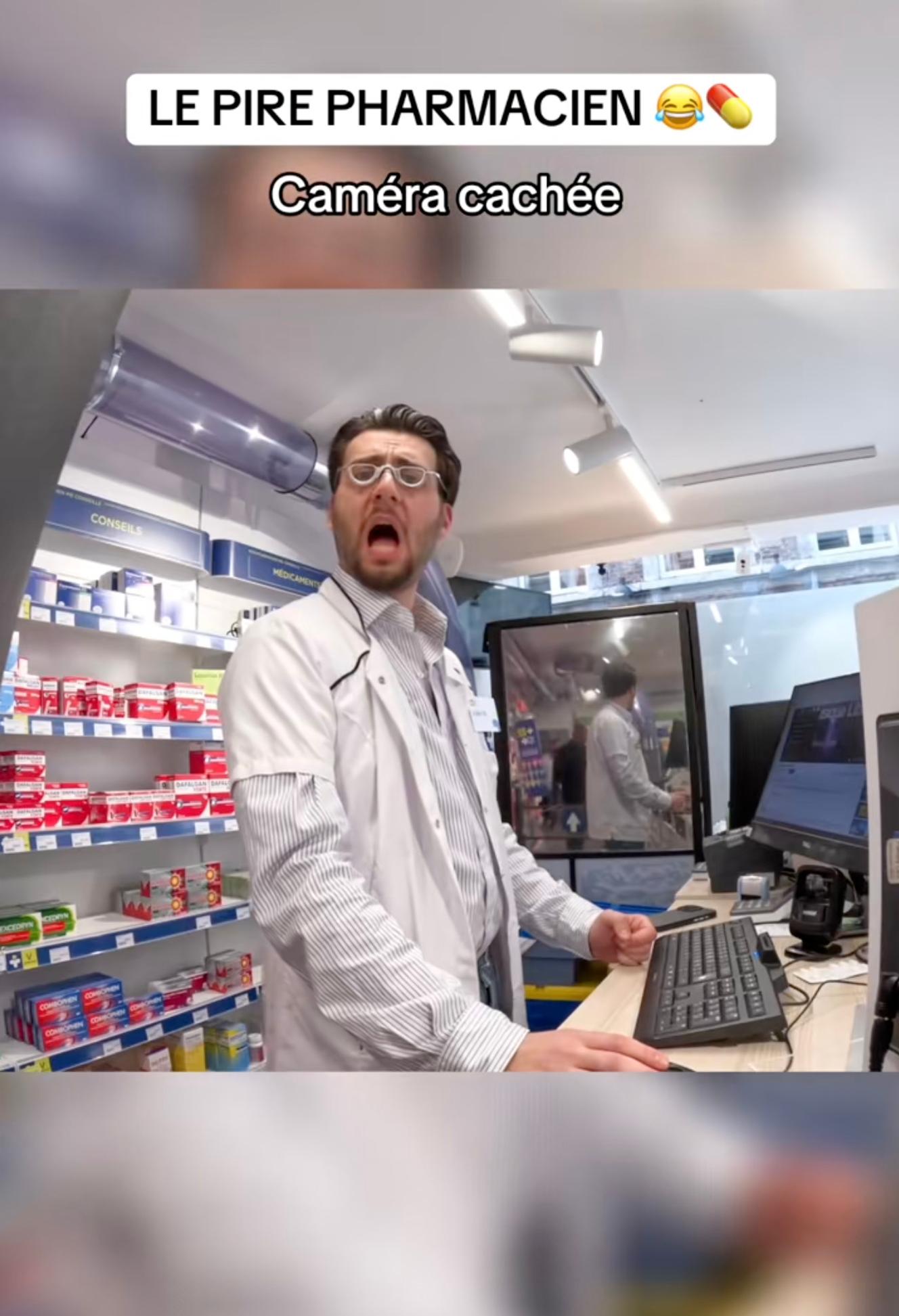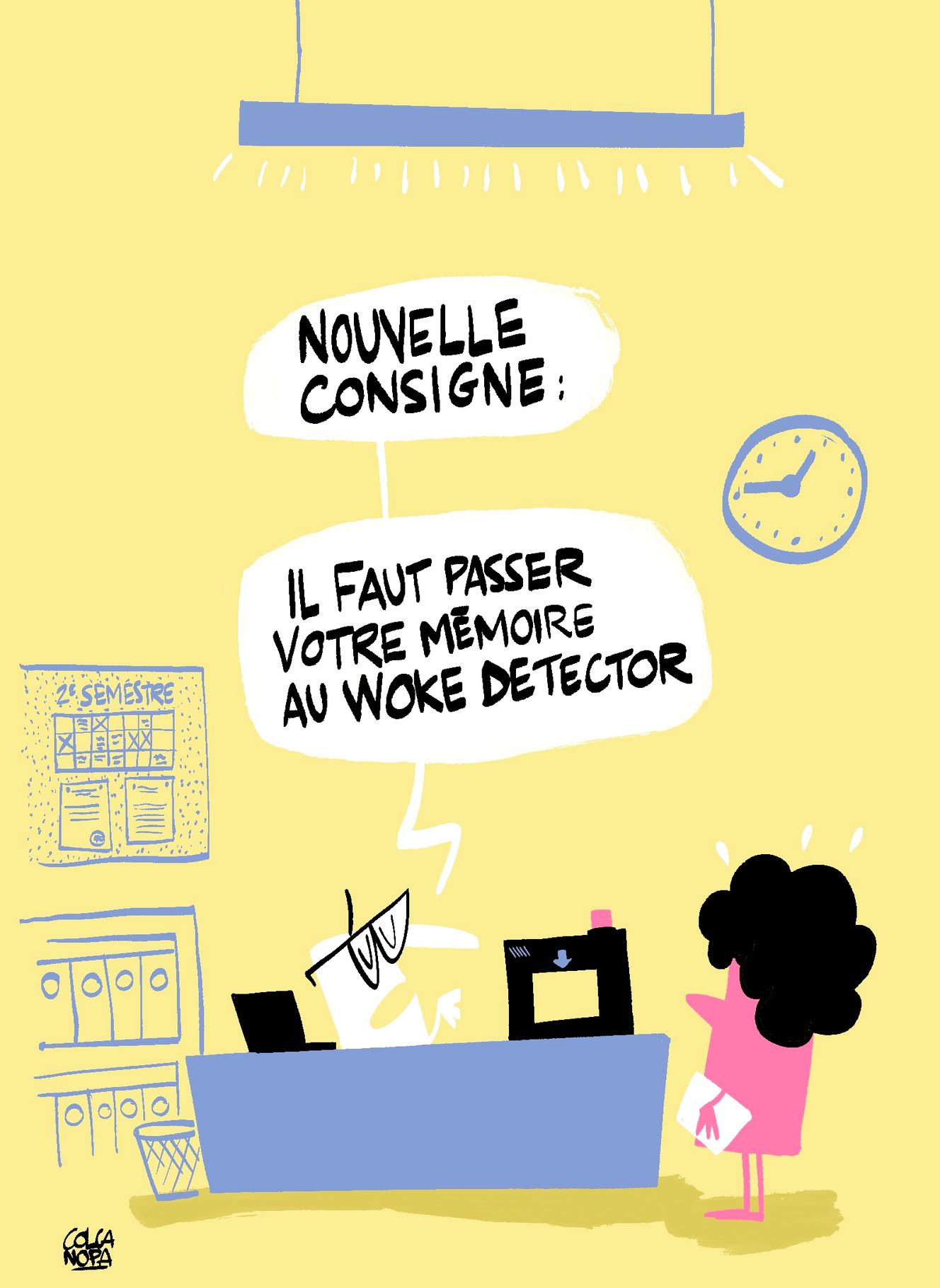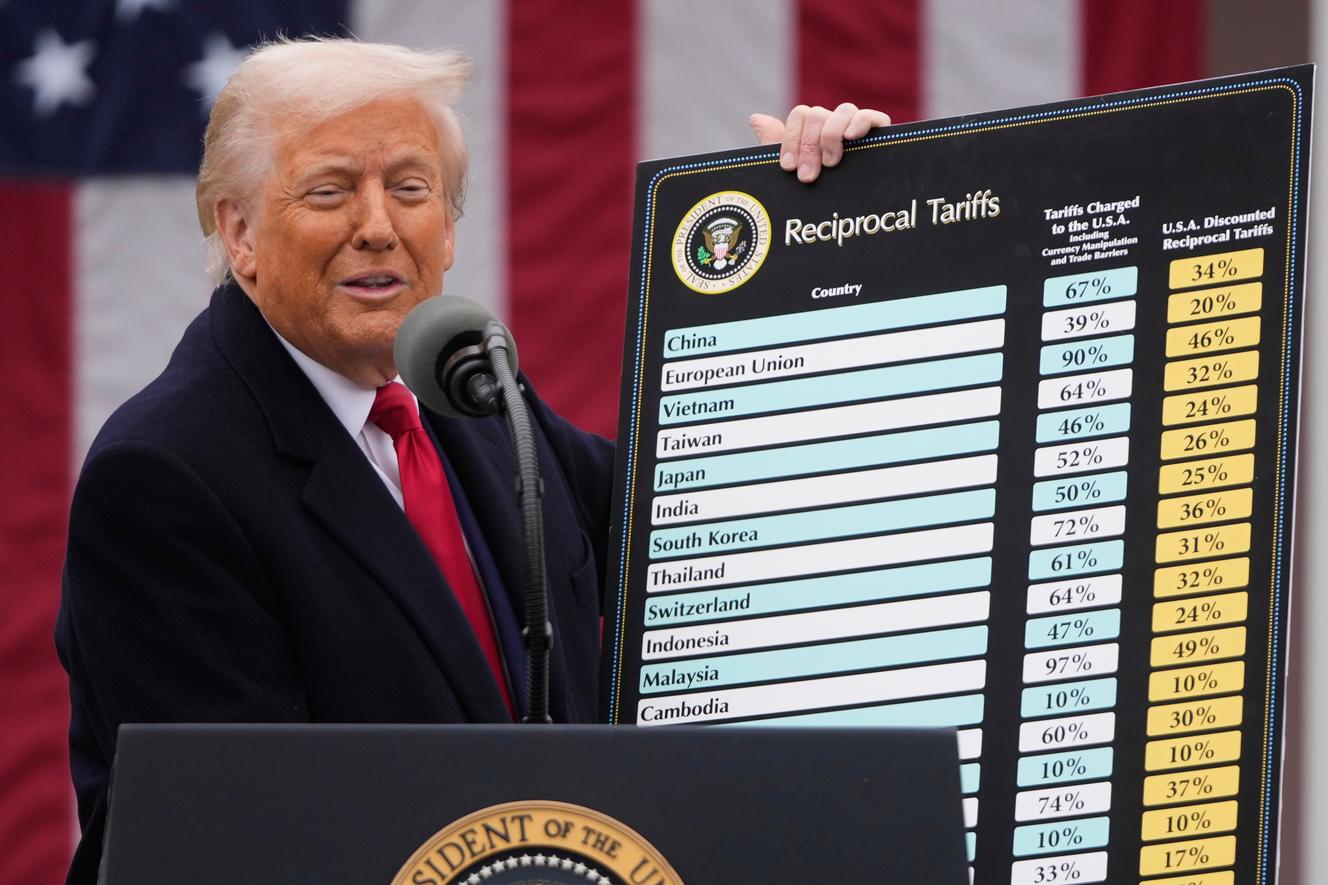L’Europe dans une position intenable après les bombardements américains sur l’Iran
Les efforts diplomatiques menés par les capitales européennes ces derniers jours afin de désamorcer les tensions semblent désormais illusoires après les frappes de Donald Trump sur les sites nucléaires iraniens, qu’aucun dirigeant européen n’a par ailleurs condamnées.

Une Europe marginalisée et impuissante, comme condamnée à subir les choix de l’imprévisible Donald Trump. Les bombardements américains sur les sites nucléaires iraniens, dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22 juin, placent les dirigeants européens dans une position impossible. Aucune d’eux n’a condamné la décision du président américain de se joindre aux frappes israéliennes, mais celle-ci prend le contre-pied, voire souligne le caractère illusoire, de leurs initiatives diplomatiques pour tenter, ces derniers jours, d’éviter un tel développement.
Après les frappes, le risque d’une escalade encore plus grave s’est accru au Moyen-Orient, redoutent les Européens, bien que certains experts jugent que Téhéran n’a peut-être plus les moyens de riposter. « Nous demandons instamment à l’Iran de ne pas entreprendre d’autres actions susceptibles de déstabiliser la région », ont déclaré Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Friedrich Merz, et le premier ministre britannique, Keir Starmer, dans un communiqué commun, dimanche après-midi : « Nous poursuivrons nos efforts diplomatiques conjoints pour désamorcer les tensions et veiller à ce que le conflit ne s’intensifie pas et ne s’étende pas davantage. »
« Aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés, et la reprise de discussions diplomatiques et techniques est le seul moyen d’obtenir l’objectif que nous recherchons tous qui est que l’Iran ne puisse pas se doter de l’arme nucléaire, mais également qu’il n’y ait pas d’escalade incontrôlée dans la région », a souligné le président français, lors d’un conseil de défense convoqué à l’Elysée, dimanche dans la soirée. Un message décliné auparavant lors d’une série d’entretiens avec les dirigeants de la région, à commencer par le président iranien, Massoud Pezeshkian, le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, ou l’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani.
« Trump veut sa victoire »
L’Elysée n’a en revanche fait part d’aucune conversation entre Donald Trump et le chef de l’Etat, près d’une semaine après leur passe d’armes, lundi 16 juin, en marge du sommet du G7, sur l’opportunité d’un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran. Il n’est pas non plus fait mention d’un échange avec le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou.
Désormais, l’option diplomatique est plus incertaine que jamais, compliquant toute forme d’implication des capitales européennes. Donald Trump n’entend pas leur laisser la moindre initiative et prétend contraindre, après cette démonstration de force, les Iraniens à revenir à la table des négociations. « Trump veut sa victoire et ne veut laisser personne prendre une miette du succès, cela ne lui plaît pas du tout de voir les Européens se lancer dans une intermédiation », observe un diplomate européen, qui rappelle que « la haine de l’Europe est un des piliers de l’administration américaine ». Vendredi, à Genève, les ministres des affaires étrangères français, allemand, britannique, ainsi que la haute représentante de l’Union européenne, Kaja Kallas, ont bien tenté de relancer les négociations, sous la menace, alors prise très au sérieux, d’éventuelles frappes américaines. Donald Trump ne leur avait pas simplifié la tâche : « L’Europe ne va pas pouvoir aider sur ce sujet », avait-il lâché depuis Washington, la rencontre à peine achevée.
Pourtant, les Européens s’étaient alignés sur l’une des exigences de l’administration Trump, afin de forcer l’Iran à renoncer à toute activité d’enrichissement, une ligne rouge pour Téhéran. Si cette rencontre de la dernière chance n’a pas permis de percer, les représentants allemands, français et britanniques ont plutôt constaté une certaine ouverture de la part du ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghtchi. « Les Iraniens se sont fait écraser par les Israéliens. A Génève, ils étaient prêts à faire beaucoup de concessions, avant même que les Américains ne frappent », indique une source diplomatique. Lundi matin, le ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors d’un conseil européen des affaires étrangères, à Bruxelles, a rappelé la position de la France quant au « changement de régime » évoqué par Benyamin Nétanyahou et Donald Trump : il est « illusoire et dangereux de penser que, par la force et par les bombes, on peut provoquer (...) un changement de régime ».
Contexte incertain
De leur côté, les Iraniens ne veulent pas parler aux Américains dans les circonstances actuelles, et réclament au préalable un cessez-le-feu. Ils pourraient être tentés par une médiation russe – Abbas Araghtchi devait se rendre lundi à Moscou. Une option rejetée par principe par les capitales européennes, qui redoutent que Trump ne l’accepte, alors que le maître du Kremlin a refusé jusqu’ici toute proposition américaine de cessez-le-feu en Ukraine.
A l’avant-veille du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), les mardi 24 et mercredi 25 juin à La Haye (Pays-Bas), et après un sommet du G7 écourté par le président américain, personne n’ose pour autant croiser le fer avec le locataire de la Maison blanche, dont le soutien reste crucial au moment où la guerre engagée par la Russie en Ukraine s’enlise.
Pour ne rien arranger, les trois capitales européennes les plus impliquées dans le dossier, Paris, Londres et Berlin, signataires de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien en 2015 aux côtés de Téhéran, Washington, Pékin et Moscou – déchiré trois ans plus tard par Trump –, cultivent leurs différences à propos de l’opération militaire américaine. Si le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a fait part de sa « préoccupation », dimanche, le ministre de la défense allemand, Boris Pistorius, a jugé que « les Américains avaient pris leurs responsabilités dans la région ». « Ce qui est déterminant, à mon avis, c’est qu’une menace importante a été éliminée. (…) C’est une bonne nouvelle pour le Moyen et le Proche-Orient, mais aussi pour l’Europe », a jugé le social-démocrate, une des figures du gouvernement de coalition dirigée par Friedrich Merz. Le chancelier allemand avait déjà fait savoir, en marge du G7, qu’Israël faisait « le sale boulot » pour réduire la menace nucléaire iranienne.
Dans ce contexte incertain, la France a commencé à rapatrier ses ressortissants présents en Israël. « Des vols militaires sont dès à présent mobilisés (A400M) pour acheminer les ressortissants français qui le souhaitent de l’aéroport Ben Gourion, en Israël, vers Chypre, sous réserve de l’autorisation israélienne », ont fait savoir les autorités françaises, dimanche soir, en plus des vols civils affrétés par Paris au départ d’Amman en Jordanie, ou de Charm El-Cheikh, en Egypte. Dans la soirée, 160 Français sont arrivés à l’aéroport d’Orly. Lundi, 150 autres devaient quitter la Jordanie. Un nouveau conseil de défense a été annoncé par l’Elysée pour mardi.
[Source: Le Monde]