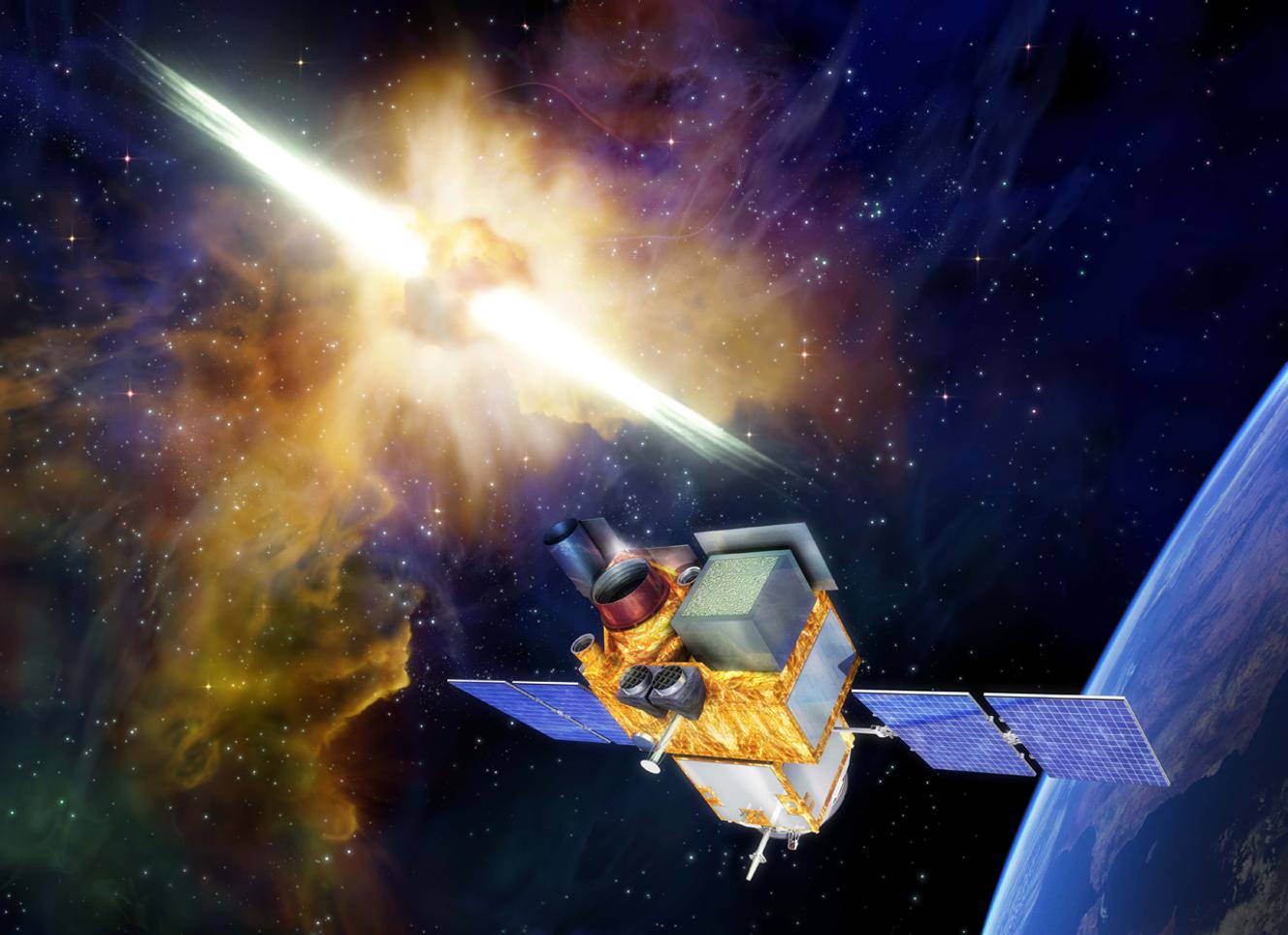Dans les fleuves et rivières de France, la température de l’eau augmente et certaines espèces déclinent
La température enregistrée dans la Loire, le Rhône, la Seine et la Meuse a augmenté en moyenne de 1,5 °C entre 1980 et 2020, et va continuer, sous l’effet du dérèglement climatique. En France, des projets de restauration écologique permettent de faire baisser la température des cours d’eau.

Il faut patienter quelques secondes pour que le thermomètre, immergé dans la Bionne, se stabilise. Accroupi sur les berges de la petite rivière, à proximité des maisons de Boigny-sur-Bionne (Loiret), David Brunet scrute le résultat avant d’extraire la sonde de l’eau. « On est à 18 °C », indique le chargé d’interventions de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, l’un des opérateurs publics chargés de la ressource hydrique. En ce 3 juillet, alors que l’intense première vague de chaleur de l’été commence seulement à s’estomper, la température affichée le satisfait. Il y a quelques années, lors des canicules, l’eau pouvait dépasser ici 22 °C.
Avant les travaux menés à partir de 2017, la Bionne s’écoulait lentement, prisonnière d’aménagements réalisés dans les années 1970, installés notamment pour garder de l’eau pour les loisirs. Sept « clapets », des sortes de petits barrages, divisaient le cours d’eau en une série de bassins larges et peu profonds, envasés et exposés au soleil. « L’eau s’y réchauffait », se souvient David Brunet. Les retenues ont été effacées, et le site, réaménagé. Des méandres ont été recréés, et l’affluent du canal d’Orléans file, désormais plus frais, à l’ombre des arbres.
Le réchauffement des cours d’eau est un phénomène généralement peu visible, perceptible lors de certains pics de température, l’été. Le 30 juin, la Garonne a par exemple atteint 28 °C, obligeant la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) à un arrêt partiel pour respecter les normes environnementales en vigueur sur les rejets d’eau chaude.
Mais dans un contexte de crise climatique, le phénomène dépasse le seul moment des vagues de chaleur. Bien que les chercheurs manquent de données pour disposer d’une vue globale, de plus en plus de publications décrivent des cours d’eau plus chauds un peu partout dans le monde.
« Seuils létaux »
Sur le bassin versant de la Loire, qui s’étend de l’Ardèche et de la Lozère jusqu’au littoral atlantique, « le point de bascule se situe à la fin des années 1980 », indique Florentina Moatar, directrice de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae). Les cours d’eau s’y sont réchauffés de 2 °C en moyenne entre 1963 et 2019, selon les modélisations publiées par l’hydrologue. Sur la majorité des tronçons, « la température de l’eau augmente plus que celle de l’air », constate la scientifique. « C’est sans doute lié en partie à l’inertie thermique » des rivières, qui tendent à conserver la chaleur emmagasinée progressivement. Et puis « le débit a aussi une influence : si on a des cours d’eau avec des profondeurs plus faibles, ils se réchauffent davantage ». Les hausses de température sont par ailleurs plus marquées au printemps et en été.
Anthony Maire, ingénieur-chercheur à EDF, fait un constat similaire pour les grands cours d’eau sur lesquels sont implantées les centrales nucléaires. La température enregistrée dans la Loire, le Rhône, la Seine et la Meuse a augmenté en moyenne de 1,5 °C entre 1980 et 2020. Ce réchauffement progressif, particulièrement observé au printemps, une période durant lesquels de nombreuses espèces de poissons se reproduisent, a des conséquences sur la biodiversité aquatique. « Les espèces qui avaient plutôt tendance à aimer les températures fraîches, comme la vandoise, ont tendance à décliner, et on observe une augmentation d’espèces à affinité pour les températures les plus chaudes », à l’instar du silure et d’autres espèces autochtones moins connues du grand public comme la bouvière, observe le spécialiste.
Les poissons sont non seulement affectés par la chaleur du milieu, mais aussi par la diminution de l’oxygène dissous dans l’eau au fur et à mesure de la montée en température. « C’est comme si en plus d’avoir trop chaud, on vous empêchait de respirer », déplore Jérôme Guillouët, responsable technique à la Fédération nationale de la pêche en France.
Il ajoute : « Certains cours d’eau deviennent par exemple quasiment inhabitables pour la truite », qui est sensible au manque d’oxygénation et ne peut pas réguler la température de son corps, à sang froid. A partir de 20 °C, « ça commence à aller très mal pour elle. A 25 °C, on est sur des seuils létaux. » Dans le sud de la France, « beaucoup de sites en basse altitude où on pouvait retrouver la truite ne sont plus des habitats favorables à l’espèce. Elle va remonter le plus possible pour rechercher son optimum de température et d’oxygène », relève Thierry Oberdorff, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement.
A contrario, certains poissons voient, eux, leur aire de répartition augmenter. C’est le cas, par exemple, du vairon, désormais présent dans certaines stations où il ne se trouvait pas auparavant, souligne le chercheur, qui étudiera, à partir de septembre, dans le cadre du projet ThermieFrance, les évolutions des espèces en fonction de la température de l’eau.
Développement de bactéries
Dans la Bionne, les travaux de restauration ont permis une recolonisation par certaines espèces plus familières des rivières et des eaux plus fraîches, comme les épinochettes, constate Joachim Coudière, technicien de rivière chargé de la surveillance du petit cours d’eau. Si les températures augmentent, les poissons ne sont par ailleurs plus bloqués par les barrages : « Ils peuvent aller se réfugier ailleurs », précise David Brunet, de l’agence de l’eau.
Les hommes peuvent, eux aussi, être affectés par le réchauffement des rivières. Les eaux dites « de surface » représentent 35 % des prélèvements destinés à l’eau potable. La montée en température favorise le développement de bactéries. A Toulouse, où la métropole s’approvisionne dans la Garonne, les services d’eau ont dû ajuster, pendant la vague de chaleur, les dosages de chlore et de javel pour « maintenir une qualité sanitaire correcte » de l’eau tout au long de son parcours dans le réseau, indique Laure Belmudes, directrice générale de Setom, filiale de Veolia chargée de l’eau potable.
Les opérateurs des réseaux d’assainissement doivent également surveiller leurs rejets lors des périodes de fortes chaleurs. La matière organique qui est rejetée consomme de l’oxygène, dans un milieu déjà amené à en manquer avec la hausse des températures. « On est conscients de cette fragilité et donc on agit pour diminuer les apports » lors des périodes sensibles, et pour protéger la biodiversité, explique François-Marie Didier, le président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
La question des aménagements réalisés par l’homme devient de plus en plus cruciale. De nombreuses rivières restent parsemées de « petits obstacles » qui les réchauffent. Un peu partout en France, des projets de renaturation sont en cours. Ils prévoient des suppressions de barrages, des re-méandrages de cours d’eau ou la végétalisation des rives pour apporter de l’ombre. Ces initiatives sont, aux yeux de chercheurs comme Florentina Moatar, des « leviers importants pour diminuer le réchauffement ». Il faut aussi, estime-t-elle, « préserver les connexions entre les cours d’eau et les eaux souterraines, qui sont plus fraîches en été ».
En six ans, dans le bassin Loire-Bretagne, l’agence de l’eau a financé 603 kilomètres de restauration de cours d’eau. Bordée de roseaux, la Bionne sert aussi de « vitrine » pour convaincre les élus et la population.
Il y a urgence : avec le changement climatique, les cours d’eau vont continuer à se réchauffer. Dans le bassin de la Loire, les travaux de Florentina Moatar, fondés sur un scénario pessimiste d’émissions de gaz à effet de serre, anticipent une hausse de la température des rivières allant de + 0,5 °C à + 2,5 °C d’ici à 2050 (par rapport à la période 1990-2019).
[Source: Le Monde]