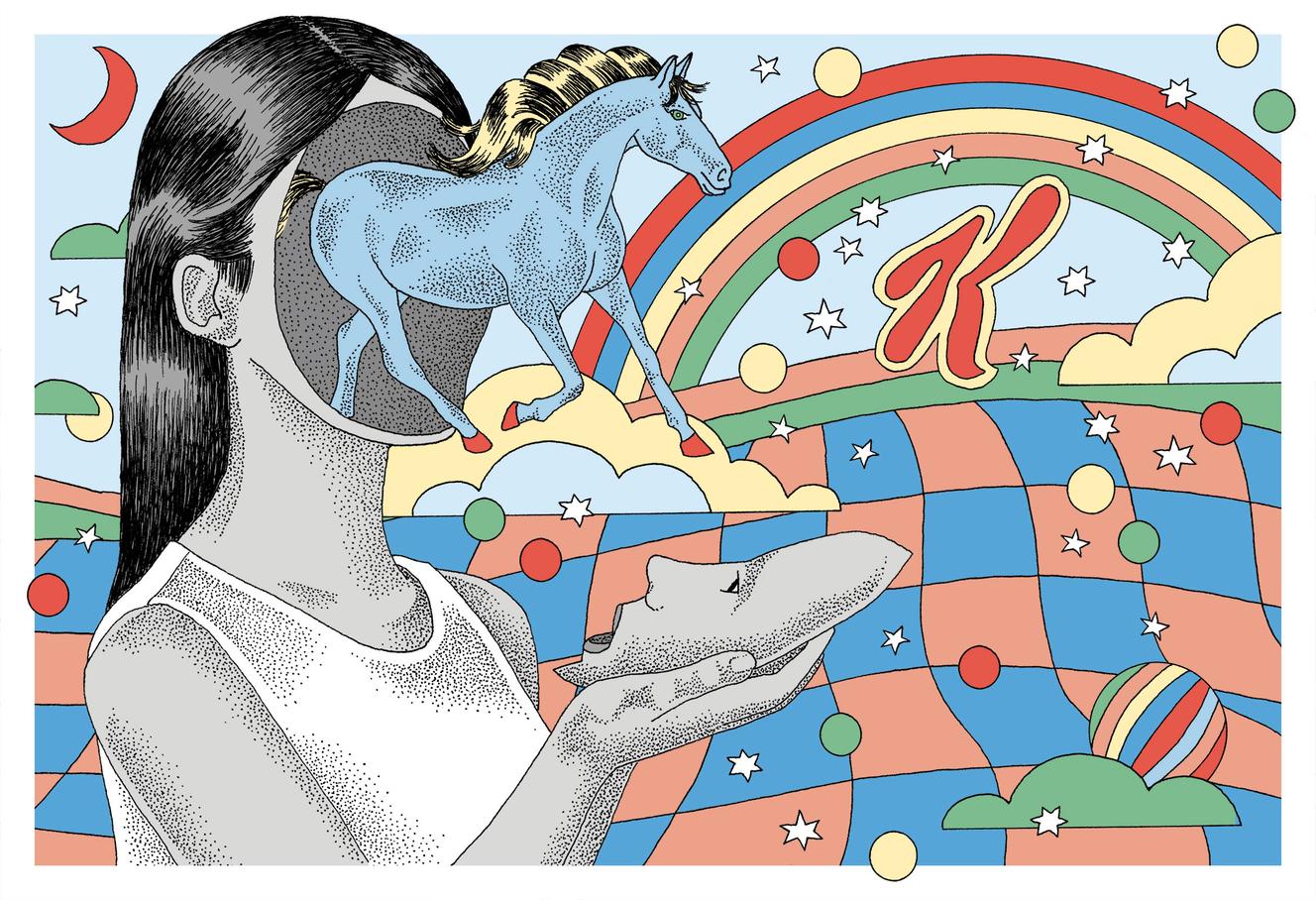Dans tout le Pacifique, la peur causée par le risque d’un tsunami d’ampleur fait place au soulagement
De la Polynésie française aux côtes sud-américaines, en passant par l’Alaska et la Californie, les systèmes d’alerte avaient été déclenchés après le séisme de magnitude 8,8 enregistré mardi soir par l’Institut géophysique américain, dans l’est de la Russie.

Une à une, les alertes au tsunami ont été levées au fil de la journée de mercredi 30 juillet, dans la plupart des nombreux pays qui bordent l’océan Pacifique. Ces systèmes d’alarme avaient été déclenchés après le séisme de magnitude 8,8 enregistré mardi 30 juillet à 23 h 24 GMT par l’Institut géophysique américain (USGS) dans la région de Kamtchatka, dans l’est de la Russie.
Ce tremblement de terre, le plus puissant dans cette région depuis soixante-treize ans, a fait monter très haut les craintes de voir une quinzaine de pays submergés par des tsunamis, y compris un des cinq archipels de la Polynésie française, les îles Marquises.
Ces îles ont vécu des heures d’angoisse et craint le pire dans la nuit de mardi à mercredi. Des vagues de 2,50 mètres ont d’abord été annoncées, puis de 4 mètres. Celles qui ont touché la grande île septentrionale de Nuku-Hiva et dans une moindre mesure Ua-Huka, plus à l’Est et Hiva-Oa plus au Sud faisaient finalement 1,50 mètre. Seules trois îles, sur les 118 (en comptant les atolls) que compte la Polynésie française, ont été concernées par l’alerte ; les autres ne subissant que des vagues très modestes.
Notifications sur les smartphones
Anny Pietri, qui représente l’Etat dans l’archipel s’est félicitée de l’absence de victimes et de dégâts, à l’issue d’heures de liaisons avec le centre de crise installé au Haut-Commissariat, à Papeete, sur l’île de Tahiti, à 1 500 km de Nuku-Hiva.
Alors que les pêcheurs étaient invités à rester en mer, loin des côtes, là où les tsunamis sont sans effet, quelque 700 Marquisiens sur les 6 000 qui peuplent ces trois îles, ont été invités à se réfugier sur les hauteurs à partir de 23 heures, prévenus du danger par les sirènes et l’envoi massif de notifications sur les smartphones, via le dispositif Fr-Alert. « La gendarmerie, la police municipale, les élus et les pompiers sont aussi passés prévenir la population », complète la cheffe de la subdivision des Marquises.
Peu avant 1 heure du matin, l’eau a commencé à se retirer, jusqu’à 80 mètres des côtes, avant qu’une heure plus tard, les vagues ne commencent à frapper les trois îles de façon continue ; mais sans provoquer de dégâts importants. L’alerte a été levée peu après 7 heures du matin, mais les activités nautiques sont restées interdites. Car même si le phénomène avait diminué, quelques vagues isolées doublées des tourbillons marins, sont venues rappeler au fil de la matinée qu’il faudrait attendre encore un peu pour un véritable retour à la normale.
Progrès en matière de surveillance
Si le tremblement de terre enregistré au Kamtchatka a suscité autant d’inquiétude, c’est qu’il s’agit du séisme le plus puissant enregistré là depuis le 5 novembre 1952, date où une secousse de magnitude supérieure à 9, sur la même zone, avait déclenché des tsunamis dévastateurs dans tout l’océan Pacifique.
Des progrès très notables ont été faits ces dernières décennies en matière de surveillance et d’alerte. Le détonateur a été le tsunami qui a causé la mort d’au moins 230 000 personnes en Thaïlande, en Indonésie, en Inde et au Sri-Lanka dans la foulée du séisme du 26 décembre 2004, au large de l’île indonésienne de Sumatra. Et comme piqûre de rappel, il y a aussi eu le traumatisme du séisme du 11 mars 2011 dont l’épicentre était au nord est de Tokyo, mais qui a soulevé une vague atteignant jusqu’à 30 mètres de haut sur certaines parties de la côte orientale nippone, noyant 18 000 personnes et entraînant l’accident majeur de la centrale nucléaire de Fukushima.
Au Japon, où ce drame reste très prégnant, tous les employés de Fukushima ont été évacués, mercredi, et l’autorité du lieu a fait savoir qu’« aucune anomalie n’avait été observée » sur le site. Plus globalement, dans ce pays où la culture de la prévention des risques naturels est très forte, plus de deux millions de personnes ont été incitées par les autorités à s’éloigner des côtes et à rejoindre des points en hauteur. Selon l’agence météorologique japonaise JMA, une vague d’une hauteur de 1,30 m a atteint un port dans le département de Miyagi, dans le nord de l’île de Honshu, la plus grande de l’Archipel. Un tsunami de 60 centimètres aurait aussi été enregistré dans la ville de Hamanaka, sur l’île de Hokkaido, et dans le port de Kuji, à Iwate.
A Hawaï aussi, l’évacuation a été importante, au point que les voitures ont encombré les rues et les autoroutes d’Honolulu, où la circulation s’est immobilisée, même loin de la mer, selon l’agence Associated Press ; avant que les autorités ne revoient à la baisse le niveau d’alerte, mercredi matin, et que les ordres d’évacuation sur la Grande Ile et sur Oahu, l’île la plus peuplée, soient levés.
Evacuations au Chili
Aux Etats-Unis, la mobilisation n’a pas été uniforme. Des alertes de différent niveau ont été émises de l’Alaska à la Californie. Dans le nord de cet Etat, l’activité tsunami a d’ailleurs continué de s’intensifier, mercredi matin, avec des hauteurs maximales de vagues de plus de 1 mètre le long de la côte à Crescent City. Cette petite ville (6 600 habitants), située près de la frontière avec l’Oregon, qui a été frappée par des dizaines de tsunamis, à cause de sa topographie sous-marine, a vu un quai de son port submergé.
Le continent sud-américain a lui aussi vécu sa journée de mercredi au rythme des alertes annoncées et levées quelques heures ou une demi-journée plus tard. Au Pérou, soixante-cinq ports sur 121 ont été fermés et la marine a recommandé de suspendre les activités de pêche, tout en incitant la population de s’éloigner de l’océan Pacifique. Au Chili, l’alerte maximum a été déclenchée et le gouvernement a annoncé, mercredi, avoir appelé plus d’un million de personnes à évacuer les côtes. En Colombie, les plages ont été vidées et fermées, le trafic maritime restreint. L’Equateur a même fermé les écoles des îles Galapagos et de son littoral.

Les côtes situées proches de l’épicentre du séisme n’ont pas non plus été épargnées par le tsunami. Une vague atteignant entre 3 à 4 mètres de haut a été signalée sur la péninsule du Kamtchatka et, plus au sud, entre cette région de l’Extrême-Orient russe et le nord du Japon, plusieurs vagues successives ont submergé les rues et le port de Severo-Kourilsk, dans le nord de l’archipel russe des Kouriles.
Dans cette zone sismique, au point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, le volcan Klioutchevskoï, qui culmine à 4 750 mètres d’altitude sur la péninsule de Kamtchatka, est entré en éruption à la suite du séisme, a par ailleurs rapporté le service géophysique unifié de l’Académie des sciences russe sur Telegram. Une coulée de lave en fusion a été observée sur son versant ouest et des explosions entendues selon l’Institut de surveillance géophysique russe.
[Source: Le Monde]