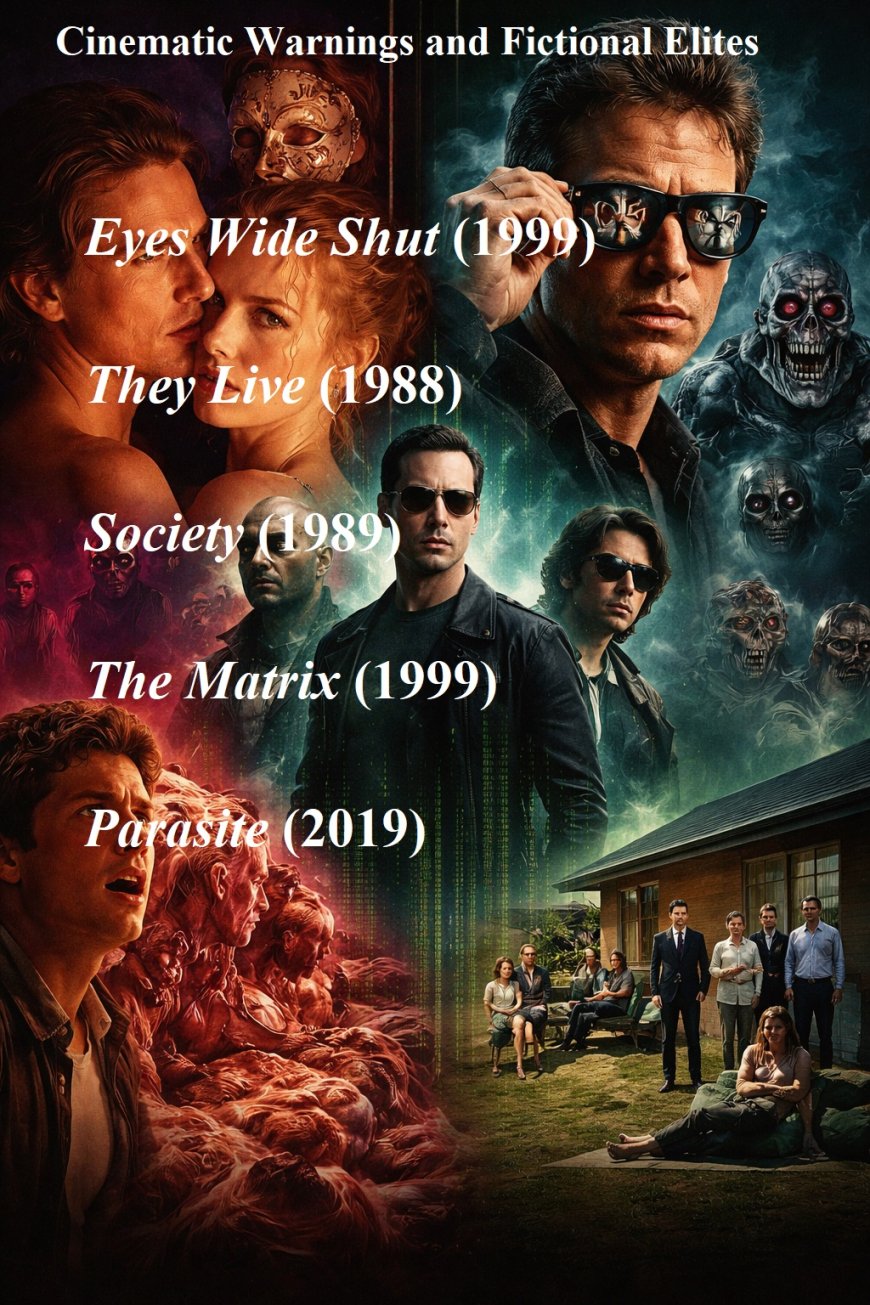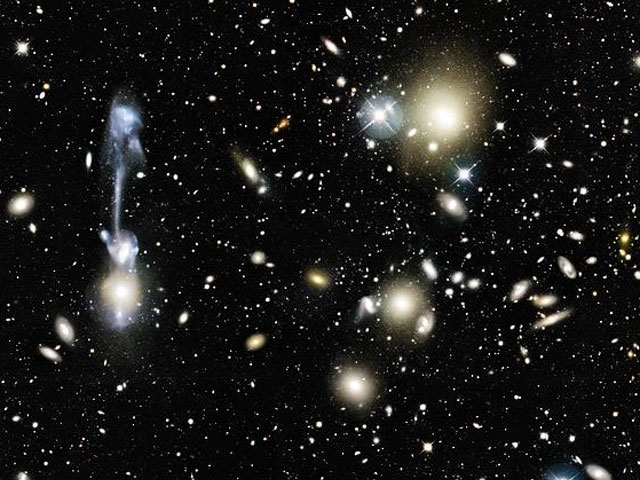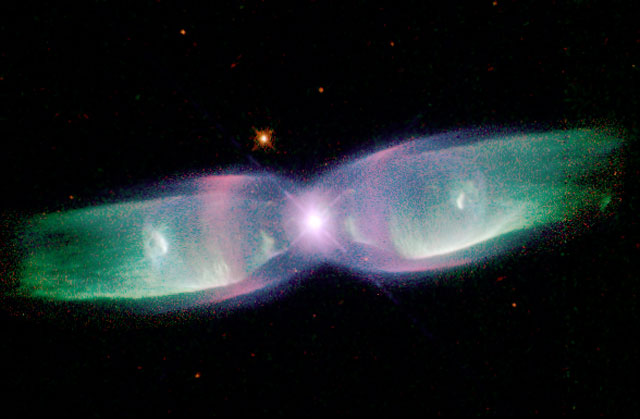Crise du logement : « Une France à deux vitesses se dessine », prévient l’Institut Montaigne
Face au marasme actuel, le cercle de réflexion libéral propose, dans un rapport, des formes hybrides de semi-propriété, telles que la location-accession, « pour raccrocher les classes moyennes au pacte social ».

C’est un rapport alarmiste sur la profondeur de la crise du logement en France que publie l’Institut Montaigne, cercle de réflexion libéral, mercredi 27 août ; elle a brisé la dynamique d’accès à la propriété des classes moyennes.
Intitulée « Classes moyennes : les nouvelles clés d’accès à la propriété », l’étude dresse en quelques chiffres le tableau d’un marasme structurel qui s’est installé dans le temps, sans perspectives d’amélioration à l’horizon. En vingt ans, les prix hors inflation du logement ont ainsi progressé de 88 %. Pour acquérir le même bien, un accédant devait s’endetter sur une durée de vingt-cinq ans à la fin de 2024 contre quinze ans en 2000, avec un taux d’effort plus important et donc un pouvoir d’achat réduit.
La hausse des prix, qui s’est fortement accentuée dans les années 2000, a ainsi creusé l’écart entre ceux qui ont un patrimoine immobilier et les autres : 24 % des ménages détiennent aujourd’hui 68 % des logements possédés par des particuliers, et le logement est devenu « une dépense pour les uns, et un revenu pour les autres », souligne le rapport. Les inégalités sont aussi générationnelles, puisque « la propriété se concentre désormais de plus en plus entre les mains des plus de 50 ans et des classes aisées ».
« Dissonance »
L’accession à la propriété des classes moyennes françaises s’est ralentie. « Aujourd’hui, le revenu mensuel moyen d’un primo-accédant se situe dans la borne supérieure des revenus de la classe moyenne », avance Nicolas Laine, responsable des études à l’Institut Montaigne. Alors que la propriété est perçue par cette population située au centre de l’échelle sociale « comme un vecteur de protection contre le déclassement et d’ascension sociale, d’émancipation », ajoute-t-il.
La crise du logement s’explique par le déficit d’offre face à une demande en hausse, en particulier dans les zones tendues, dû en particulier à « l’augmentation du nombre de ménages et [au] changement de leurs aspirations », note le rapport.
Outre la croissance démographique, qui s’est encore poursuivie dans les dernières années, et la diminution du nombre de personnes par ménage (en 2019, la taille moyenne d’un ménage français était de 2,19 personnes, contre 3,08 en 1968), deux autres phénomènes sont à l’œuvre : un mouvement de métropolisation et l’attractivité grandissante de certaines régions (le littoral, la montagne notamment) mais aussi la concurrence accrue sur l’utilisation du foncier.
Citant l’Insee, le rapport souligne que le nombre de résidences secondaires croît en effet plus vite que celui des résidences principales (+ 1,7 % pour les premières contre + 0,9 % pour les secondes entre 2013 et 2018), et que celui de logements vacants (trois millions) augmente substantiellement, environ 2,3 fois plus vite que le nombre total de logements entre 2005 et 2023. « La crise vient plus d’un désalignement de l’offre par rapport à la demande que de la rareté globale », résume Nicolas Laine.
Le stock de logements souffre aussi de difficultés conjoncturelles en matière de production d’habitat neuf. Depuis 2022, le secteur a connu une forte hausse des coûts de construction et des taux d’intérêt, puis la fin, le 31 décembre 2024, de la niche fiscale Pinel, ce mécanisme d’incitation à l’investissement locatif destiné à soutenir la construction de logements. Résultat : « Une dissonance s’installe entre la permanence d’une aspiration à la propriété et le grippage du marché qui la rend impossible, prévient l’Institut Montaigne. Une France à deux vitesses se dessine : une première très attractive, mais où le foncier et les logements disponibles sont très restreints, alimentant la hausse des prix ; une seconde en déprise. »
« Difficile de trouver des solutions »
Les conséquences sociales sont documentées. « L’incapacité à se loger apparaît comme un démultiplicateur des obstacles personnels, professionnels, familiaux des classes moyennes », met encore en garde le rapport, qui liste une série de propositions.
Ses auteurs écartent d’emblée le fameux « choc d’offre » de la construction de logements, prôné – sans résultat à la clé – par le candidat Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle de 2017, puis en 2024 par Gabriel Attal, lors de son passage à Matignon, et par son ministre délégué chargé du logement, Guillaume Kasbarian. « Le choc d’offre n’a qu’un effet limité sur les prix, justifie Nicolas Laine. Quand bien même l’on construirait un million de logements supplémentaires, ce qui est énorme, les prix ne baisseraient que de 2,5 % à 5 %. »
« Il est difficile de trouver des solutions à la crise du logement, il n’y a pas de recette magique, ni de révolution », convient-il. Aussi, l’étude de l’Institut Montaigne se cantonne-t-elle à lister des recommandations techniques « par petites touches, pour fluidifier le marché ».
Parmi ces propositions, la nécessité de mener une politique foncière plus stratégique, en soutenant la montée en puissance des établissements publics fonciers, qui acquièrent et portent du foncier à long terme avant de le revaloriser dans des opérations d’intérêt public. Ou encore celle d’inciter les propriétaires à remettre leurs biens vacants sur le marché en facilitant l’intervention d’investisseurs dans les rénovations de logements médiocres, avec, en contrepartie, une participation aux revenus locatifs. Le rapport suggère aussi de développer le « bail réel solidaire » – il permet de se porter acquéreur du seul bâti d’un logement, et non du foncier –, un outil permettant de favoriser la vente, par des offices HLM, de leurs logements sociaux.
« Evolution culturelle »
Mais le principal levier recommandé par le think tank est d’encourager à la flexibilité du marché en « changeant le regard sur la propriété ». Le rapport propose des « dispositifs hybrides ou alternatifs » tels que la propriété progressive (location-accession), partagée ou démembrée [séparation entre usufruit et nue-propriété], « particulièrement pertinents pour les classes moyennes » car « moins onéreuses », estime le rapport.
Ces propositions nécessiteraient d’attirer des investisseurs institutionnels (banques, assureurs, etc.) dans des montages leur assurant une rentabilité. Ces développements supposent « une évolution culturelle de notre rapport à la propriété, compte tenu de la dimension symbolique de la “pleine propriété” en France », reconnaît toutefois l’Institut Montaigne. Car il s’agit là, par défaut, de créer une sorte de semi-propriété. « Il faut repenser le logement pour raccrocher les classes moyennes au pacte social », justifie Nicolas Laine.
[Source: Le Monde]